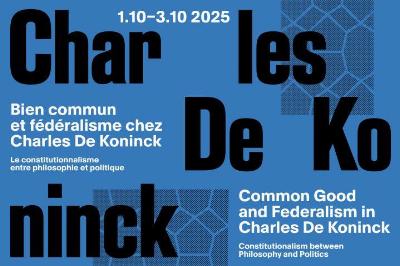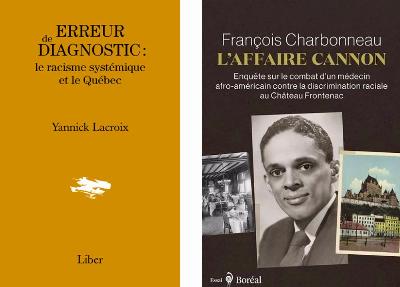Le Québec dans l'Union canadienne À propos d'une constitution prétendue
Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a finalement déposé son « projet de loi constitutionnelle » à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2025, lequel contient notamment une « Constitution du Québec » en 62 articles. Mais s'agit-il vraiment d'une constitution se demande notre analyste Marc Chevrier, au vu du fait que cette « constitution » projetée ne sera vraisemblablement pas soumise à la validation référendaire du peuple et prendra la forme d'une loi ordinaire modifiable par une simple majorité parlementaire? De plus, cette « constitution » prétendue risque d'ajouter de la complexité au droit public québécois sans faire avancer véritablement l'autonomie du Québec, insérée dans une « union fédérale canadienne ».

Voilà qu’après une longue attente, le gouvernement de la CAQ, par les soins de son ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé le 9 octobre 2025 un projet de loi constitutionnelle contenant entre autres choses une « Constitution du Québec » dépliée sur 6 pages en 62 articles, préambule inclus. Or, suffit-il qu’un simple projet de loi issu d’un cabinet ministériel se métamorphose en constitution, par le seul fait d’imprimer ce mot grave sur un document législatif ? Dans l’esprit de ses concepteurs, ce projet de loi édicterait la constitution interne d’un état fédéré, élevé au rang d’État national libre, soit l’état du Québec, entité que la loi 99 adoptée par le gouvernement Bouchard en 2000 avait déjà reconnue. Malgré le langage employé dans ce projet de « loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec » et la solennité qui a entouré sa présentation à l’Assemblée nationale, ce projet se résume à une loi ordinaire au titre certes majestueux que l’Assemblée pourra néanmoins modifier à sa guise sans devoir suivre de formes particulières. Et fait plus notable encore, le texte n’est pas voué à être soumis au peuple québécois, par référendum.
Le rejet de la vision politique et moderne de la constitution
Or, dans la conception moderne et politique de la constitution qui prévaut aux États-Unis et dans nombre de pays d’Europe et d’Amérique latine, la constitution d’un État est sa loi suprême qui émane du peuple ; il importe donc que celui-ci participe à son élaboration ou à sa ratification, par référendum ou un autre moyen comme une convention élue. L’Allemagne était tellement attachée à ce principe que lorsque les délégués des états fédérés (Länder) se sont réunis pour donner au pays une nouvelle loi suprême en 1949, ils se sont gardés de l’appeler constitution, faute d’appel au peuple. Ils lui ont préféré les termes de « loi fondamentale », laquelle pourra devenir une constitution sitôt que le peuple allemand sera mis à contribution.
Bien sûr, reconnaître au peuple le dernier mot ne garantira pas le succès de l’entreprise constituante. La France a dû tenir deux référendums en 1946 pour sortir de la IIIe République, alors que la constitution du général de Gaulle pour une Ve République a conquis le peuple français du premier coup en 1958. À deux reprises, le Chili a tenté de remplacer sa constitution héritée du régime de Pinochet, mais le peuple chilien a repoussé en 2022 et 2023 les projets élaborés par deux constituantes élues. La Suisse toutefois, habituée des référendums, a réussi la rénovation en 1999 de sa constitution fédérale datant de 1848.
De grandes figures ont défendu dans notre histoire la conception politique, républicaine au sens large, de la constitution. Ainsi Louis-Joseph Papineau, au soir de sa vie, dénonça dans la loi britannique de 1867 créant le Canada une pseudo-constitution, qui contournait l’autorité constituante du peuple. Outre les Rouges d’Antoine-Aimé Dorion, d’autres personnalités soutiendront la nécessaire validation populaire de la constitution, tel Jean Drapeau, qui préconisa en 1959 une constitution-charte de l’état du Québec soumise « au peuple de la province par voie de référendum ». Daniel Johnson, Paul Gérin-Lajoie et Jacques-Yvan Morin ont épousé chacun à sa façon cette conception politique de la constitution. Il est vrai que la classe politique au Canada comme au Québec a plutôt adhéré à la vieille vision whig anglaise de la constitution, qui en fait l’affaire des élites politiques et juridiques, le peuple étant supposé incompétent en la matière. D'ailleurs, dans les facultés de droit, on se satisfait souvent d’une stricte lecture juridique de la constitution : celle-ci correspond à n’importe quelles normes considérées suprêmes dans l’ordre juridique, sans égard au mode de leur adoption.
En se réservant l’initiative de déposer un projet déjà tout ficelé de « loi constitutionnelle » à tiroirs, contenant à la fois un projet de « constitution », un projet de loi touchant aux relations intergouvernementales canadiennes, un projet de loi créant un Conseil constitutionnel et des modifications unilatérales apportées à la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement de la CAQ a choisi la voie la plus maniable pour rester le maître du jeu. Ce projet de loi ordinaire franchira, comme tout autre projet de ce type, les étapes habituelles d’étude en chambre d’un texte législatif. On escompte qu’à l’étape de l’étude détaillée en commission parlementaire, une foule d’acteurs de la société civile se pressera de déposer des mémoires et défilera devant les députés pour engager une « conversation civique ». De la sorte, en dépit des critiques qui vont fuser de toutes parts, devrait émerger un beau consensus national qui conférera à la « constitution » une stature, un éclat, un retentissement qui frapperont les esprits et uniront les cœurs. Beau pari. Cependant, la validation du projet de « constitution » par référendum paraissant exclu, le gouvernement se prive de l’outil démocratique le plus puissant pour justement rehausser la légitimité de l’acte constituant et ériger dans l’esprit du public ce projet de « constitution » en première des lois du Québec.
Notons que l’article 41 dudit projet de « constitution » reconnaît que l’Assemblée nationale exerce « des fonctions constituantes, législatives, délibératives ». Dans les pays démocratiques qui se respectent, lorsque le parlement se déclare « constituant », c’est-à-dire quand il s'accorde le pouvoir de rédiger une nouvelle constitution, on dissout d’ordinaire la chambre et confie cette tâche à la nouvelle assemblée élue. Que la « constitution » du Québec n’advienne à la suite ni d’un référendum ni d’une élection, forme peut-être aussi le signe qu’elle ne change rien du tout au cadre constitutionnel à l’intérieur duquel l’Assemblée nationale québécoise exerce une « fonction constituante » de faible portée, qui ne nécessite donc pas une validation démocratique extraordinaire. De plus, en mettant de côté la consultation populaire, le gouvernement de la CAQ laisse tomber un instrument redoutable de réforme constitutionnelle, par lequel il pourrait obliger le reste du Canada à négocier de bonne foi des demandes québécoises avalisées par le peuple.
Une nouvelle « loi fondamentale » ajoutant une nouvelle couche de complexité
Le projet de loi no 1 pourra sans doute acquérir le rang de « loi fondamentale », ainsi que la juge Claude Dallaire a déjà qualifié la loi 99 de 2000 sur les droits et prérogatives de l’État et du peuple québécois. Ce projet de loi ajoutera donc une autre loi fondamentale à toutes celles qui se sont accumulées depuis l’adoption de la Charte québécoise des droits en 1975 : loi 101 réformée par la loi 96, loi 99, loi 21, loi 84 sur l’intégration nationale. On assiste alors à une inflation des lois fondamentales qui consacrent les droits de la nation québécoise et de son état, aux traits distinctifs scandés dans des préambules emphatiques. La « constitution » contenue dans le projet de loi no 1 propose en réalité une espèce de revue de ces lois fondamentales où elle puise plusieurs de ses principes en créant une nouvelle couche de complexité normative qui ravira les passionnés de finesses interprétatives. Le projet de « constitution » résume en des termes jolis cette accumulation de lois fondamentales, par ce considérant qui déclare que « l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales ». Cette entreprise d’accumulation se justifie par la volonté d’affirmer « l’identité nationale et constitutionnelle » de cet « État ». Qu’en pensera toutefois le « peuple québécois » qui « forme une nation » sans avoir à donner son avis ? On verra.
Les curiosités terminologiques du projet
D’ailleurs, le terme de nation, sous la forme d’un adjectif ou d’un substantif, apparaît plus d’une trentaine de fois pour désigner le Québec ou ses institutions. Le terme de peuple suscite moins de profusion, avec six occurrences. Le projet de « constitution », à son article 12, indique que « la nation a droit à ce que son système juridique de tradition civiliste soit protégé. » Toutefois, est-ce par la répétition jusqu’à saturation de certains termes qu’un législateur de « tradition civiliste » s’exprime? Ce n’est pas la seule curiosité terminologique de ce projet de « constitution ». Si un lecteur se contente de prendre connaissance uniquement du texte de celle-ci, il pourra avoir l’impression qu’il décrit l’architecture d’un État indépendant. Nulle mention de l’insertion du Québec dans l’ensemble canadien, nulle mention de la constitution fédérale n’émaillent le texte.
En réalité, il faut lire la partie II du projet de loi no 1 pour comprendre dans quoi le Québec est encastré en tant qu’état national. Cette partie II renferme une loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec censée régir ses rapports avec l’« union fédérale canadienne ». À vrai dire, cette chaîne de mots, « union fédérale canadienne », apparaît neuf fois dans cette partie II et son emploi n’est pas anodin. Depuis que le Canada existe, sa qualification en tant qu’entité étatique a toujours posé de nombreux problèmes. Conçu à sa naissance comme un « Dominion » assemblé par voie fédérale, c’est-à-dire par l’union de trois colonies existantes de Sa Majesté, le Canada se dérobe encore à toute dénomination précise et stable. Des journalistes et des intellectuels organiques répètent à l’envi que le Canada constitue une fédération, cependant que les lois constitutionnelles du pays ne sont pas si claires que cela à ce sujet. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 déclare certes, dans la version anglaise qui demeure la seule officielle, que le pays est né du désir de trois provinces « to be federally united into one Dominion ». Les traductions françaises officieuses ont longtemps traduit ce passage par le désir des mêmes provinces « de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance ». Cependant, dans la nouvelle traduction française de la Loi de 1867 que le gouvernement de la CAQ a publiée en 2021, l’idée de contracter une Union fédérale est remplacée par « le désir de s’unir en fédération ». Pour quelle raison ce gouvernement rétablit-il la notion d « union fédérale » et laisse tomber celle de fédération? Mystère.
Une étude attentive de la Loi constitutionnelle de 1867 établit que le terme « union » est employé le plus souvent pour désigner l’entité créée en 1867 par une loi impériale du parlement britannique. Le terme réapparaît dans d’autres textes constitutionnels canadiens, comme la Loi constitutionnelle de 1949 sur les termes de l’adhésion de Terre-Neuve à l’ « Union canadienne ». On a peu réfléchi sur la notion d’union pour désigner un régime étatique. Dans mon ouvrage L’Empire en marche, j’ai tenté de démontrer que cette notion polysémique fournit un mot-outil indispensable à la construction de vastes ensembles, par addition fédérale ou supranationale, comme les États-Unis, l’Inde et l’Union européenne[1]. Derrière l’union se cache souvent l’idée d’unification, à savoir que les grands ensembles, voués à s’élargir par l’ajout de nouveaux membres et à se peupler davantage, cèdent à une dynamique impériale qui tend à uniformiser l’économie, les infrastructures, la vie sociale et culturelle, en s’aidant de la centralisation des pouvoirs qu’accélèrent des moyens technologiques sans cesse perfectionnés. Cette ambition unificatrice transparaît clairement dans la Loi sur l'unité de l'économie canadienne que le gouvernement Carney a fait adopter en juin 2025 pour libéraliser le commerce intérieur et donner à l'exécutif fédéral le pouvoir de soustraire des mégaprojets jugés d'intérêt national au processus habituel d'évaluation et d'examen. Consentir à ce que le Québec évolue dans une « union », c’est finalement accepter d’assujettir l’autonomie constitutionnelle d’une minorité nationale à ce processus d’unification irrépressible, contre lequel cette minorité ne peut que protester, comme le fait la partie II du projet de loi no 1, qui dénonce les « empiètements de l’État fédéral » sur les compétences supposées imprescriptibles du Québec.
De beaux ornements constitutionnels et de vulnérables boucliers contre-invasifs
Outre les curiosités de langage qui parsèment le projet de loi no 1, on y trouve des inventions ou astuces juridiques destinées à protéger l’identité constitutionnelle du Québec et son autonomie politique. Toutes ces trouvailles reposent sur la prémisse qu’il appartient au premier chef à l’Assemblée nationale de défendre cette identité et cette autonomie et que la « souveraineté » interne dévolue à cette assemblée dans le giron canadien doit donc être préservée, autant que possible, des intrusions et des décisions fédérales. Pour ce faire, le projet de loi a forgé des « boucliers législatifs » censés renforcer la primauté de la loi québécoise dans l’ordre juridique et réduire l’influence des institutions fédérales dans cet ordre et dans le fonctionnement des institutions québécoises. Cependant, ces boucliers s'appuient sur des échafaudages fragiles, et certains paraissent même très risqués.
Le premier bouclier, qui s’avère le plus ornemental de tous, greffe à la Loi constitutionnelle de 1867 des caractéristiques qui touchent uniquement à la constitution interne du Québec. Le gouvernement de la CAQ avait déjà procédé à de tels amendements unilatéraux à la constitution canadienne pour affirmer, par deux articles distincts, que le Québec forme une nation et que sa langue commune est le français. Ce genre de modification possède cependant une portée ténue, car il n’est pas opposable juridiquement au reste du pays ; de plus, ces articles s’insèrent dans une loi constitutionnelle dont seule la version anglaise est officielle. Des juristes contestent même la légalité de cette démarche unilatérale. Ces limites ne semblent pas avoir freiné le gouvernement de la CAQ dans la volonté d’ajouter d’autres bijoux dans ce tiroir particulier que renferme la commode étrange qu’on appelle la constitution canadienne. Ce tiroir recélerait dorénavant trois ornements supplémentaires : la laïcité de l’« État » québécois, les mentions que cet « État » détient son propre modèle d’intégration et que cet « État » est de tradition civiliste. La véritable nouveauté consiste en ce que le Québec se désignera comme « État du Québec » dans la constitution canadienne qui emploie plutôt le terme « province » pour dénommer les états fédérés. Doit-on rappeler que l’expression « État du Québec » existe en droit depuis la loi 99 adoptée en 2000 et que les institutions québécoises ont généralement ignoré cet aggiornamento terminologique, pour continuer à réduire le Québec à un « gouvernement » ?
L’autre bouclier, le plus audacieux, mais aussi le plus périlleux se compose de multiples directives et règles interprétatives destinées à restreindre le recours aux actions judiciaires intentées contre les lois de l’Assemblée nationale ainsi qu’à encadrer la révision judiciaire elle-même. On vise d’un côté principalement les tribunaux, et de l’autre, les organismes qui mènent ces actions en se finançant sur les fonds publics versés par l’état québécois.
Le projet caquiste de loi fondamentale rappelle ainsi les tribunaux à leurs devoirs premiers : rendre jugement dans le respect notamment de la souveraineté parlementaire et des intentions exprimées du législateur dans ses lois. De plus, le projet de loi no 1 prévoit diverses dispositions dont le but avoué est d’orienter les interprétations que les tribunaux feront des lois québécoises, en particulier lorsqu’ils doivent statuer sur leur compatibilité avec la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Ainsi cette Charte doit être interprétée en conformité avec la future « Constitution du Québec » et d’autres lois à portée nationale comme les lois 101 et 21 et le Code civil. On va même jusqu’à exiger que la Charte québécoise ne soit plus interprétée comme une copie de la Charte canadienne, malgré l’emploi de termes similaires. Si une contestation judiciaire invoque les deux chartes à la fois contre une loi québécoise, il est demandé aux juges de mener des analyses distinctes pour chacune d’elles. De toute évidence, le gouvernement de la CAQ a renoncé à la possibilité d’accorder la primauté de la Charte québécoise sur la Charte canadienne et a préféré enjoindre les tribunaux à mieux distinguer la première de la deuxième. Outre ces mesures, un juge québécois ne pourra pas de lui-même inciter les parties à un procès à soulever la question de la légalité d’une norme québécoise. Les tribunaux, en particulier ceux dont les juges sont nommés par Ottawa, accepteront-ils de bon gré de se faire dicter la manière même de raisonner en droit, de rédiger leurs décisions et de conduire un procès ? C’est à voir. Il n’est pas impossible que ces mesures finissent par remonter des juges contre les lois québécoises et par aboutir à de cinglants revers.
Par ailleurs, le bouclier législatif caquiste vise aussi les instigateurs de recours judiciaires. Si ces derniers sont des organismes dépendants de l’État québécois, ils ne pourront user des fonds reçus de lui pour contester devant les tribunaux les lois vouées à la protection de la nation et de son autonomie, comme la future « Constitution », la loi 101, la loi 21, etc. Ce n’est pas tout, le projet de loi caquiste veut renforcer la portée des clauses dérogatoires que l’Assemblée nationale peut décider d’édicter en vertu des chartes québécoise et canadienne pour suspendre le contrôle judiciaire de ses lois. On précise que l’Assemblée nationale n’aura pas à justifier ou à contextualiser l’adoption de ces clauses dites de « souveraineté parlementaire » qui devront avoir pour effet, tant qu’elles seront en vigueur, d’empêcher quiconque d’intenter une action judiciaire pour faire annuler une loi placée sous le bouclier de telles clauses. Là encore, il n’est pas clair que les cours de justice suivront d’emblée ces directives ; dans son jugement attendu sur la légalité de la loi 21, la Cour suprême pourra fixer à sa guise les conditions d’exercice de ces clauses spéciales.
Le projet de loi no 1 cherche également à diluer le quasi-monopole des tribunaux sur l’interprétation des lois et de la constitution. Il crée à cette fin une nouvelle institution, le « Conseil constitutionnel », appelée à donner des avis, à la demande du gouvernement ou des parlementaires, sur l’interprétation de la future loi fondamentale caquiste ou relativement aux impacts d’une initiative fédérale — loi, budget, décision, programme — sur l’autonomie québécoise. La nature de ce Conseil n’est pas claire. De prime abord, il ne s’agit pas de l’équivalent du Conseil constitutionnel français, devenu depuis 1958 un tribunal spécialisé dans les affaires constitutionnelles et électorales. Ce conseil québécois sera constitué d’à peine cinq membres, censés travailler à titre gratuit, dont la nomination d’origine gouvernementale dépendra d’une majorité qualifiée, les 2/3, des députés québécois. En réalité, ce Conseil s’apparente plus à un comité interne de l’Assemblée nationale qu’à un tribunal. On pourrait y voir même un embryon de Sénat québécois, composé de vénérables politiciens, juges, intellectuels à la retraite, en possession encore de temps et d’énergie pour répandre les lumières de leur sagesse. Jean Drapeau avait déjà exprimé en 1959 l’idée de créer un tel conseil, réunissant des « juristes, économistes, sociologues, historiens éminents ». Cependant, leurs décisions auraient une telle portée que seul le peuple pourrait les renverser par référendum. Le gouvernement de la CAQ n’a pas emprunté cette voie, dans l’attente plausiblement que ce Conseil québécois fabrique une espèce de « jurisprudence » d’avis qui viendra faire contrepoids aux autres donneurs d’avis comme la Commission des droits et les libertés de la personne, commission qui devra mieux équilibrer ces droits avec « les droits collectifs de la nation québécoise. » Le gouvernement escompte peut-être aussi que les avis du nouveau Conseil fournissent des munitions utiles aux ministres québécois dans leurs démêlés avec Ottawa et aux procureurs de l’État dans les procès mettant en jeu des lois québécoises. S'agit-il d'un bibelot d’inanité légale, pour paraphraser le poète Mallarmé, ou d'une invention brillante ? Le temps le dira.
Finalement, la partie II du projet de loi no 1 prévoit un parapluie général que le gouvernement pourra déployer contre les immixtions de l’État fédéral dans les compétences constitutionnelles québécoises. Cette partie II octroie ainsi au gouvernement le pouvoir d’adopter des directives obligatoires qui s’appliqueront aux entités publiques et parapubliques québécoises et qui pourront leur interdire de toucher des subventions ou des transferts fédéraux, de conclure des ententes avec l’État fédéral et sa pléiade d’organismes ou même de participer à des activités de communication de ces derniers. Parmi la liste des organismes québécois qui pourront être frappés de telles interdictions figurent les cégeps et les universités. Il fut un temps où l’on discutait ferme de la légalité et de la légitimité des subventions fédérales versées aux universités québécoises. C’est un secret de Polichinelle que l’État fédéral a usé à pleine main de son pouvoir de dépenser pour reprendre le contrôle des milieux éducatifs québécois après le référendum de 1995, notamment par des programmes de subventions et de chaires d’excellence visant à faire travailler les intellectuels québécois sur des thèmes compatibles avec les valeurs et l’idéologie de l’ordre canadien. Mais jusqu’ici, aucun des ministres titulaires de l’Éducation supérieure n’a semblé se formaliser de cette immixtion fédérale dans l’éducation supérieure québécoise ni des abracadabrantes théories identitaires et déconstructivistes, hostiles au savoir, qui ont colonisé les établissements québécois à la faveur des initiatives fédérales. L'ancien recteur de l'UQAM, Claude Corbo, a su capter avec une pointe d'ironie la duplicité des élites québécoises vis-à-vis des intrusions fédérales dans le champ universitaire : « il [le Québec] s’en plaint sans arrêt et sans succès, il “chiale” à répétition tout en empochant les fonds que lui consent le fédéral en vertu de ses programmes, comme un baume sur ses blessures que lui cause l’invasion fédérale de ses compétences. » (Voir Le destin du Québec, PUM, p. 177.) Le projet de loi caquiste changera-t-il quoi que ce soit à cette comédie?
Grâce à ces ornements, ces boucliers et ce parapluie, le gouvernement de la CAQ se persuade que l’état du Québec participera à l’« union fédérale canadienne » et y évoluera sans rien ne perdre, ni de son caractère distinct ni de ses prérogatives. Les trésors d’imagination juridique ainsi employés pour défendre l’autonomie et l’identité québécoises font surgir dans le paysage politique de fines pagodes chinoises, délicatement posées sur des pilotis plantés dans un sol mouvant. Combien de temps tiendront-elles sur pied, résisteront-elles aux bourrasques de l’ordre canadien, qui parle par la bouche de ses juges? Et que comprendra le public de ces guirlandes de dentelle qui se fondent dans l'azur ?
L’Assemblée nationale n’est pas la Knesset
Par ses proclamations appuyées, la future loi fondamentale caquiste ressemble par plusieurs points à la loi fondamentale que le gouvernement israélien a fait adopter en 2018 pour consacrer l’État d’Israël comme État national du peuple juif. On y affirme le droit à l’autodétermination et la légitimité de cet État, ses traits caractéristiques, sa vocation nationale, ainsi que sa responsabilité à l’égard des membres de la diaspora. Le projet de loi no 1 fait de même pour le peuple et l’état du Québec et souligne la responsabilité de son gouvernement à l’égard des communautés francophones et acadienne. De plus, dans les deux cas, des parlements s’estiment maîtres du pouvoir constituant, que chacun exerce par l’adoption de lois révisables par des majorités parlementaires. Mais là s’arrêtent les similitudes. L’Assemblée nationale n’est pas la Knesset : la première jouit seulement d’une autonomie fédérative dans une « union », l’autre, de la souveraineté d’un État indépendant.
Marc Chevrier
Professeur de science politique au sein de l’Université du Québec
[1] M. Chevrier, L’Empire en marche. Des peuples sans qualités, de Vienne à Ottawa, Québec et Paris, PUL et Hermann, 2019, p. 453-463.