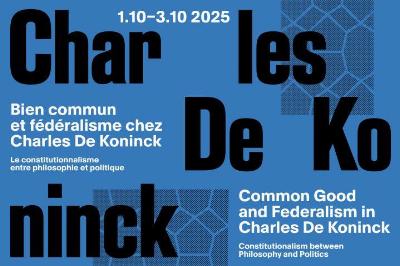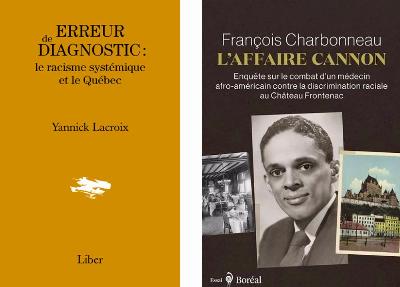La nouvelle Charte des valeurs de Monsieur Drainville
Déposé en mars 2025, le nouveau projet de loi 94 visant à renforcer l’application de la laïcité dans le réseau scolaire québécois reprend plusieurs des principes de la Charte des valeurs proposée par Bernard Drainville en 2013 sous l'ancien gouvernement péquiste. Le projet original de loi 94 essaie d’endiguer, dans l’organisation scolaire publique québécoise, toute manifestation du religieux ou de tout comportement ou opinion qui semblerait mû par la conviction ou la croyance religieuse. Bien que le projet de loi 94 soit mort au feuilleton en raison de la prorogation de l'Assemblée nationale décidée par le premier ministre François Legault, la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a décidé de reprendre le projet le 1er octobre 2025 et d'en poursuivre l'étude pour finalement l'adopter après quelques retouches et le mettre en vigueur le 30 octobre 2025. La compréhension des enjeux et de la portée de ce projet devenu loi apparaît d'autant plus pertinente qu'il véhicule une philosophie de la religion très particulière, en vogue au Québec.

On se souvient que le journaliste Bernard Drainville, devenu ministre du gouvernement péquiste de Pauline Marois, avait déposé un projet de loi à l’Assemblée nationale du Québec en novembre 2013 qui portait un intitulé alambiqué. Les médias ont résumé d’une formule simple : la Charte des valeurs. Conçu en réaction à la crise des « accommodements raisonnables » déclenchée par l’irruption de signes et de rituels religieux jugés dérangeants dans l’espace public, ce projet devait affirmer la laïcité et la neutralité religieuse de l’État, l’égalité entre les sexes et encadrer les demandes d’accommodement pour un motif religieux dans les organismes publics. Qu’on ait appelé ce projet « charte des valeurs » n’était pas fortuit. Son titre et son préambule présentaient la laïcité, la neutralité religieuse de l’État et l’égalité entre les femmes et les hommes comme des « valeurs », dont le respect incombe à l’Assemblée nationale québécoise. Après de longues consultations publiques sur le projet de loi, qui suscita aussi bien de fortes réserves que des ralliements proclamés, il mourut au feuilleton, avec le déclenchement d’élections anticipées en mars 2014.
Une nouvelle Charte des valeurs pour l’éducation publique québécoise
Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec fit adopter en juin 2019 une Loi sur la laïcité de l’État, communément nommée loi 21, différente sur plusieurs points du projet de Charte des valeurs. Or, promu ministre de l’Éducation de ce gouvernement en octobre 2022, Bernard Rainville en a profité pour ressusciter ensuite, d’une certaine manière, la Charte des valeurs qu’il avait dû enterrer. Comment ? En déposant en mars 2025 un projet de loi pour renforcer l’application de la laïcité dans le réseau scolaire québécois, le projet de loi 94[1], qui introduit dans la Loi sur l’instruction publique des éléments qui méritent réflexion. Ce projet de loi a franchi toutes les étapes de son examen parlementaire, sauf l’adoption finale; il est cependant mort au feuilleton, en raison de l’ajournement des travaux de l’Assemblée nationale pour l’été et puis de leur prorogation du 16 au 30 septembre 2025. Toutefois, le gouvernement a usé de sa prérogative de ressusciter de reprendre l’étude de certains projets de loi inaboutis à l’étape qu’ils avaient atteinte avant la prorogation. Ainsi, la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a décidé de reprendre l'ouvrage laissé par Benard Drainville pour conduire l'étude du texte jusqu'à son adoption finale. La compréhension des enjeux et de la portée du projet de loi 94 garde donc toute sa pertinence, car il révèle tout un système d'encadrement du religieux dans le réseau scolaire québécois.
Rappelons que la loi 21 utilise une terminologie précise pour désigner la laïcité. Elle en fait un principe de l’État, qui organise ses rapports avec les religions, principe lui-même défini par quatre sous-principes comme la neutralité religieuse et l’égalité entre citoyens et citoyennes. Dans son préambule, la loi évoque certes les « valeurs sociales distinctes » du Québec pour justifier son attachement à la laïcité de l’État. Il est vrai que le ministre Jolin-Barrette, lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale en mars 2019, avait déclaré que la loi 21 devait consacrer par la laïcité de l’État un « principe formel », une « valeur fondamentale ». Principe, valeur, est-ce la même chose ? Cela dépend. Si l’on parle de principe, il s’agit alors d’une idée directrice touchant l’organisation de l’État, telles que la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la magistrature. Le concept de valeur, quant à lui, extrêmement polysémique, appartient aussi bien au discours populaire qu’au registre savant. En gros, une valeur constitue une notion intangible à laquelle on attache une grande importance, un certain prix, dans la vie éthique, celle de l’individu, des familles, des communautés, comme dans la sphère politique. Selon le dictionnaire de l’Académie française, pris en ce sens, le mot valeur est une métonymie et signifie ce qui suit : « Idée, principe sur lesquels se fondent une personne, un groupe pour régler leur conduite, leur action[2]. » Si la laïcité est une valeur, elle peut dès lors gouverner, par-delà l’État, notre vie privée ; si elle est un principe, elle se confine au domaine étatique. En France, on constate que le législateur et les tribunaux ont tendance à considérer la laïcité comme une valeur qui regarde la société française dans son ensemble et donne un contenu substantiel à l’ordre public[3]. Le Québec n’échapperait pas à cette tendance et brandit lui aussi la laïcité comme une valeur sociétale, au lieu de saisir la laïcité en tant que principe organisateur de l’État[4].
Chose certaine, le projet de loi 94, qui doit modifier notamment la Loi sur instruction publique qui régit le réseau scolaire public québécois, ne contribuera pas à dissiper la confusion entre principe et valeur. De peur de ne pas être compris, le législateur utilise plus d’une vingtaine de fois le vocable « valeurs », pour ordonner aux multiples acteurs de l’école québécoise d’observer « les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes, et la laïcité de l’État. » Notons le caractère redondant et obscur de cette formule, car elle consacre l’égalité entre les sexes comme valeurs démocratique et québécoise, d’une part, et renvoie à l’égalité entre citoyennes et citoyens qui forme déjà, aux termes de la loi 21, un principe constitutif de la laïcité, d’autre part. Y a-t-il une différence entre ces deux égalités ? Mystère… On pourrait penser que la laïcité de l’État, étant distinguée dans la phraséologie du projet de loi 94 des valeurs démocratiques et québécoises, pose un principe institutionnel applicable à l’État. Cependant, dans la conférence de presse que le ministre Drainville a donnée le 20 mars 2025, la laïcité est assimilée à une valeur : « Le projet de loi intègre à la mission de l’école, des centres de services scolaires et des commissions scolaires les valeurs fondamentales que sont l’égalité femmes-hommes et la laïcité de l’État[5]. » Quoi qu’il en soit, la diffusion des valeurs consacrées par la loi dans toute l’organisation scolaire apparaît comme l’ambition première du projet de loi. En outre, il exige des centres de services scolaires et des commissions scolaires qu’ils adoptent un code d’éthique et de déontologie qui énoncent les principales valeurs que leur personnel devra observer conformément à la nouvelle Loi sur l’instruction publique.
Cette ambiguïté accompagne la volonté néanmoins claire de chasser de l’école publique québécoise toute expression de religiosité et de croyances religieuses, sous réserve de la liberté des élèves d’afficher les leurs, pourvu qu’ils ne bousculent pas les enseignements par des prières et qu’ils gardent le visage découvert sur les lieux de l’école. Et bien sûr, les élèves devront montrer qu’ils adhèrent aux articles de la nouvelle morale « sécuritaire » québécoise, qui réprouve la violence, l’intimidation, la discrimination, l’homophobie, etc. Pour garantir cet environnement « sain », un nouvel article 40.1, inséré à la Loi sur l’instruction publique, interdit donc que les locaux et les lieux appartenant aux écoles publiques servent à des « pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires. » Cette interdiction vaut de même pour les centres de services scolaires. De plus, on prévoit que l’invocation de motifs religieux pour demander un accommodement ne peut entraver la dispensation des services éducatifs ni octroyer à un employé plus de congés que ceux auxquels il a droit selon ses conditions de travail.
Par ailleurs, selon la version d'origine du même projet de loi, les membres du conseil d’établissement de chaque école, qui comporte des parents et des représentants de la « communauté », devront observer une nouvelle obligation de neutralité religieuse absolue, formulée ainsi : « Leur conduite doit être exempte de considérations religieuses et être guidée par les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes, et par la laïcité de l’État. » Cette neutralité religieuse absolue est également exigée des membres des conseils d’administration des conseils scolaires, comme des conducteurs d’autobus transportant les écoliers. Cette obligation est même extensible à tout école privée ou organisme externe avec lesquels un conseil scolaire confierait par contrat des services éducatifs, des activités extrascolaires ou un projet particulier. Dans son compte Facebook, le ministre Drainville a insisté sur le fait que son projet de loi exige « que tout le personnel adopte une conduite neutre, exempte de considérations religieuses[6]. »
De plus, l’interdiction du port de signes religieux que la Loi sur la laïcité de l’État avait formulée à l’égard des enseignants et des directeurs d’école est étendue à tous les membres du personnel au sein des écoles et des centres de services scolaires, ainsi qu’aux prestataires de services externes qui travaillent sur le site de l’école. Dans la même foulée, le souci vestimentaire du législateur ira jusqu’à rendre obligatoire le découvrement du visage pour quiconque interagit avec les élèves, sur les lieux de l’école ou dans un centre de formation professionnelle. Cette obligation est aussi applicable aux écoles privées, qu’elles soient subventionnées ou non. Or, malgré tout ce qui vient d'être expliqué, le projet de loi 94 ne touche pas à l'article 37 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que le projet éducatif de l'école « doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école. » Comment concilier tout ce casernement de la liberté religieuse dans l'école déployé par le projet de loi avec une disposition qui célèbre cette même liberté pour tous, élèves, parents et personnel scolaire?
Une Charte aux portes du for intérieur?
La version d'origine du projet de loi 94 ajoute une interdiction générale encore plus surprenante, qui défend à quiconque d’influencer ou de tenter d’influencer, par conviction ou croyance religieuse, l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction du réseau scolaire, ou l’accomplissement d’un devoir prescrit par la Loi sur l’instruction publique. Toutefois, cette interdiction ne paraît pas comporter de sanctions pénales précises.
Cette nouvelle Charte des valeurs incorporée à la Loi sur l’instruction publique essaie en somme d’endiguer, dans l’organisation scolaire publique québécoise, toute manifestation du religieux ou de tout comportement ou opinion qui semblerait mû par la conviction ou la croyance religieuse. Cette Charte des valeurs éducatives va nettement plus loin que la loi 21, qui s’était contentée de réguler l’apparence vestimentaire des enseignants et des directions d’établissement scolaire. Par le projet de loi 94, le législateur vise à mettre l’école sous haute protection, sous une chape neutraliste qui éjecte tout ce qui pourrait être assimilé, acte et parole, au religieux, pour l’ensemble des employés ou contractuels qui évoluent autour de l’école et de son administration par les centres de services scolaires. Une exception notable, cependant, les élèves pourront continuer de porter des signes religieux et d’exprimer leurs convictions spirituelles, pourvu qu’ils s’abstiennent de faire des prières manifestes ou de se livrer à des rituels religieux sur les lieux de l’école et qu’ils se découvrent le visage en tout temps, même quand ils reçoivent l’enseignement à la maison. Mais il en va différemment pour les autres acteurs du milieu éducatif, réguliers et occasionnels, qu'ils occupent le site de l’école ou tout espace où les services éducatifs publics sont administrés. Là, le religieux doit disparaître, quelle qu'en soit l'expression, sous la forme de conduites, du paraître vestimentaire, voire des motifs qui animent les comportements de ces acteurs. Autrement dit, le religieux ne doit pas peser sur le déroulement des activités scolaires et parascolaires ni sur la fourniture de services comme la restauration. Le projet de loi, dans sa version originale du moins. entend ainsi régir le visible et l’invisible, l’audible et l’inaudible, l’extérieur et l’intérieur, et même le comestible. En effet, si, dorénavant, toute conduite d’un administrateur scolaire doit être exempte de « considérations religieuses », c’est que le législateur s’intéresse aux motivations profondes qui poussent un membre du personnel scolaire à agir. Qu’arrive-t-il si un croyant est persuadé, de bonne foi, que les articles de sa croyance l’invitent à accomplir les devoirs que la loi associe déjà à sa charge d’administrateur scolaire ? Agit-il contrairement à la loi ?
Dans la philosophie occidentale de la loi, celle-ci, en matière de religion, ne regarde pas l’intimité du for intérieur, qui échappe à l’emprise du législateur. Or le ministre Bernard Drainville semble s'aviser qu’outre les actes extérieurs, la loi doit aussi s’enquérir des motivations et des raisons qui animent la conscience personnelle en rendant suspecte, sinon illégale, toute motivation religieuse susceptible d’inspirer une conduite au sein du système scolaire public, même quand celle-ci est conforme à la loi. Chose étonnante, si cette nouvelle Charte des valeurs assiège toute manifestation de religiosité jusqu’aux portes de la conscience, elle accorde aux mineurs, les élèves, une liberté minimale d’extériorisation des croyances religieuses qui est refusée aux adultes, liberté que le ministre Drainville a rattachée à l’exercice de la liberté de pensée et de conscience seulement. La religion serait-elle une incapacité, une affection, une limitation, une infirmité, tolérables chez le mineur encore immature, mais inadmissibles chez l’adulte ? C’est ce que semble présumer l’économie de la nouvelle Loi sur l’instruction publique. En tout cas, cette loi réformée, comme l’a affirmé le ministre Drainville à l’Assemblée nationale, fera en sorte « que tous les adultes qui sont en relation avec l’enfant…devront dorénavant afficher une posture neutre, mais alors là complètement neutre face à l’élève, y compris dans la tenue vestimentaire[7]. »
Une neutralité laïque à géométrie variable
Mais le projet de loi 94 finalement adopté rendra-t-il l’école publique québécoise plus neutre que jamais ? Revenons sur une affirmation faite par le ministre Drainville lors de sa conférence de presse du 30 mars dernier : « Parce que l’école québécoise est laïque, elle doit être un lieu à l’abri des influences idéologiques ou religieuses, un lieu où la liberté de pensée et la liberté de conscience des élèves doivent être respectées. » Cette phrase est curieuse, car elle énonce l’idée que l’école doit être à l’abri de l’idéologie ou de la religion. La question qui se pose est de savoir si dans l’esprit du ministre et de son projet de loi, l’idéologie se réduit à la religion ou désigne une réalité plus vaste ou tout autre. Il est clair que le projet de loi 94 ne prévoit aucune sauvegarde précise contre l’emprise idéologique, notamment s’il s’agit d’une idéologie séculière ou politique qui se démarque par son langage et ses formes des religions traditionnelles. Pourtant, dans le rapport commandé en novembre 2024 par les ministres Drainville et Roberge relativement à l’application de la loi 21 dans le réseau scolaire public, les fonctionnaires enquêteurs ont constaté un phénomène ressemblant à l’emprise idéologique. Voici ce qu’ils écrivent, s’agissant d’un certain malaise observé dans plusieurs écoles :
Dans un autre ordre d’idées, le malaise est aussi alimenté par la présence d’une certaine idéologie, présente notamment dans certains milieux diversifiés, impliquant que l’évocation même d’enjeux liés directement ou indirectement à cette diversité relèverait du racisme ou d’une pensée réactionnaire assimilable au registre de l’extrême droite et que cela rend toute action illégitime, en toutes circonstances. Bien qu’il soit complexe de déterminer avec certitude quelles sont les frontières exactes de cette idéologie, que plusieurs variantes puissent exister et qu’il n’existe pas de consensus définitif sur l’identification qui puisse en être faite, son existence et son influence ne sauraient être remises en doute et les gestionnaires scolaires sont contraints d’agir en en tenant compte[8]. [Nous soulignons]
Ce qui est frappant, une fois lu cet extrait de ce rapport administratif, c’est que le projet de loi 94 initial interdit aux gestionnaires et autres employés du réseau scolaire de tenir compte en aucune manière de croyances ou motifs religieux pour régler leurs activités et leurs décisions, alors que les idéologies, politiques, sociales, etc., pourvu qu’elles ne revêtent pas des apparences religieuses, pourront continuer de gouverner la vie scolaire et donc de s’imposer aux gestionnaires. En somme, le projet de loi 94 instaure une neutralité à géométrie variable, dure avec les religions, mais clémente avec les idéologies.
De plus, cette laïcité érigée en « valeur fondamentale » du système scolaire véhicule une vision partielle, sinon partiale de la religion, qui restreint les prétentions du législateur québécois à se placer dans une perspective de neutralité. Ni la loi 94 ni la loi 21 ne définissent ce qu’on doit entendre par « religion ». Le législateur semble se reposer sur un sens commun relativement partagé au sein de la population québécoise et du système scolaire grâce auquel un acte ou une pensée à caractère religieux peut être aisément reconnu. Comme l’a affirmé le premier ministre François Legault dans son compte X : « Au Québec, on a décidé, il y a longtemps, de sortir la religion des écoles publiques[9]. » Mais que sort-on exactement ? On a résolu une disparition des signes religieux, visuels et matériels, des paroles audibles, telles que les prières, ainsi que des postures corporelles qui les accompagnent, puisqu’on défend aux écoles de prêter leurs locaux à l’accomplissement de prières et de rituels dits « religieux ». En fait, le projet de loi 94 n’interdit pas les prières manifestes comme telles, mais le fait d’affecter un lieu ou un local appartenant à l’école à l’exécution de ces prières « ou d’autres pratiques similaires ». Le pratiquant d’une religion pourra toujours se cacher dans un cabinet de toilette, sous la cage d’escalier, dans un coin obscur d’un sous-sol ou derrière des portes closes, en clandestinité. Ou plutôt, il pourra subrepticement occuper un local, un corridor, un balcon, une cour de récréation, se pencher au bord d’une fenêtre pour réciter une prière à la dérobée, furtive, rentrée, susurrée, accomplissant d’imperceptibles gestes qui échapperont à la vigilance « sécuritaire » environnante. Outre la proscription des signes et des comportements religieux décelables à la vue et à l’ouïe de tous, le projet de Charte des valeurs éducatives de Bernard Drainville a mis dans sa ligne de mire les sentiments, les idées et les représentations des adeptes d’une religion qui pourraient se trouver dans une école. Tel que mentionné, on prévoyait défendre que des considérations religieuses puissent en quelque manière influer sur l’exercice d’une fonction, d’une activité, d’un devoir prévus par la Loi sur l’instruction publique. C’est comme si la loi, douée d’une puissance intramentale ou intraconscientielle, pouvait entrer dans le for intérieur et y faire le ménage.
Disons que le ménage, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec l’avait déjà fait en remplaçant l’ancien cours Éthique citoyenneté et religion par un nouveau cours « sécularisé », intitulé Culture et citoyenneté québécoise, où l’enseignement des réalités religieuses est passé, pour l’essentiel, à la trappe[10]. En réalité, ce nouveau cours dont l’implantation est obligatoire depuis l’année 2024-2025 concocte un cocktail de doctrines sociologiques et pédagogiques à la mode, voué à l’initiation à la « sexualité globale, positive et inclusive » qui fait la part belle à l’idéologie du genre et au subjectivisme radical qui la fonde. Au secondaire, on y greffe des enseignements sur la technologie, les réalités « culturelles », et même sur les « rapports de pouvoir », « l’agentivité sexuelle » et « l’introspection en lien avec la sexualité » (sic). L’introspection comme exploration de son nombril, voilà une superbe destination éthique pour un cours prétendu sur la « citoyenneté » d’un système d’éducation public.
Une charte qui véhicule une certaine philosophie de la religion
Ce cours confirme une opinion dominante relayée par le projet de Charte des valeurs éducatives du ministre Drainville, à savoir que la religion est une affaire strictement personnelle, logée dans le tréfonds de l’individu isolé, dont la quête de sens peut se porter aussi bien sur la poursuite de son salut que sur la connexion intime de son moi avec les ressorts de sa sexualité profonde, « globale », authentique. Un moi devenu agent, qui se construit lui-même, sans nécessiter de médiations fortes. Le mathématicien et philosophe britannique, Alfred Whitehead, avait déclaré en 1926 lors d'une conférence : « La religion est ce qu’un individu fait de sa solitude[11]. » Le philosophe canadien George Grant a dit de cette affirmation qu’elle formule une demi-vérité, puisqu’elle promeut une vision narcissique de notre solitude et émousse notre capacité de trancher en matière de justice publique[12]. Dans un essai publié en 2023, le philosophe Francis Fukuyama a fait des observations intéressantes sur l’évolution de la religiosité des Américains. Il constate que beaucoup d’entre eux ont quitté leurs églises traditionnelles pour embrasser ce qu’il appelle la « religion intuitive », grâce à laquelle « [d]e nombreux Américains ont ainsi parachevé leur christianisme, voire l’ont remplacé par un syncrétisme de religions orientales allant du bouddhisme à l’hindouisme », leur objectif étant la reconquête de leur « moi intérieur[13] ». Pour les assister dans cette reconquête, beaucoup d'Américains se sont tournés vers les thérapeutes en tous genres et les psychiatres, lesquels sont devenus, aux dires du sociologue Christopher Lasch, des prêtres de substitution chargés de conduire leurs patients à la découverte de leurs « valeurs » intimes (Le moi assiégé, Climats, 2008, p. 115).
Il y a quelques années, du temps où Bernard Drainville animait une émission radiophonique sur les ondes des 98,5 FM, les auditeurs ont pu entendre une surprenante discussion. Elle portait sur la religion, sur la liberté de chercher Dieu, de croire à son existence ou à son inexistence. L’animateur Drainville, de but en blanc, affirma qu’il pouvait bien chercher Dieu tout seul, s’interroger sur lui, sans devoir passer par un clergé ou une église. En somme, la religion est un soliloque, en retrait en soi, une plongée solitaire en soi-même, un congé donné à l'humanité, une affaire qui regarde son moi, qui peut bien se dispenser de prières manifestes, de signes extérieurs, de rituels coutumiers, du secours, de l’aide, de l’écoute et de la vue d’autrui. Telle est la religion intuitive des temps présents, dont une loi et un cours d’éducation bien peu civique se font l’écho.
Le projet de loi 94 a franchi l’étape de l’étude détaillée en commission parlementaire en juin 2025 mais sans avoir été dûment adopté avec ses amendements avant l’ajournement estival des travaux de l’Assemblée nationale. La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, en a fait poursuivre l'étude par l'Assemblée nationale, qui y a apporté quelques amendements avant son adoption finale le 30 octobre. Les députés ont notamment enlevé du projet de loi les passages où l'on exigeait des responsables de l’éducation d’avoir une conduite « exempte de considérations religieuses ». Le nouveau texte exige une conduite « guidée par les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l'égalité entre les femmes et les hommes, et par la laïcité de l'État. » Cette modification n'est pas anodine, mais en subtance, l'esprit du texte devenu loi demeure le même.
Nommé ministre de l'environnement après son séjour à l'éducation, Bernard Drainville aura quand même réussi à imprimer sa marque sur le système éducatif québécois, désormais régi par sa Charte des valeurs dont la vision de la laïcité et des croyances religieuses apparaîtra à plusieurs fort discutable.
[1] Projet de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives, 43e législature, 1re session, Assemblée nationale de l’état du Québec, déposé le 20 mars 2025. Voir : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-94-43-1.html.
[2] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., en ligne : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9V0094.
[3] Frédéric Dieu, « L’ordre public et les religions : ordre public, ordre laïque ? », Revue du droit des religions, 9, 2020, p. 13-40, par. 6.
[4] Voir Frédéric Dejean, « Une géographie de la laïcité québécoise : vers une extension du principe de laïcité », mémoire présenté au comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, mai 2025, p. 23. En ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/secretariat-institution-democratiques/enquetes/entrisme-religieux/Frederic_Dejean.pdf .
[5] Conférence de presse de M. Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, Assemblée nationale de l’état du Québec, 20 mars 2025, en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-98743.html.
[6] Publication de Bernard Drainville, député de Lévis à l’Assemblée nationale, 23 mai 2025, en ligne https://www.facebook.com/bernard.drainville/posts/la%C3%AFcit%C3%A9-dans-nos-%C3%A9coles-publiques-adoption-de-principe-du-projet-de-loi-94-merci/1249987253154249/ .
[7] Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, débat sur l’adoption du principe du projet de loi 94, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 43e législature, 1re session, 21 mai 2025, en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/43-1/journal-debats/20250521/408293.html#_Toc199163674.
[8] Vérification des mesures prévues à la Loi sur la laïcité de l’État, Rapport de vérification, direction des enquêtes, ministère de l’Éducation, état du Québec, janvier 2025, par. 98, p. 29-30.
[9] Compte X de François Legault, 22 octobre 2024, https://x.com/francoislegault/status/1848688252406141437?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1848688252406141437%7Ctwgr%5E646476eab88a11096f95a15adeefcc2b68eb453a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Factualites%2Fpolitique%2F202.
[10] Les programmes d’études et les documents explicatifs de ce nouveau cours sont disponibles à cette adresse, ministère de l’Éducation, état du Québec, https://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/refonte-programme-ethique-culture-religieuse .
[11] « Religion is what the individual does with his own solitariness », Alfred North Whitehead, Religion in the making, Lowell lectures 1926, Cambridge, Cambridge University Press, 1927, p. 6.
[12] George Grant, English-Speaking Justice, Toronto, Anansi, 1985, p. 85.
[13] Francis Fukuyama, Libéralisme. Vents contraires, Paris, Saint-Simon, 2023, p. 84.