En marge de «La généalogie de la violence» de Gilles Bibeau
 Un livre nécessaire, écrit par anthropologue itinérant dont la culture est vraiment universelle et qui connaît bien les régions du monde dont il parle : l’Amérique et l’Europe, le Moyen Orient, l’Afrique. Tout journaliste, tout professeur appelé à commenter les grands événements actuels dans le monde devrait s’inspirer d’un tel livre1 ou d’un autre de même niveau… s’il s’en trouve en ce moment.
Un livre nécessaire, écrit par anthropologue itinérant dont la culture est vraiment universelle et qui connaît bien les régions du monde dont il parle : l’Amérique et l’Europe, le Moyen Orient, l’Afrique. Tout journaliste, tout professeur appelé à commenter les grands événements actuels dans le monde devrait s’inspirer d’un tel livre1 ou d’un autre de même niveau… s’il s’en trouve en ce moment.
Dans le sillage d’Homère
La notion de guerre asymétrique, qui occupe une place centrale dans le livre, est aussi importante pour la compréhension du monde actuel que ne l’était celle de guerre froide pour la compréhension de la seconde moitié du vingtième siècle. Le terrorisme d’état, autre notion adoptée résolument par Gilles Bibeau, jette un doute radical sur l’hypothèse simpliste selon laquelle, les démocraties occidentales défendent innocemment la liberté, le droit, la civilisation contre la barbarie des terroristes. Ces démocraties pratiquent en réalité un terrorisme d’état consistant à s’attaquer à la population civile d’un pays souverain, sans avoir déclaré la guerre à ce pays, et sans avoir reçu l’aval des Nations Unies, ce qu’a fait Barack Obama lui-même, cent fois par année plutôt qu’une. Si d’un côté on décapite l’ennemi, de l’autre on le déchiquète au moyen de drones.
Dans l’Illiade ou le poème de la force, Simone Weil montre comment, aux yeux d’Homère, Grecs et Troyens sont emportés par une même force, une même démesure. S’élevant au-dessus de la mêlée, le poète, tel le soleil qui brille pour les bons comme pour les méchants, éprouve la même compassion pour les uns et pour les autres. « Ils gisaient, aux vautours beaucoup plus chers qu'à leurs épouses », dit-il d'Hector et des autres guerriers troyens morts ou blessés. En guise de dernier adieu à sa femme, Andromaque, Hector remet leur fils dans ses bras; « elle le reçoit sur son sein parfumé, avec un rire en pleurs »
.
Mais, peu après avoir tué Hector et d'autres Troyens, Achille perd son meilleur ami, Patrocle et c'est lui désormais qui inspire de la compassion :
« Mais Achille pleurait, songeant au compagnon bien-aimé; le sommeil ne le prit pas, qui dompte tout; il se retournait, çà et là…»
Nous sommes ici à la source où le mot humain prend son sens. À certains moments, aussi rares que merveilleux, les ennemis se réconcilient dans une admiration réciproque. Hector vient de mourir sous les coups d'Achille, mais ce dernier demeure un être humain aux yeux de Priam, le père d'Hector:
« Quand le désir de boire et de manger fut apaisé,
Alors le Dardanien Priam se prit à admirer Achille,
Comme il était grand et beau; il avait le visage d'un dieu.
Et à son tour le Dardanien Priam fut admiré d'Achille
Qui regardait son beau visage et qui écoutait sa parole.
Et lorsqu'ils se furent rassasiés de s'être contemplés l'un l'autre...»
Il n’y pas des bons d’un côté et des méchants de l’autre, mais dans chaque camp, de pauvres humains en proie au mal qui monte de leurs racines et que l’on peut appeler radical pour cette raison. Gilles Bibeau jette un regard aussi élevé, aussi détaché que celui d’Homère. On regrette seulement qu’il n’ait pas été poète plus souvent. Il a beau nous rappeler des chiffres affolants sur les civils tués par les alliés au Japon, en Allemagne, au moment où la guerre était déjà gagnée, en Corée (les B-52), au Vietnam, (encore les B-52), en Irak, en Afghanistan, jamais il ne nous touche autant qu’Homère évoquant un malheur concret. Mais quand le malheur concret frappe des masses de soldats anonymes, comment l’évoquer mieux que ne le fait Gilles Bibeau: «Dans les guerres asymétriques auxquelles l'Occident prend part à notre époque, la proportion des morts est à peu près toujours la même : environ dix pour un, et parfois même cent pour un. Ainsi, dans l'opération Tempête du Désert- nom de code de la guerre éclair des États-Unis contre l'Irak en 1991 – des dizaines de milliers de soldats irakiens furent tués sous les attaques des bombardiers B-52 surgissant, avec leurs ailes d'albatros déployées, au-dessus de troupes vulnérables avançant à découvert dans des zones désertiques. Les corps déchiquetés de ces soldats furent jetés dans d'immenses fosses creusées dans le désert sans que l'on ne connaisse jamais le nombre exact des victimes. On peut cependant aisément imaginer l'ampleur du carnage qui s'est produit tant la puissance de feu des forces en présence était disproportionnée.»p.12
Humanas actiones, non ridere, neque detestari, sed intelligere. (Spinoza.)Intelligere : comprendre, c’est ce que s’efforce de faire Gilles Bibeau. Il analyse en profondeur les valeurs dont se réclament les belligérants et les cultures dans lesquelles leurs violences s’enracinent. Que dit vraiment le Coran, comment les penseurs de l’Islam l’interprètent-ils aujourd’hui, quel soutien les simples fidèles apportent-ils à l’action des extrémistes? Gilles Bibeau répond à ces questions. Il nous initie également à ce protestantisme militant qui explique pourquoi les Américains se perçoivent comme des libérateurs, même dans les situations où ils sont manifestement des prédateurs avant tout.
Hannah Arendt et Günther Anders
Par-delà les cultures des belligérants, Gilles Bibeau passe en revue diverses conceptions du mal, s’arrêtant notamment à celles de Hobbes de Rousseau, de Nietzsche, de Freud et du théologien américain Reinhold Niebuhr. Si cette partie de son livre n’est pas la plus originale, elle a le mérite de se terminer par une mise en parallèle des thèses d’Hannah Arendt et de Günther Anders sur la question du mal. Nous nous y arrêtons parce que l’un et l’autre associent le mal à l’indifférence et parce qu’il nous semble que c’est dans le prolongement de leurs intuitions que la réflexion sur le mal doit s’orienter.
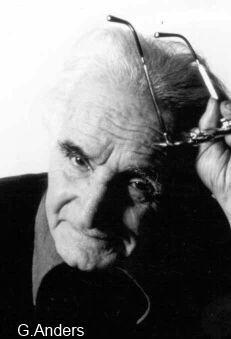 Günther Anders que l’on connaît mieux depuis la publication de L’obsolescence de l’homme fut le premier mari d’Hannah Arendt. Cousin de Walter Benjamin, ami de Berthold Brecht, collaborateur d’Herbert Marcuse, il fut aussi un élève de Heidegger, en même temps qu’Hannah Arendt.
Günther Anders que l’on connaît mieux depuis la publication de L’obsolescence de l’homme fut le premier mari d’Hannah Arendt. Cousin de Walter Benjamin, ami de Berthold Brecht, collaborateur d’Herbert Marcuse, il fut aussi un élève de Heidegger, en même temps qu’Hannah Arendt.
Cet homme qui semble avoir pris sur lui une grande partie de la responsabilité des bombes atomiques au point d’avoir honte d’être humain, n’était pas fait pour la carrière universitaire. Il a vécu en marge des grandes institutions du savoir…et du pouvoir. Le lieu principal de l’insertion du mal dans le monde actuel, il le voyait dans la disproportion entre la puissance de la technique et la faiblesse des moyens, intellectuels et affectifs, dont l’homme dispose pour en apercevoir les conséquences, les mesurer et les contrôler. À propos d'un Américain, un certain T., qu'il a vu en extase devant des machines nouvelles présentées dans une exposition, Anders écrit : « Il a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. Il a honte de devoir son existence au processus aveugle, non calculé, ancestral de la procréation et de la naissance, – à la différence de produits qui, eux, sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails. Source
La banalité du mal
À Eichmann et au livre Eichmann à Jérusalem que son procès a inspiré à Hannah Arendt, Chantal Delsol a consacré un article reproduit sur le site de l’Agora. « Ce livre, écrit-elle, a été un tournant dans la pensée d’Hannah Arendt sur la question du mal. Observant l’accusé et écoutant ses réponses, elle est d’abord étonnée de son inquiétante normalité. Mais que signifie ‘’ normal’’ dans ce cas ? Tout d’abord, les psychiatres avaient garanti qu’il n’était pas un fou. Mais surtout, chez lui n’apparaissait aucune de ces caractéristiques du pervers sadique : volonté de faire souffrir, cynisme affiché, mépris ricanant pour l’humanité. En réalité, « il était évident pour tous que cet homme n’était pas un ‘’ monstre ‘’, quoiqu’en dit le procureur ; et on ne pouvait s’empêcher de penser que c’était un clown » Eichmann avait bien une conscience, puisqu’il était révolté par le meurtre des Juifs allemands. Il n’avait pas l’intention de faire le mal, puisqu’il ignorait les catégories du bien et du mal, la seule norme qui comptait à ses yeux étant l’obéissance et la fidélité à l’État nazi. Hannah Arendt s’aperçoit que les commanditaires du nazisme n’étaient pas des sadiques « ils n’étaient pas assassins de nature », ils étaient de simples hommes ordinaires qui avaient obéi à des ordres, et ne comprenaient pas qu’on leur reprochât leur loyauté, considérée en général comme une vertu. « Cette normalité, conclut-elle, est beaucoup plus terrifiante que toutes les atrocités réunies », parce que cet homme ordinaire commet des crimes sans même le savoir. Ainsi découvre-t-elle ‘’ la terrible, l’indicible, l’impensable banalité du mal’’. » Nous pourrions tout aussi évoquer la terrible, l’indicible, l’impensable indifférence de l’auteur du mal.
 Nous sommes au début des années mil neuf cent-soixante. Günther Anders, qu’Hannah Arendt a rencontré à Munich à son retour de Jérusalem, après le procès d’Eichmann, réfléchissait à ce moment sur l’immoralité des pilotes qui ont largué les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. La notion de coupable sans culpabilité, bien proche de la banalité du mal, bien proche aussi de l’indifférence, de l’incapacité de se mettre à la place des victimes, s’est imposée à lui.
Nous sommes au début des années mil neuf cent-soixante. Günther Anders, qu’Hannah Arendt a rencontré à Munich à son retour de Jérusalem, après le procès d’Eichmann, réfléchissait à ce moment sur l’immoralité des pilotes qui ont largué les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. La notion de coupable sans culpabilité, bien proche de la banalité du mal, bien proche aussi de l’indifférence, de l’incapacité de se mettre à la place des victimes, s’est imposée à lui.
Anders entretient à ce moment une correspondance avec le major Claude Eatherly le pilote qui, depuis l’avion météo B-29, a donné le signal d’attaque de Hiroshima et Nagasaki. Cet homme n’a ni cherché ni trouvé une excuse dans le fait qu’il accomplissait son devoir de soldat : il s’est senti coupable d’un mal dont il n’était pas responsable, mais dont il ne pouvait s’empêcher d’assumer la responsabilité. En cela il a imité Œdipe qui après avoir tué son père, n’a pas cherché d’excuse dans le fait que dans la nuit il ne l’avait pas reconnu. Il faut préciser qu’Eatherly connaissait la mission qu’il remplissait. Peu après la guerre il s’est objecté à ce qu’on le considère comme un héros s’estimant responsable de la mort de centaines de milliers de Japonais. Il a fini par sombrer dans la folie.
On se croirait dans pièce de Shakespeare adaptée à notre temps ; c’est un fou qui, au milieu d’une humanité fière de ses Lumières, de son humanisme moderne et de ses droits de l’homme, dit la vérité. Dans l’une des plus belles pages de son livre Gilles Bibeau a rendu un hommage prophétique à ce fou :
«Le colonel Eichmann s'est déchargé, a noté Arendt, de sa responsabilité sur la machine à tuer dont il disait n'avoir été qu'un rouage; dans ses lettres à Anders, Eatherly a plutôt reconnu la machine comme le danger ultime pour la conscience et il a entrepris d'assumer la responsabilité de ce dont il n'était pourtant qu'indirectement coupable, à savoir les immenses conséquences de son acte. Anders a écrit que le pilote américain s'est efforcé de maintenir sa conscience en vie à l'âge de la machine et de refuser l'emprise sur l'humain de la technicisation de la guerre. Le «cas Eatherly» donne à penser tout en faisant frémir: il a été un anti-Eichmann qui fut rejeté et diagnostiqué fou, ce qui amène à croire que nous vivons dans un monde moral où la stratégie d'un Eichmann vient désigner, plutôt que celle d'Eatherly, la vérité du temps. Les déclarations d'Eichmann - «Je n'étais qu'un maigre rouage dans l'appareil » – ressemblent étrangement, écrit Arendt (2002), aux arguments que nous employons pour nous disculper: ‘’Ce n'est pas nous mais notre gouvernement qui a décidé de la guerre’’. Pour cette raison, il nous faut lire Günther Anders comme un complément à Hannah Arendt.»p.220
La responsabilité des savants
Qui donc, au XXème siècle, parmi les puissants, les savants et les philosophes a atteint l’altitude morale du major Eatherly ? On aimerait croire que ce fut le cas du physicien allemand Werner Heisenberg. Copenhagen, le film en forme de tragédie grecque évoquant le contenu vraisemblable de sa rencontre avec Niels Bohr en 1941, laisse place à une telle interprétation. Niels Bohr était le maître vénéré de Heisenberg, mais aussi le citoyen d’un pays occupé par l’Allemagne. Selon toute vraisemblance, Heisenberg souhaitait que Niels Bohr, toujours en contact avec les physiciens anglais et américains, réponde par un oui ou par un non à la question suivante : ses collègues d’Amérique travaillent-ils à la fabrication d’une bombe atomique ? Les deux amis se sont brouillés et Niels Bohr a rejoint ses collègues de Los Alamos en 1943 pour les aider à mettre la bombe au point. Heisenberg etBohr furent parmi les premiers physiciens à acquérir les connaissances requises pour fabriquer la bombe. On ne sait pas ce que Heisenberg et Bohr se sont dit l’un à l’autre. Il n’est pas exclu que Heisenberg ait eu comme projet de ne pas passer à l’action, dans l’hypothèse où ses collègues de l’autre camp aient fait preuve de la même prudence que lui. Un physicien allemand a peut-être songé à s’abstenir de fabriquer la bombe A. C’est hélas ! tout ce qu’on peut dire sur le sens des responsabilités des plus grands savants de notre époque. Les fusées et les drones qui peuvent déposer des charges nucléaires dans toutes les villes du monde ont reçu la même approbation de la nouvelle génération de savants.
Nos savants eux-mêmes ont emprunté la voie indiquée par Eichmann plutôt que celle d’Eatherly Ce qui illustre l’une des failles majeures de notre éthique aussi bien que de notre science. On les dégrade l’une et l’autre en les séparant l’une de l’autre. Les savants se sont déshonorés en se départissant de leurs responsabilités pour les remettre aux éthiciens et aux autorités politiques, lesquels s’en sont départis à leur tour en tant qu’individus, pour les remettre à des comités. Dans l’Allemagne de 1941, Heisenberg était le seul savant qui aurait pu fabriquer la bombe. Cela, il ne pouvait le dire à personne. Dans La nature dans la physique contemporaine, il a écrit : «Pour la première fois au cours de l’histoire, l’homme se trouva seul avec lui-même sur cette terre.» Solitude sur la terre, solitude parmi les hommes ?
Qu’est-ce qu’une recherche du vrai qui fait abstraction du bien et qu’est-ce qu’une science du bien qui fait abstraction du vrai ? Les Grecs ne se sont jamais résignés à cette séparation. C’est peut-être la raison pour laquelle leur science s’est arrêtée au seuil du progrès technique. Mais quel sera le bilan final de ce progrès, né de la séparation du vrai et du bien, si nous ne parvenons pas à le soumettre à une responsabilité digne de ce nom, ce principe de responsabilité défini par Hans Jonas. (Signalons que Jonas fut aussi de ceux qui ont rompu avec Hannah Arendt suite à la publication de son livre sur Eichmann.)
Parmi les pacifistes d’aujourd’hui comme d’hier, nombreux sont ceux qui misent sur des idéaux nouveaux ou rafraîchis pour échapper à l’insoutenable réalité d’un mal radical. Ce sont des rêveurs de ce genre qui, en 1919, ont cru pouvoir prévenir toute nouvelle guerre, en confiant à la Société des Nations le mandat d’imposer un arbitrage fondé sur de tels idéaux. Gilles Bibeau n’est pas tendre pour ces négateurs du négatif, qu’il appelle aussi les adeptes du tout positif. «Ce mythe du tout positif paraît faux dans ses prémisses mêmes, absurde dans sa croyance que l'élimination du négatif est enfin à notre portée, utopique dans son aspiration à la réconciliation universelle, irresponsable dans ses visées de totale harmonie politique, et carrément insupportable dans sa rhétorique aseptisée et déshumanisée.» p. 212
Le mal est radical, les idéaux dangereux car en incitant au refoulement du négatif, ils le font resurgir sous une forme plus violente encore. À l’époque d’Hiroshima, du terrorisme et de l’anti-terrorisme, il faut en outre, estime Gilles Bibeau, renoncer à la possibilité d’un humanisme éclairé.
Et après ? Bibeau est séduit par le projet d’un politique de civilisation proposée par l’anthropologue Michel Freitag : «Le souci fondamental de la « politique de civilisation » proposée par Freitag vise à restituer la « nature anthropologique » des êtres humains en prenant au sérieux leur capacité de construire des différences et de vivre dans des mondes singuliers et originaux. «La vraie richesse de l'humanité, ce n'est pas sa capacité de production économique et technologique, c'est sa capacité de produire du sens, de convertir en sens commun l'expérience toujours particulière de vivre. Or, la vie elle-même, le sens n'est Un qu'à travers le multiple » […]La définition des valeurs universelles s'impose, dans cette marche vers une autre politique de civilisation, comme une entreprise morale incontournable.» p.226
La plupart de ceux qui résistent à la mondialisation, qui s’insurgent contre la «standardisation d’une seule version de l’humanité» sont déjà engagés dans cette politique de civilisation. Cette politique ressemble à une révolution conservatrice, à une réhabilitation des traditions. N’est-ce pas ce qu’il faut entendre par «nature anthropologique»? L’ébauche qui en est présentée dans le livre est vague. Bien des questions importantes ne sont même pas posées. Quel sera la place du divin dans cette civilisation ? L’humanisme moderne se transforme sous nos yeux en transhumanisme, comment la nouvelle civilisation résistera-t-elle à cette tendance?
Je propose en conclusion une réponse à ces questions, avec l’espoir que Gilles Bibeau y voie une invitation à préciser, dans un prochain livre, sa pensée sur la modernité, l’humanisme et les valeurs universelles à définir.
L’impasse
Parmi les rares contemporains qui ont poussé le sens des responsabilités aussi loin que le major Eatherly il y a Simone Weil. Elle a aussi rejoint la grande famille de ceux qui, depuis saint Augustin au IIIe siècle jusqu’à Kierkegard au XIXe siècle, affirment que l’homme ne peut s’élever qu’en Dieu : «Tous les mouvements naturels de l’âme sont régis par des lois analogues à celle de la pesanteur. La grâce seule fait exception» 2
Nous verrons que sa conception de la grâce est bien différente de celle qui divisait les théologiens au temps de Pascal. Nous savons tous une chose que Gilles Bibeau confirme par sa critique des idéaux : le grand défi en éthique n’est pas d’indiquer des fins, des idéaux, c’est d’indiquer où et comment on peut acquérir l’énergie nécessaire pour s’en rapprocher. «Il faut faire telle chose, dit Simone Weil, mais où puiser l’énergie ? Une action vertueuse peut abaisser s’il n’y a pas d’énergie au même niveau.»3 C’est cette vérité d’expérience que traduit le proverbe : qui trop embrasse mal étreint. Les parents s’inspire de la même vérité quand ils disent à leur enfant : fais le de bon cœur ou ne le fais pas.
Le mot ressourcement nous met sur la piste de ce que Simone Weil entend par grâce. Sans ressourcement, sans accès à des sources d’inspiration élevée, on reste par terre, emporté par la force qui poussaient hier les Grecs contre les Troyens, et aujourd’hui les antiterroristes contre les terroristes.
Simone Weil précise pourquoi les idéaux réduits à eux-mêmes sont inopérants en tirant les ultimes conséquences de l’hypothèse moderne par excellence, celle qui consiste à présumer que l’être humain est soumis aux mêmes lois que l’univers dans son ensemble. Si l’univers est entièrement soumis à la force comme le pensent les physiciens modernes, Newton en tête, rien ne nous autorise à penser que l’homme peut se conduire selon d’autres principes. L’idée qui est au centre de l’humanisme moderne selon laquelle l’homme peut faire exception à la règle générale en se comportant selon la justice dans un monde dominé la force, est inconsistante à ses yeux. D’où ce jugement : «Il n'est pas concevable que tout dans l'univers soit soumis à l'empire de la force et que l'homme y soit soustrait, alors qu'il est fait de chair et de sang et que sa pensée vagabonde au gré des impressions sensibles. Il n'y a qu'un choix à faire. Ou il faut apercevoir à l'œuvre dans l'univers, à côté de la force, un principe autre qu'elle, ou il faut reconnaître la force comme maîtresse et souveraine des relations humaines aussi.»
Les traditions
Croire en Dieu équivaut pour Simone Weil à croire qu’il y a un principe autre que la force dans l’univers et que c’est ce principe qui est à l’œuvre dans le sentiment de la beauté du monde, lequel est une source d’inspiration, de grâce. Pour rendre plus clair encore ce qu’elle entend par grâce, Simone Weil utilise la photosynthèse comme métaphore. De même que le sucre, dont se nourriront ensuite les animaux conserve l’énergie solaire résultant de la photosynthèse, de même l’énergie provenant du soleil invisible se concentre suite à une photosynthèse d’un autre ordre, dans la vie et dans les œuvres des personnes inspirées. C’est le domaine de ce que Simone Weil appelle le grand art : Giotto, l’art roman, Homère, les tragiques grecs, Vélasquez, etc, mais aussi parmi nos contemporains, Arthur Koestler. Elle n’emploie pas l’expression grande pensée, mais elle rangerait dans cette catégorie les Évangiles, Platon, Marc-Aurèle, les Upanishad, le Livre des morts. Autant de sources d’inspiration fournissant l’énergie qui permet d’échapper à la pesanteur.
Une telle conception du Dieu transcendant et de la grâce est si étrangère aux hommes d’aujourd’hui, y compris les croyants, que je l’évoque uniquement pour indiquer à quoi pourrait ressembler un remède au mal situé hors du monde fermé de l’humanisme et de la modernité.
La dérive vers le transhumanisme.
Car dans ce monde fermé tout converge vers la transformation de l’homme, vivant imparfait, atteint en tant que tel du mal radical, en une machine parfaite. Après la seconde guerre mondiale, toutes les tentatives pour améliorer l’homme de l’intérieur, par les religions et les philosophies semblant avoir échoué, la tentation de le transformer et de le contrôler de l’extérieur par les sciences et les techniques a été très forte. Dans l’empire cybernétique, Céline Lafontaine, a par exemple montré comment la cybernétique prolongée par le behaviorisme et la théorie de Bateson sur la communication a visé cet objectif. Vivant dans ce climat, Günther Anders a évoqué la place importante que cette idéalisation de la machine occupait dans l’inconscient de ce nouvel homme qui deviendrait bientôt ce cyborg célébré par le transhumanisme. Dans ce contexte, le Meilleur des mondes de Huxley apparaît comme une œuvre qui décrit le monde actuel et non un monde à venir dans 600 ans ! Ce qu’on sait désormais sur l’accès des entreprises et des États à la vie privée de chacun donne à cette hypothèse une inquiétante vraisemblance.
Note
1 Gilles Bibeau, La généalogie de la violence, édition : Mémoire d’encrier, 2015.
2 Simone Weil, La pesanteur et la grâce, Plon 1948, p.1
3 Ibid. p.2





