Éducation: de l'anomie à l'unité du vivant
L'éducation: de l'anomie à l'unité du vivant
Suite à la crise étudiante appelée printemps érable qui a secoué le Québec il y a un an, on a annoncé que le 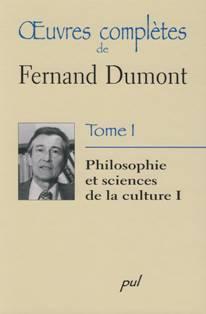 second numéro des Cahiers Fernand Dumont [1]porterait sur l’éducation. J’attendais ce numéro depuis des semaines et j’attendais beaucoup de lui, persuadé que l’œuvre de Fernand Dumont renferme le remède aux maux de nos écoles, persuadé aussi que le directeur des Cahiers, Serge Cantin et les éditeurs du numéro, Danièle Letocha et Frédéric Parent, sauraient rassembler des collaborateurs capables de dégager le message central de Dumont et de le présenter avec suffisamment de force pour qu’il devienne le ferment d’un consensus. J’en étais presque à rêver d’une refondation de l’éducation au Québec, rêve approprié aux circonstances puisque la publication de ce cahier coïncidait avec la tenue d’un Sommet sur l’éducation organisé par le parti politique auquel adhérait Fernand Dumont.
second numéro des Cahiers Fernand Dumont [1]porterait sur l’éducation. J’attendais ce numéro depuis des semaines et j’attendais beaucoup de lui, persuadé que l’œuvre de Fernand Dumont renferme le remède aux maux de nos écoles, persuadé aussi que le directeur des Cahiers, Serge Cantin et les éditeurs du numéro, Danièle Letocha et Frédéric Parent, sauraient rassembler des collaborateurs capables de dégager le message central de Dumont et de le présenter avec suffisamment de force pour qu’il devienne le ferment d’un consensus. J’en étais presque à rêver d’une refondation de l’éducation au Québec, rêve approprié aux circonstances puisque la publication de ce cahier coïncidait avec la tenue d’un Sommet sur l’éducation organisé par le parti politique auquel adhérait Fernand Dumont.
N.B. Je tiens à préciser tout de suite qu'il me sera impossible d’évoquer ne fût-ce que par une courte citation tous les articles du livre. Je le ferai toutefois dans la version Internet du texte.
Crise, anomie, suicide des jeunes
Il se trouve qu'un événement imprévu, la lecture d’un article de Jean Bédard sur l'anomie, m’a imposé une approche à laquelle je n’avais pas pensé et qui m’a semblé être la bonne. Jean Bédard, qui fut d’abord travailleurs social, a été pendant plusieurs années en contact étroit avec des victimes de première ligne de la crise scolaire : les jeunes délinquants. Il a fait sa marque dans la vie culturelle et spirituelle du Québec contemporain, en solitaire, par de grands romans historiques sur Maître Eckart et Nicolas de Cues. Le monde universitaire l’ignore et il le lui rend bien. Il m’a semblé qu'un rapprochement entre ces deux mondes serait bénéfique, pour l’un et pour l’autre, et vital pour l’ensemble de la collectivité. Ce rapprochement s’impose d’autant plus qu'aucun article du livre ne rend aussi bien compte du printemps érable que la réflexion de Jean Bédard.
Cette réflexion[2]m’a incité à élever la barre de mes exigences à un point tel que mon premier contact avec le monument de 450 pages intitulé l’Éducation en péril, a été marqué par la déception. Reprenant à mon compte la façon de voir de Jean Bédard, je pose cette question : Ces excellents auteurs qui usent et abusent du mot crise ont-ils compris que ce mot, quand il est employé à propos de l’éducation, signifie anomie? Ont-ils déjà été en contact avec des groupes de jeunes victimes de l’anomie? « Lorsqu’on entre en contact avec un groupe anomique, écrit Jean Bédard, par exemple un groupe de jeunes qui déboulent la gamme de toutes les drogues à travers les dérives du sexe et l’incapacité de nommer leurs émotions (faute de langage), on est surpris qu’il n’y ait pas plus de suicides. On les sent sans cesse sur le bord de vomir, de nous vomir, nous, la génération qui a failli à notre devoir de les protéger contre l’anomie au moins le temps nécessaire à la maturation d’un moi tant soit peu consistant. S’ils avaient eu un minimum à se mettre sous la dent... Ils ne peuvent même pas combattre leurs parents, ils en ont pitié ».©
Ma première réaction à ce texte a été universitaire. « Mon cher Jean, je viens de relire pour la troisième fois votre texte sur l'anomie. À ma première lecture, j'ai été déçu de ne pas y trouver d'allusion à Durkheim... puis je me suis abandonné au plaisir de le lire hors du contexte savant. […] Je n’ai jamais si bien compris l’anomie ». Je me souviendrai de la réponse de Jean Bédard : « Les mots, même le mot anomie, ne tournent pas autour de leur inventeur, mais suivent le destin de l’être humain. Ils évoluent avec nous. Je ne crois pas que Durkheim ait prévu que l’anomie serait l’état ''normal et banal'' d’une société, dans l’indifférence presque complète des intellectuels et avec la participation pleine et entière des cyniques et des professeurs de désespoir ».
L’anomie dont Jean Bédard déplore la mondialisation ressemble étonnamment à l’effondrement de la culture telle que la conçoivent Fernand Dumont et plusieurs des collaborateurs du livre.
« Lorsqu’on est, poursuit Jean Bédard, dans une réelle culture, une culture qui a du temps derrière elle, l’histoire, la géographie, la religion, la psychologie, la physique, la biologie, tous les domaines de l’expérience sont entrelacés et donnent une profondeur et une richesse extraordinaire à chacune des idées. Par exemple, l’idée d’amour devient infiniment riche, car même le cosmos est vu comme un acte d’amour. Tout cela s’est déposé et fixé solidement dans le lit de la rivière, et à cause de ce statisme, la tradition apporte une sécurité pour les êtres dont les ''moi'' sont encore dans l’opinion et la non-pensée.
Dès qu’une culture réelle (une culture qui a pris du temps à se produire) perd ses instruments de ''cohérence'' que sont sa mythologie, sa religion, sa cosmologie et surtout sa métaphysique, c’est-à-dire dès que les mondes physiques et spirituels se détachent l’un de l’autre, elle souffre d’une maladie quasi irréversible. Ce n’est plus qu’un tas de valeurs morales. Il n’y a plus de liant. Le surmoi ne donne plus de sens, mais uniquement des impératifs et des interdits. Il s’effondre comme un code civil sans amour du prochain, ou comme une charte des droits de la personne dans une population qui a perdu le sens des responsabilités. Chaque personne est aliénée de sa propre vitalité, on dirait des branches coupées de l’arbre ».
Réforme des institutions ou conversion des personnes?
Jean Bédard ne croit pas aux réformes de l’éducation dans le contexte d’une crise qui dure depuis si longtemps qu’elle est devenue la situation normale. « Pour ma part, nous dit-il, je préfère déterrer doucement, et un à un, quelques Professeurs d’espérance. Dans le vertige entre l’espéré et le fait, l’âme ressent une nausée parfois fatale, parfois salutaire : une tragique occasion pour une seconde naissance, personne par personne, petits groupes par petits groupes, jusqu’à la formation d’une nouvelle culture mondiale apte à faire face à la réalité ».
De Hannah Arendt à Fernand Dumont
 Faut-il donc abandonner les systèmes d’éducation à eux-mêmes? Le livre, une fois qu'il m’est devenu familier, m’a convaincu que la sollicitude pour ces systèmes n’est pas une chose vaine. On sous-estime toujours l’importance des institutions. Dans l’article clé du livre, Alain Kerlan, un universitaire lyonnais, ouvre une piste prometteuse en complétant sur la question de la crise de l’éducation la pensée de Hannah Arendt par celle de Fernand Dumont. On se souviendra que dans l’un des articles le plus souvent cité sur ces questions, article intitulé The Crisis in Education, Hannah Arendt souligne l’incompatibilité entre une éducation fondée par définition sur la tradition et l’autorité et une culture de masse tout entière tournée vers le présent et où l’on accorde plus de crédit, dans le domaine musical, par exemple, à une entreprise comme Apple qu'au passé de sa propre communauté.
Faut-il donc abandonner les systèmes d’éducation à eux-mêmes? Le livre, une fois qu'il m’est devenu familier, m’a convaincu que la sollicitude pour ces systèmes n’est pas une chose vaine. On sous-estime toujours l’importance des institutions. Dans l’article clé du livre, Alain Kerlan, un universitaire lyonnais, ouvre une piste prometteuse en complétant sur la question de la crise de l’éducation la pensée de Hannah Arendt par celle de Fernand Dumont. On se souviendra que dans l’un des articles le plus souvent cité sur ces questions, article intitulé The Crisis in Education, Hannah Arendt souligne l’incompatibilité entre une éducation fondée par définition sur la tradition et l’autorité et une culture de masse tout entière tournée vers le présent et où l’on accorde plus de crédit, dans le domaine musical, par exemple, à une entreprise comme Apple qu'au passé de sa propre communauté.
Il fut une époque dont plusieurs Québécois se souviennent encore où l’on se tournait vers les parents ou les grands parents pour s’initier à la musique. Une telle démarche paraîtrait bien saugrenue à la plupart des jeunes d’aujourd’hui. Ils appartiennent à une société de consommation de masse qui est aussi, indissociablement, démocratique. C’est donc la démocratie elle-même qui serait, selon Hannah Arendt, la cause première de la crise de l’éducation. Cela transforme des expressions comme « il faut démocratiser l’éducation! » en des paradoxes bien gênants pour ceux qui s’en satisfont. Alain Kerlan est d’avis que cette interprétation d’Hannah Arendt enferme la pensée dans un cercle vicieux, dont voici une autre formulation : « Dans le monde actuel, écrit-elle, le problème de l’éducation tient au fait que par sa nature même l’éducation ne peut faire fi, ni de l’autorité, ni de la tradition, et qu'elle doit cependant s’exercer dans un monde qui n’est pas structuré par l’autorité, ni soutenu par la tradition ».[3]
Alain Kerlan aperçoit une convergence entre les liens que Fernand Dumont et Hannah Arendt font de part et d’autre entre la crise de l’éducation et celle de la culture; il s’empresse toutefois de préciser que « l'angle d'analyse de Fernand Dumont s'avère différent et que cette différence ne se réduit nullement à quelques nuances : elle procède d'une autre lecture de la crise de la culture dans le monde moderne, et ne peut demeurer sans effet dès lors qu'il s'agit non plus de dire la crise, mais d'y faire face, d'y agir. C'est ainsi, tout du moins, que je comprends Dumont, et c'est pour mettre cette compréhension à l'épreuve que je m'autorise à proposer cette hypothèse : la crise de l'éducation selon Dumont, en tant qu'elle procède d'une crise de la culture, est une crise de la médiation, du passage, de la migration, de la reprise ».[4]
« Comment faut-il l'entendre? Une bonne piste peut être trouvée dans le passage de Raisons communes consacré aux humanités classiques. Il fait d'ailleurs écho à des analyses du Lieu de l'homme. En effet, dans ces pages comme dans celles du Lieu de l'homme, Fernand Dumont considère la valeur éducative des humanités classiques moins à l'aune de la valeur du passé qu'à celle de leur fonction structurelle : « C'est leur valeur de paradigme qui importe18», écrit-il. Aussi peut-il avec quelque crédibilité défendre l'idée d'un « humanisme nouveau » ou d'humanités nouvelles. « Il y a là, à mes yeux, une brèche décisive dans le cercle de l'autorité de et par la tradition, cercle où Hannah Arendt, ou du moins les lectures dominantes de Crisis in Education, ont tendu à enclore une question éducative qui est bien en effet la question décisive de notre monde, pour notre monde ». [5]
Ai-je bien compris? Ce n’est pas parce qu'elle appartient à un passé méritant en lui-même notre respect qu'il faut lire l’Antigone de Sophocle mais parce qu'elle illustre un paradigme dont nous avons besoin pour nous structurer, parce qu'Antigone est une médiatrice entre nous-mêmes et nous-mêmes. Question : si je trouve un tel paradigme dans un roman futuriste, pourquoi irais-je à sa recherche dans le passé?
Au commencement était la stylisation
Question complexe, dont il faut peut-être chercher l’élucidation dans la distinction, admirablement synthétisée par Alain Kerlan, que fait Fernand Dumont entre la connaissance et la stylisation.
D’abord la connaissance. Les connaissances, dont les données de la science sont le meilleur exemple, peuvent remplir le cerveau d’un enfant mais elles ne seront jamais les siennes. Cet univers explique Dumont, s’offre à nous sous le visage d’une énorme noosphère, d’un extraordinaire monde de l’esprit ou l’intelligence ne peut que s’étonner de ses propres merveilles. Mais cette noosphère est bien la nouvelle conscience de l’humanité, elle n’est guère en fait celle des individus en particulier. À quoi Alain Kerlan fait écho en ces termes : « A proprement parler, sur le plan épistémologique, la science moderne, en tant que connaissance constituée, n'est le discours de personne, et son langage ne relève pas de l'expression d'un sujet parlant. Il n'existe pas de "je" en première personne dont le savoir scientifique serait le discours proféré, et cette mise entre parenthèses ne saurait être levée. Comme l'écrit Dumont, ‘’ à mesure que la technique se développe en une conscience de plus en plus systématique, la conscience de l'homme concret en est expulsée’’ ».[6]
Ces connaissances qui sont en moi sans être à moi font naître le besoin de savoirs que je peux m’approprier : c’est le cas des paroles d’une chanson ou d’un poème, des figures d’une danse ou des caractères d’une langue. D’où l’importance de l’écriture manuscrite : Je peux donner un style à mon écriture. Le poème que j’ai appris par cœur et que je récite est devenu mien. J’aurais beau apprendre par cœur tout un manuel de chimie, aucune des formules qu'’il contient ne deviendrait mienne.
Dans la première partie de sa vie, Auguste Comte avait cru possible de faire de la science l’unique fondement de l’éducation. Sans doute a-t-il compris que la conscience de l’homme serait expulsée d’une culture ainsi acquise. D’où son retour, à l’art, à l’esthétique.
L’esthétique, lieu de la stylisation et du rapport au monde par les sens, sera donc la matrice de l’éducation. « Que signifie, écrit Alain Kerlan, cet enracinement de toute culture dans la sphère esthétique, y compris de la culture propre à l'âge positif, quelle signification lui accorder? La lecture de Dumont, arrivée à ce point ultime, me renvoie bien à celle d'Auguste Comte, celui de la « seconde carrière », et donne un nouvel écho à l'étrange proclamation du philosophe de l'âge positif, accordant le dernier mot, s'agissant d'éduquer, à l'art et à l'esthétique. Est-ce d'ailleurs si étonnant? Le premier Comte avait bien l'ambition de mettre fin à l'immense crise de la culture ouverte avec le temps des sciences, en tirant des sciences elles-mêmes toutes les voies et les fondements de la reconstruction culturelle, politique, éducative. Dans le langage de Dumont, on pourrait dire que l'œuvre du premier Comte prétendait procéder à la « reprise » intégrale de la culture sous la seule modalité de la connaissance. La « seconde carrière comtienne signe l'échec de cette entreprise, et du même coup la nécessité de la stylisation, même si elle s'y égare ».[7]
L’esthétique, les sens, le sens, la vie
L’esthétique c’est aussi l’expérience, c’est aussi la vie. S’il y a une cohérence dans ce livre, et il y en a une, c’est dans cette direction qu'il faut la chercher. La vie, on la trouve d’abord dans sa plénitude dans l’article d’Émile Robichaud, reflet parfait de l’école Louis Riel qu'il a fondée et dirigée au cours des décennies 1970 et 1980 et dont on regrette qu'Hannah Arendt ne l’ai pas visitée avant d’écrire Crisis in Education. En regardant les tableaux de maîtres sur les murs de cette école d’un quartier populaire de Montréal, elle aurait eu de beaux exemples de ces brèches vers le passé auxquelles il lui était si difficile de croire. Fernand Dumont, de son côté, aurait trouvé dans la même école de bonnes raisons de croire en son « humanisme nouveau » où l’on ne cultive pas le passé pour lui-même mais pour sa valeur de paradigme.
 Il faut d’abord recréer le tissu vivant. « Les écoles, écrit Robichaud, retrouveront le sens qu’elles ont perdu dans la mesure où elles retrouveront la vie et, pour ce faire, l’unité qui caractérise le vivant. Elles ont, en effet, littéralement éclaté sous la pression de l’approche mécaniste dont nous avons déjà souligné les ravages. Objets de changements de toutes sortes imposés de l’extérieur, elles ont perdu l’autonomie qui est le propre du vivant pour n’être plus que les rouages d’une machine ».[8]
Il faut d’abord recréer le tissu vivant. « Les écoles, écrit Robichaud, retrouveront le sens qu’elles ont perdu dans la mesure où elles retrouveront la vie et, pour ce faire, l’unité qui caractérise le vivant. Elles ont, en effet, littéralement éclaté sous la pression de l’approche mécaniste dont nous avons déjà souligné les ravages. Objets de changements de toutes sortes imposés de l’extérieur, elles ont perdu l’autonomie qui est le propre du vivant pour n’être plus que les rouages d’une machine ».[8]
On peut penser que ce ne sont là que des mots mais quiconque a visité l’école Louis Riel plusieurs fois, comme c’est mon cas, sait que la réalité correspondait à ces mots. Cette école avait vraiment une âme, un climat, un humus. Qui donc ose aujourd’hui parler d’âme, principe d’unité, à propos de l'école? À propos d’une université, la chose est tout-à-fait exclue. Émile Robichaud avait compris que ce n’est pas avec des mots comme système scolaire, programme, qu'on fait d’une école un jardin plutôt qu'une usine. C’est le mot symbiose qui résume le mieux son article : symbiose de l’enfant et de sa maison d’éducation, une maison autonome, elle-même en symbiose avec son milieu plutôt qu'aux ordres du politburo si bien décrit par Marie-Andrée Lamontagne. Symbiose de l’enfant avec le maître lequel a de l’influence; symbiose du même enfant avec le chef d’œuvre. L’art est la fine fleur de la vie, le chef d’œuvre la fine fleur de l’art. Le lien entre la vie et le chef d’œuvre est si fort que l’on peut affirmer sans hésiter qu'un milieu où l’on est indifférent au chef d’œuvre est un milieu mort
Des grands textes aux petits articles
« Dans l’appel de textes, écrit Robichaud, la direction des Cahiers posait la question suivante : « L’institution scolaire québécoise serait-elle devenue avec le temps prisonnière d’une conception instrumentale et utilitaire du savoir et de la culture? » Jacqueline De Romilly a mis en évidence le fait que cette « conception instrumentale et utilitaire du savoir et de la culture» a fait oublier l’éternelle pertinence de l’étude des grands textes pour la compréhension du monde et de la complexité des humains qui le façonnent. Rappelez-vous ces alexandrins de Racine :
Vous allumez un feu qui ne pourra s’éteindre
Craint de tout l’univers, il vous faudra tout craindre,
Toujours punir, toujours trembler dans vos projets,
Et pour vos ennemis compter tous vos sujets.
(Burrhus à Néron dans Britannicus)
Dépassée cette mise en garde adressée à tous les tyrans de l’histoire? Pourtant c’est ainsi, haïs de tous, que moururent Staline, Ceaucescu et, tout récemment, Mouammar Al-Kadhafi. Qui a dit que la culture classique était périmée? »[9]
Cet article d’Émile Robichaud devrait plaire à Jean Bédard : il est aux antipodes de l’anomie et de l’atonie aussi bien que de la monotonie du savant discours didacticien. Les règles du jeu universitaire combinées avec celles du marché du livre sont telles en effet que les auteurs à la mode en éducation, ceux qu'on a intérêt à citer, se succèdent par vagues de plus en plus courtes. Vouloir faire évoluer l’école au rythme de ces vagues est une autre excellente façon de la tuer. Le dernier pédagogue à la mode ne présente un intérêt particulier que si l’on fait l’hypothèse que l’éducation est une technique analogue à celle des téléphones dits à tort intelligents. Cette technique s’améliore de jour en jour. L’éducation est un art ayant intérêt à se rapprocher de l’éternité. Émile Robichaud, comme d’ailleurs la plupart des auteurs du livre, est d’une souveraine liberté à l’égard de la chaîne de montage qui alimente le marché des sciences de l’éducation. Dans ce contexte, Robichaud n’hésite pas à chercher consolation dans Sénèque : « Pourquoi ne pas nous arracher à l’étroitesse de notre temporalité première et partager avec les meilleurs esprits, ces vérités magnifiques et éternelles, quae immensa, quae aeterna sunt? »
Entre l’art qui ne progresse pas et la science qui n’est que progrès
Au cinquième siècle av. J.-C., c’est l’ensemble de la cité qui s’éduquait elle-même par ses chefs d’œuvre, ses sophistes et ses dialogues et surtout par son unité, sa cohérence. Qui oserait affirmer que cette paideia a été dépassée? Il y eut des progrès en éducation, dans les techniques d’apprentissage de ceci ou cela; il n’y a pas eu de progrès de l’éducation. S'applique tout aussi bien à l'éducation ce que Victor Hugo dit de l'art dans son Shakespeare. « La beauté de l'art, c'est de n'être pas susceptible de perfectionnement. Un chef-d’œuvre existe une fois pour toutes. Le premier poète qui arrive, arrive au sommet. Vous monterez après lui aussi haut, pas plus haut. Le chef-d’œuvre d'aujourd’hui sera le chef-d’œuvre de demain. Shakespeare change-t-il quelque chose à Sophocle? Cordélia dépasse-t-elle Antigone?... L'art n'est pas susceptible du progrès intérieur. De Phidias à Rembrandt, il y a marche et non progrès. Les fresques de la Chapelle Sixtine ne changent rien au métope du Parthénon. Les chefs-d’œuvre ont un niveau, le même pour tous, l'absolu. Cette quantité d'infini qui est dans l'art est extérieure au progrès... elle ne dépend d'aucun perfectionnement de l'avenir...
Tandis que la...« science cherche le mouvement perpétuel : elle l'a trouvé, c'est elle-même... Tout remue en elle, tout change, tout fait peau neuve... La science va sans cesse se raturant elle-même... Elle est l'asymptote de la vérité : elle approche sans cesse et ne touche jamais.... Hippocrate est dépassé; Archimède, Paracelse, Vésale, Copernic, Lavoisier sont dépassés. Pascal savant est dépassé, Pascal écrivain ne l'est pas...»[10]
Altitude et unité
L’appel à la vie, aux chefs d’œuvre, à l’unité, on le retrouve dans plusieurs autres articles du livre, dans celui de Marc Chevrier notamment, lequel en faisant la critique de la multiversité remplit la condition préalable à tout redressement : la recherche de l’unité. Dans la multiversité « il n’y a plus de liant », dirait Jean Bédard. Le regretté Michel Freitag a été, selon Marc Chevier, celui qui, sans la nommer comme telle, a fait au Québec la critique la plus originale de la multiversité. « Sa vision de l’avenir, si elle n’est pas sombre, fait apparaître la tâche à accomplir comme vertigineuse. L’université se trouverait selon lui devant l’alternative suivante : 1- revenir à son orientation humaniste et y subordonner toutes les autres tâches qu’elle doit remplir dans la société, quitte à abandonner à d’autres les recherches pragmatiques et utilitaires. 2- ou alors accepter que cette orientation lui échappe et soit et sera désormais réalisée ailleurs dans « de hautes écoles » par exemple.[11]
Marc Chevrier préfère quant à lui renouer avec l’esprit de la maison du Vieux Québec, cette faculté des sciences sociales où Fernand Dumont a fait ses débuts comme professeur. « Dans sa conception postmoderne, la multiversité est aussi une agence de moyens qui ne veut ni s’assumer comme institution, ni porter en elle une tradition intellectuelle, ni aspirer à un regard synthétique sur les savoirs, la société et le monde. Si elle se réclame de la raison critique, c’est souvent pour empêcher, paradoxalement, que l’université elle-même soit le conservatoire de quoi que ce soit. Karl Jaspers a déjà souligné comment il est difficile de justifier en démocratie le maintien dans l’université d’une haute tradition intellectuelle quand celle-ci paraît le fait de minorités privilégiées et du mérite. Devant une telle aporie, ou bien on se résigne à ce que la multiversité se voue à ses jeux de langage performatifs sans visée normative autre que de s’adapter indéfiniment à la société et au marché – la multiversité serait alors la fin de l’Histoire de la cité du savoir; ou bien, on renoue, comme le proposait Fernand Dumont, avec l’idée de tradition, mais sans nostalgie pour les mondes révolus par l’avènement de la modernité, en ce sens que la démocratie elle-même est devenue une tradition. L’avenir de l’université serait donc étroitement lié à celui de la mémoire et la culture ».[12]
Quand l’instrumentalisation se substitue à la stylisation
L’un des grands ouvrages de Fernand Dumont s’intitule L’anthropologie en l’absence de l’homme. Marcel Goulet, professeur de littérature au collège Édouard Montpetit, nous propose un article sur l’éducation en l’absence de l’homme. Son appel à la vie et aux chefs-d’œuvre prend la forme d’une critique claire et succincte de la pédagogie basée sur les compétences. « Au Québec, on a choisi, en 1994, lors de la réforme de l'enseignement au collégial, de lier l'enseignement de la littérature centré sur l'apprentissage de la lecture littéraire à l'approche par compétences. On a alors procédé à un découpage de l'activité de lecture en « éléments de compétence » soumis à des « critères de performance ». On a ainsi contribué à la mise en place et au développement d'une pédagogie que Jean-François Mattéi a qualifiée, à juste titre, de « procédurale ». Et, de la coup, on a exposé l'enseignement de la littérature à la menace d'une dérive vers le formalisme, une dérive qui mène à confondre les moyens de la lecture avec sa fin. Dans cette dérive, en effet, c'est moins la quête du sens et l'appréciation de la beauté des œuvres qui comptent que la maîtrise par le lecteur des outils de la lecture littéraire. Le texte littéraire y est transformé en un objet clos, fermé sur lui-même, qui est à lui-même son propre référent ».[13]
Certains auteurs n’ont manifestement pas compris que cette absence de style appelée style universitaire trahit un idéal de stylisation qu'ils semblent partager avec Fernand Dumont. On ne peut pas adresser ce reproche à Marie-Andrée Lamontagne, cette éditrice étant une excellente prosatrice. La voilà aux prises avec ce politburo, dont il faut obtenir le nihil obstat pour pouvoir publier un manuel scolaire destiné au programme éthique et culture religieuse. La bataille sera épique. Elle devra affronter successivement trois vagues de censeurs, les derniers, les didacticiens étant les plus scrupuleux.
« Manifestement, écrit-elle, ces gens-là ne comprennent pas que des textes littéraires se trouvent dans des manuels d'éthique et culture religieuse, et non uniquement dans des manuels de français. Chose plus préoccupante : cherchant dans les manuels que vous avez conçus le vocabulaire jargonneux avec lequel ils sont familiers et ne le trouvant pas, ils décrètent que le contenu du programme en est absent. Il vous faut alors expliquer, redire, traduire, démontrer, souligner à gros traits, négocier, pas à pas, ligne à ligne, mot à mot, dans une série de longs et épuisants allers-retours, et montrer que les notions du programme sont bel et bien abordées dans ces manuels qui ont choisi d'utiliser la langue française dans sa plus belle et simple expression, tout en mettant à contribution les classiques de la littérature chaque fois que l'occasion s'y prêtait ».[14]
Il faut croire que cette censure a son mérite, car le produit final semble avoir satisfait tout le monde, à commencer par les enseignants qui l’utilisent et Marie Lamontagne elle-même car elle a réussi à gagner son pari, faire pénétrer dans les écoles des textes littéraires, parfois choisis parmi les plus grands. Mais à quel prix? « Si les manuels Fides ont paru dans l'état qui est le leur, ce fut au prix d'un combat incessant qu'il vous a fallu livrer, votre collègue et vous, contre les évaluateurs du Bureau d'approbation du matériel didactique, dispensateurs d'un imprimatur profane mais tout aussi orthodoxe que dans sa version religieuse. Dans ce combat, l'usage pédagogique que tout naturellement vous faisiez de la littérature n'était pas recevable. Il vous a fallu faire la démonstration de son bien-fondé, dans un milieu qui aurait dû être le dernier à en douter ».[15]
La réinsertion de la vie dans un organisme gangrené n’a jamais été une chose facile. Les inquisiteurs de jadis brûlaient les auteurs d’ouvrages hérétiques, depuis il y eut progrès, ceux d’aujourd’hui font l’autopsie des œuvres avant de les publier.
Dans de nombreuses universités américaines, l’hostilité contre les chefs-d’œuvre est encore plus ouverte et sans doute plus efficace que celle de notre politburo. Voici le témoignage d’Andrès-Lema Hincapié à ce sujet : « Ainsi, une collègue du département des études hispaniques à Whitman College — sa directrice actuelle, peut-on imaginer plus grand malheur! — n'a que mépris envers les auteurs et les œuvres canoniques de la littérature espagnole. Sans vergogne, elle les ignore, ce qui la rend intellectuellement inapte à mener une discussion critique approfondie sur une bonne partie du canon. Il y a cinq ans environ, profitant, "sincèrement", de sa position de pouvoir, cette collègue anti-canon m'a fait cette remarque désobligeante à propos de mon enseignement de Don Quichotte :
"Y esta sera la ûltima vez que aquise ensene ese libro, parque es viejo, obsoleto y reproduce los estereotipos del hombre blanco, del colonizador y del heterosexual." [Et ce sera la dernière fois que l'on donnera un cours sur ce livre, qui est une vieillerie, — un roman obsolète qui reproduit les stéréotypes de l'homme blanc, colonisateur et hétérosexuel.] En faisant la sourde oreille aux recommandations d'Umberto Eco — un autre homme « blanc, colonisateur et hétérosexuel » — à l'effet d'enseigner les grandes œuvres, ma collègue de Whitman Collège esquivait le vrai défi auquel est confronté tout savant : au lieu d'appauvrir le canon (liste officielle des Great Books) à partir des jugements de valeur a priori, il est nécessaire de l'enrichir en montrant en même temps les limites et les grandeurs de telle œuvre ou de tel auteur, comparées à celles d'auteurs et de livres moins lus, moins réédités, moins connus et moins critiqués. Du reste, une université dont les départements d'italien et d'anglais n'enseigneraient plus les ouvrages de deux auteurs aussi « blancs » qu'« hétérosexuels » que Dante Alighieri et William Shakespeare, une telle université serait-elle seulement concevable? »[16]
Réelles présences
Dans L’éducation en péril, il y a plus d’unité que je ne le croyais au premier abord. Voici à propos de l’enseignement à distance via Internet, un autre appel à la vie, celui de Carol Collier et Rachel Haliburton : « notre corps doit participer au processus d'apprentissage pour que nous puissions saisir le monde et le contexte d'apprentissage; on ne peut tout simplement pas reproduire cela dans un milieu virtuel, où les esprits sont désincarnés.[17]
Jean-Jacques Wunenburger, mettant à profit une vie de réflexion sur l’imaginaire et les médias, s’inquiète d’abord « de ce que la main ne soit plus un organe scripteur dont la graphie constitue une véritable expression de soi », pour énoncer ensuite trois principes pour le bon usage des écrans, dont voici le premier : « d'abord, la situation d'apprentissage dans un environnement informatique devrait rester limitée pour favoriser d'autres situations et comportements éducatifs. La mécanisation et l'isolement du dialogue homme-machine doivent être contrebalancés par des conduites corporelles et socialisées, qu'elles soient à but cognitif ou ludique. Si l'ordinateur mobilise le cerveau gauche, propre au traitement de l'information en position immobile, à l'école de compenser en sollicitant le cerveau droit, qui ouvre sur la motricité, la sensorialité, les affects relationnels, les émotions partagées, etc. »[18]
Un fondateur en attente d’une fondation
Comment rendre justice à un tel ouvrage dont on découvre chemin faisant que chaque article présente un grand intérêt? J’ai déjà dépassé les limites raisonnables d’un commentaire et pourtant je n’ai pas encore dit l’essentiel. L’essentiel c’est l’effort fait par tous les collaborateurs de l’ouvrage, en particulier par Hélène Pelletier Baillargeon, Guy Rocher et Jacques-Yvan Morin, trois contemporains de Dumont, qui furent aussi de ses amis, non pour perpétuer la mémoire de cet homme, mais pour conserver sa pensée vivante et en faire une source d’inspiration pour les éducateurs d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes, au Québec, gérontophages et aristophages. Nous dévorons nos aînés et nos modèles. Les Français se souviennent des démêlés entre le petit père Combes et Charles Péguy, événements qui eurent lieu il y a plus d’un siècle. Au Québec, qui donc songerait à s’inspirer d’Édouard Montpetit ou de Marie-Victorin dans une réflexion sur l’éducation? Dix ans à peine après sa mort, quelle autorité Jean-Paul Desbiens, le grand artisan de la réforme de 1960, a-t-il conservée? Ces trois hommes ont le défaut à nos yeux de s’être trop identifiés au Québec traditionnel. Dumont se distingue d’eux sur ce point et par là se rapproche de ses compatriotes d’aujourd’hui et de demain. Le Québec en mutation fut sa déchirure : déchirure entre ses racines profondes dans son village natal de Montmorency et son enracinement volontaire dans la haute-ville de Québec et la culture savante. Cette déchirure et les ponts qu'elle appelle, il la retrouvera partout où il tournera son regard, ce que Alain Kerlan a parfaitement compris : « La crise de l’éducation selon Dumont en tant qu'elle procède d’une crise de la culture est une crise de la médiation, du passage, de la migration, de la «reprise ».[19]Si nous ne pouvons rien fonder de solide sur un tel homme et sur une telle œuvre, il ne nous reste plus qu'à nous laisser dériver vers un constructivisme désincarné et déraciné.
L’école et dans l’école, l’enseignement de l’histoire est à ses yeux la médiation par excellence. D’où l’importance des articles de Hélène Pelletier Baillargeon et de Julien Prud’homme, le second faisant apparaître le lien organique entre la pensée de Madame Baillargeon et celle de Fernand Dumont. Pour ce qui est de l’orientation à donner à notre enseignement de l’histoire, je doute qu'on puisse trouver un texte fondateur à la fois aussi concis et aussi riche que celui de Hélène Pelletier Baillargeon.
La vie se transmet par des racines. Il y a un lien étroit entre l’importance qu'il faut accorder à l’histoire et cet appel à la stylisation, à l’esthétique, au sens, à l’humanisme, à l’incarnation, à la vie qui fait l’unité du livre et la solidité de Dumont en tant que refondateur de l’école.
Deux passages de Dumont cités par Alain Kerlan ouvriront notre conclusion. « S’il est quelques caractéristiques de la culture actuelle, écrit Dumont, elle semble résider dans le sentiment d’un déchirement irréductible entre le monde du sens et celui des formes concrètes de l’existence ».
Et ici, il faut être attentif à la part de chacun, je cite Kerlan qui cite Dumont : « Au temps des sciences et des techniques, quand l’emporte la modalité de la reprise que Dumont nomme la connaissance, quand l’emporte sur la stylisation, ‘’qui est toujours reconquête d’un sens du monde[…]la réduction de ce sens à des procédés de rationalisation et de calcul,’’ alors, si ‘’malgré tout elle reste son lieu,’’ ‘’ la culture est moins que jamais la maison de l’homme’’ ».[20]
Par quel réenchantement pourra-t-on faire que la culture redevienne la maison de l’homme? La question du sens est celle de Dieu, la chose me paraît aller de soi dans le cas de Dumont, comme dans celui de Jean Bédard. Pour ce dernier toutefois le changement souhaité ne peut venir que d’une conversion personnelle à une spiritualité régénérée au contact de maîtres redécouverts dans leur authenticité. Qu'en était-il pour Fernand Dumont? Qu'en est-il pour les collaborateurs du livre? Pour ma part j’ai beaucoup de peine à croire que l’école laïque et nationale de Guy Rocher, qui est aussi celle dont on voit se préciser les contours en ce moment, puisse devenir la maison de l’homme; tout, il me semble, indique qu'elle s’identifiera au contraire de plus en plus aux procédés de rationalisation et de calcul. Si on en juge par la popularité du récent concours de robots dans les écoles, ces dernières risquent fort de devenir des maisons du robot avant de devenir celles de l’homme.
Rien n’interdit toutefois de chercher une solution intermédiaire entre les petits regroupements de convertis dont parle Jean Bédard (et qu'il contribue à créer) et le grand système voué au formalisme et au calcul. Cette solution pourrait être les hautes écoles dont a rêvé Michel Freitag.
[1] L’éducation en péril, Cahiers Fernand Dumont, Hiver 2023, sous la direction de Danièle Letocha et Frédéric Parent, Montréal, Fides 2013, 450 pages.
[2] Voir le site de Jean Bédard : http://www.prisme-asso.org/spip.php?article6057
[3] op.cit., p.153
[4] Op.cit., p.153
[5] Op.cit., p.153
[6] 0p.cit., p.172
[7] Op.cit., p.174-175
[8] Op.cit., p.186
[9] Op.cit., p.86
[10]Victor Hugo, Shakespeare, Paris, Nelson, Éditeurs p.99.
[11] L’éduction en pério, op.cit.,p.234
[12] Op.cit., p. 235
[13] Op.cit., p.107
[14] Op.cit., 75-76
[15] Op.cit., p.76
[16] Op.cit., 97
[17] Op.cit., 387
[18] Op.cit., p.376
[19] Op.cit., p.153
[20] Op.cit., p.172





