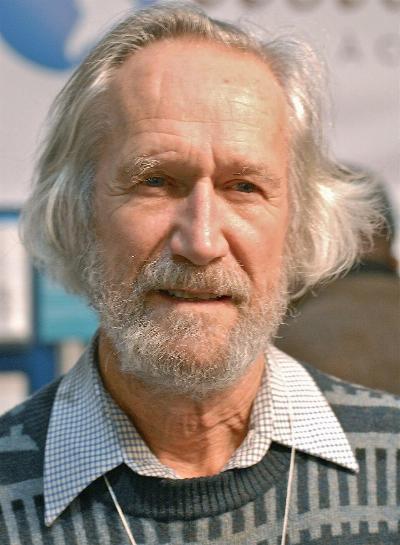La médecine au Moyen Âge
C'est au Moyen Âge qu'ont été fondés les premiers hôpitaux et les premières facultés de médecine. C'est au Moyen Âge également qu'on redécouvrit les grandes sources antiques, si importantes pour l'avenir. Ces sources furent retrouvées par l'intermédiaire des Arabes, plus particulièrement de deux philosophes qui étaient aussi versés en médecine, Avicenne et Averroès.
Mais c'est au Moyen Âge écologique que nous nous attarderons. Ce Moyen Âge écologique se confond avec celui des monastères. L'oeuvre colonisatrice et civilisatrice des moines, des cisterciens en particulier, est bien connue. Il suffit de quelques jours de voyage dans l'un ou l'autre des pays d'Europe pour sentir l'empreinte qu'y ont laissée les monastères. Beaucoup de gens ignorent cependant que cette oeuvre civilisatrice a été l'une des entreprises sanitaires les plus audacieuses et les plus réussies de l'histoire de l'Occident, non seulement parce qu'elle a apporté richesse et nourriture aux populations, mais encore parce qu'elle a éliminé bien des causes de maladies.
Les cistersiens, ces bénédictins réformés par Bernard de Clairvaux, se sont donné pour mission au XIIe siècle d'installer leurs monastères dans des vallées boisées et dans des régions marécageuses infestées de malaria. La renommée qu'ils acquirent en France dans la lutte contre cette maladie par la destruction des marécages fut telle qu'ils reçurent mission d'assécher la campagne romaine. On les invita ensuite à s'établir dans toutes les régions d'Europe.
La leçon qu'ils ont donnée à l'humanité va bien au-delà de ces succès mesurables, bien que ces derniers soient impressionnants, même selon les critères actuels. Ce sont les mobiles de ces moines qui doivent retenir notre attention. Quand ils contemplaient le site inclément destiné à accueillir un de leurs monastères, les Cisterciens avaient d'abord à l'esprit la beauté des lieux, une beauté qu'ils s'efforceraient ensuite d'adoucir par leurs travaux. Voici le commentaire que le site de Clairvaux, en Bourgogne, inspira à saint Bernard:
«Cet endroit a beaucoup de charme, il apaise grandement les esprits lassés et soulage les inquiétudes et les soucis; il aide les âmes en quête de Dieu à se recueillir, et leur rappelle la douceur céleste à laquelle elles aspirent. Le visage souriant de la terre y prend des teintes variées, la bourgeonnante verdure du printemps satisfait notre vue, et ses suaves senteurs flattent notre odorat... Et si la beauté de la campagne me charme extérieurement par sa douce influence, je n'en éprouve pas moins des délices in-times, en méditant sur les mystères qu'elle nous cache.»
Harmonie avec la nature
Dans le rapport harmonieux que les Cistersiens savaient établir avec la nature, René Dubos a vu un modèle pour notre époque technologique, dont les interventions sur le milieu vivant ont souvent manqué de sagesse.
Ils ont provoqué de profondes transformations du sol, des eaux, de la flore et de la faune, mais d'une manière assez sage pour que leur gestion de la nature restât le plus souvent compatible avec le maintien de la qualité de I'environnement. Pour se comporter d'une manière créatrice, l'homme doit se rapporter à la nature avec ses sens aussi bien qu'avec son bon sens, avec son coeur qu'avec ses connaissances. Il doit lire le livre de la nature extérieure et le livre de sa propre nature, afin de discerner les modèles qui leur sont communs et leurs harmonies.
La peste noire
Quelque bénéfique qu'ait été l'élan civilisateur du Moyen Âge pour la santé des populations, il allait pourtant être brisé par ces deux grands ennemis de l'espèce humaine que sont le rat et la puce. Le rat noir plus précisément, le mus rattus et la puce appelée xenopsylla cheophis, laquelle transmet aux humains le bacille de Yersin, cause de la peste.
Son origine se perd dans la nuit des temps... et des contreforts de l'Himalaya d'où elle semble avoir originé. La maladie s'est ensuite répandue au rythme des moyens de transport. Le cheval lui aurait fait faire un premier bond vers l'Afghanistan et la navigation vers le reste du monde. Elle sévissait dans le bassin méditerranéen entre les Vle et Vlle siècle. Elle semble avoir disparu au IXe siècle.
Elle se manifeste ensuite de façon continue de 1346 à 1720 à Constantinople, à Gênes, et dans toute l'Europe, du Portugal et de l'Irlande à Moscou. En Angleterre, de 1348 à 1377 la mortalité atteint 40% des habitants.
Elle est caractérisée par des poussées virulentes; on a identifié en France entre 1347 et 1536, 24 poussées principales, soit à peu près une tous les huit ans. En dehors de ces paroxysmes, la peste persistait à l'état semi-endémique, apparaissant capricieusement dans une rue, ou un quartier.
De 1536 à 1670, par contre, les poussées tombent à 12, à environ tous les onze ans. La maladie semble ensuite disparaître puis refait surface violemment en Provence en 1720. Quelques lieux et quelques dates: Londres 1603, 1625, 1665; Milan et Venise: 1576, 1630; Espagne: 1596, 1648-1677. Ce sont quelques points de repère. En fait, les épidémies s'étendirent à une grande partie de l'Europe. La peste ne disparut complètement qu'en 1721.
C'est l'année 1347 qui doit retenir ici notre attention. Un soir d'octobre, douze galères en provenance du port de Kaffa, en Crimée, se présentèrent dans le port de Messine, en Sicile. Ces galères étaient remplies de pestiférés. On les refoula, mais il était trop tard. D'autres équipages atteints du même mal avaient déjà laissé les traces de leur passage dans divers ports d'Italie. L'efficacité du bacille était fulgurante. À Messine, les premières victimes moururent quelques heures à peine après le passage des galères.
Si l'Europe avait été épargnée pendant des siècles, c'est parce que le mus rattus n'y existait pas. Ce rat étant revenu vers la fin du XlIe siècle, en tant que passager d'un autre bateau, le bacille de Yergin allait, à partir de 1347, disposer du vecteur dont il avait besoin pour conquérir toute l'Europe. En 1356, la peste s'éteignit à Kaffa, ayant accompli un cycle qui, selon Froissart, décima la tierce partie du monde.
Le Moyen Âge avait connu bien d'autres fléaux, la lèpre entre autres. Le grand élan vital qui caractérise cette époque fut cependant tel que les artisans construisirent les cathédrales et que les théologiens eurent le loisir de poursuivre la réflexion sur la santé et la maladie dont les Grecs avaient jeté les bases. Il serait fascinant d'étudier les rapports à travers l'histoire entre les grandes épidémies et le rebondissement créateur qu'elles semblent avoir provoqué.