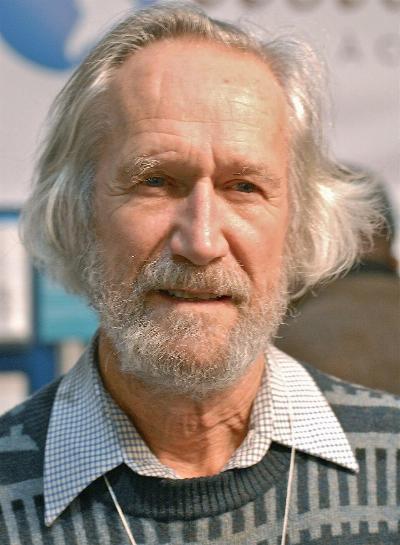Le cosmos selon Pythagore
Le Nombre est la loi de l'Univers
L'Unité est la loi de Dieu
«Pythagore fut le premier à appeler cosmos l'enveloppe de toute chose, à cause de l'ordre qui s'y trouve».
L'ordre et les nombres
En grec ancien le mot cosmos signifie ordre. Les Pythagoriciens croyaient que l'Un, l'Achevé, (qu'on peut identifier à Dieu) avait façonné un monde organisé, structuré, à partir d'une matière initiale qu'on appelait l'Inachevé, ou la Dyade, (deux).
L'homme vivait alors au rythme du Grand Tout, lui-même vivant, intelligent, doué d'une âme. Le mouvement des astres et le cours des saisons, telle une musique familière, marquaient le rythme du travail, du repos et des réjouissances. La Terre, centre du monde, était un parc enchanteur au sein duquel l'homme pouvait s'ébattre sous le regard bienveillant de Dieu.
On attribue souvent à Pythagore une théorie avant-gardiste selon laquelle la Terre, comme tous les autres astres, tournent sur une orbite circulaire autour d'un feu central, qu'il faut bien se garder de confondre avec le soleil. C'est le disciple le plus célèbre de Pythagore, Philolaos, qui, en réalité, est à l'origine de cette théorie. On a tout lieu de croire cependant que ce sont des considérations métaphysiques et non des raisonnements scientifiques qui ont ainsi amené Philolaos à devancer les astronomes modernes. Le cercle était pour les Pythagoriciens la forme parfaite, le symbole de la plénitude. La Terre et les autres astres créés par les dieux ne pouvaient être en conséquence que des sphères et leur orbite que des cercles à vitesse uniforme. Ce culte de la sphère et du cercle survivra à tous les autres aspects de la cosmologie pythagoricienne.
Pour les Pythagoriciens, une vision du monde excluant l'homme n'aurait pas été une vision du monde. À leurs yeux, l'homme était intégré au monde comme l'oeil à l'ensemble du corps. Le sens de l'existence humaine découlait de ce sentiment d'appartenance au grand Tout, lequel était appelé macrocosme (grand cosmos), par analogie à l'homme qui était considéré comme un microcosme.
On devine la joie du musicien qui, le premier, a tiré des sons harmonieux du chaos des bruits, de la cacophonie; et celle de l'architecte qui a créé les première proportions plaisant à l'esprit autant qu'à l'oeil. Tel était le sentiment de Pythagore devant l'univers. Derrière le mouvement ordonné des astres, il voyait le rayonnement de l'Un, de l'Achevé. Un mot résume cet émerveillement: «...Sans lui (le nombre), nous ne pourrions rien penser ni connaître». 1
Même si l'on sait que la pensée de Pythagore, qui elle-même a ses racines dans les plus vieilles traditions méditerranéennes, imprègne toute la pensée grecque, on ne la connaît que de façon indirecte. Elle n'est pas un ensemble de textes signés par Pythagore, mais une vision du monde qu'on doit reconstituer à partir d'indications attribuées parfois à Pythagore lui-même mais le plus souvent à l'un ou l'autre de ses disciples, dont les deux principaux sont Philolaos et Archytas.
On peut tout de même affirmer en toute certitude que chez Pythagore le mot nombre ne signifie pas chiffre ou numéro, mais plutôt proportion. Le mot grec aritmos, que nous traduisons par nombre était synonyme de logos mot qui signifie proportion, en plus de désigner dans d'autres contextes, la raison, la science, le langage ou la cause.
La science moderne nous aide à comprendre la thèse suivante: nous pouvons comprendre le monde parce qu'il a été fait selon le nombre. Les Pythagoriciens soutenaient également que c'est le nombre qui rend le réel accessible à nos sens, que c'est même lui qui leur donne un corps. Si mystérieuse que demeure pour nous une telle affirmation, nous pouvons en deviner le sens en pensant à la musique ou à un édifice bien proportionné, lesquels touchent d'autant plus nos sens qu'ils sont plus imprégnés de nombres. Nous pouvons aussi songer aux formules mathématiques qui rendent compte des rapports entre les particules atomiques dont la matière est constituée.
L'Harmonie des sphères
Voici l'instrument de musique le plus simple qui soit: une corde tendue sur une caisse de résonance. Si nous pinçons la corde dans toute sa longueur, nous entendons le son X. Si nous divisons la corde en deux et si nous pinçons l'une ou l'autre de ces deux moitiés, nous obtenons un son Y dont nous remarquons qu'il est en parfaite consonnance avec le son X. Il s'agit en réalité de l'octave. Il correspond au rapport 1/2. La quarte (sol) correspond au rapport 3/4, la quinte (fa) au rapport 2/3. D'où vient que les accords les plus beaux pour l'oreille correspondent aux rapports numériques les plus simples?
Émerveillé, Pythagore a fait l'hypothèse que tout ce qui est beau dans l'univers, et d'abord l'univers lui-même dans son ensemble, s'explique par des rapports musicaux entre des nombres.
Imaginons une corde de 1 m, une seconde de 50 cm, une troisième de 66 cm et une quatrième de 75 cm, au bout desquelles on aurait attaché une sphère. Imaginons ensuite qu'on fasse tourner ces quatres cordes simultanément et que le vent ou une autre force invisible pince tantôt l'une tantôt l'autre. Il en résulterait une musique analogue à celle qu'on peut tirer d'une corde tendue sur une caisse de résonance. C'est sans doute ainsi que Pythagore a été amené à faire l'hypothèse de l'harmonie des sphères.
Dans son univers, la Terre est une sphère autour de laquelle tournent en cercles concentriques le soleil, la lune, les cinq planètes alors connues — Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne — et la sphère des étoiles fixes. Les révolutions de ces astres produisent dans l'air des notes distinctes qui sont à l'orbite ce que les sons d'un instrument sont à la longueur de la corde.
Les Pythagoriciens faisaient en outre l'hypothèse que l'ensemble des intervalles entre les orbites étaient soumis aux lois de l'harmonie de telle sorte que le tout formait une immense lyre aux cordes circulaires produisant des sons agréables: l'harmonie céleste.
Quand on faisait observer à Pythagore que cette merveilleuse musique avait l'inconvénient d'être silencieuse, il répondait qu'il en est de l'harmonie des sphères à nos oreilles comme du bruit de l'enclume à l'oreille du forgeron: l'habitude nous empêche de l'entendre.
Puisque, pour un pythagoricien, l'univers ne pouvait être pensé sans l'homme, ni l'homme sans l'univers, l'harmonie universelle englobait les rapports des hommes entre eux et avec les divinités. La métaphysique était indissociable de la physique. Platon, lui-même pythagoricien, a formulé cette intuition dans les termes suivants: «les sages, ô Kalliklès, disent que l'amitié, l'ordre, la raison et la justice tiennent ensemble le ciel et la terre, les dieux et les hommes; voilà pourquoi ils appellent cet ensemble le Cosmos, c'est-à-dire le bon ordre». 2
Nous pensons aujourd'hui que le monde est non pas un ordre, mais un ensemble informe de forces auquel il nous appartient de donner une forme, opération que nous appelons transformer le monde. Les Pythagoriciens pensaient que c'est l'homme qui est un ensemble informe de forces et que par suite, avant de songer à transformer le monde, il doit s'imprégner de sa forme en le contemplant. Tel était le sens des longues années de silence, de méditation et de réflexion que Pythagore exigeait de ses disciples.
Notes
1. GOBRY, Ivan, Pythagore ou la naissance de la philosophie, Paris, Éditions Seghers, 1973, pp. 35-36.
2. GHYKA, Matila, C., Le Nombre d'Or, Paris, Éditions Gallimard, 1959, Tome 2, p. 12.