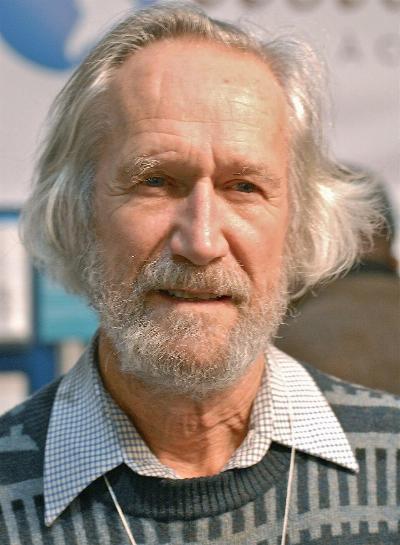Lawrence d'Arabie: irresponsable malgré lui
Un héros personnel dans une guerre d'empires.
Il ne s’est jamais pardonné d’avoir fait aux Arabes des promesses qu’il n’a pu tenir. «L'honneur, d'ailleurs, ne l'avais-je pas perdu, quand j'avais affirmé aux Arabes que l'Angleterre tenait ses engagements?»
Lawrence d’Arabie: irresponsable malgré lui.
 En novembre 1914, quand l’empire ottoman entra en guerre aux côtés des Allemands, un vent de panique souffla sur les colonies anglaises du Moyen Orient. Les autorités britanniques comprirent vite qu’elles avaient intérêt à inciter les Arabes de la région à la révolte contre l’occupant ottoman. Lawrence d’Arabie entra alors en scène. Le grand prestige dont il jouissait auprès des Arabes lui permit d’être le parfait intermédiaire. Leur souveraineté lui tenait autant à cœur que les intérêts de l’empire. L’Angleterre la leur promit et Lawrence d’Arabie transforma cette promesse en un engagement personnel auprès du roi Hussein, chef de la dynastie des Hachémites laquelle assurait la garde des lieux saints depuis des centaines d’années. C’est Hussein et ses fils qui dirigeraient la nouvelle confédération arabe.
En novembre 1914, quand l’empire ottoman entra en guerre aux côtés des Allemands, un vent de panique souffla sur les colonies anglaises du Moyen Orient. Les autorités britanniques comprirent vite qu’elles avaient intérêt à inciter les Arabes de la région à la révolte contre l’occupant ottoman. Lawrence d’Arabie entra alors en scène. Le grand prestige dont il jouissait auprès des Arabes lui permit d’être le parfait intermédiaire. Leur souveraineté lui tenait autant à cœur que les intérêts de l’empire. L’Angleterre la leur promit et Lawrence d’Arabie transforma cette promesse en un engagement personnel auprès du roi Hussein, chef de la dynastie des Hachémites laquelle assurait la garde des lieux saints depuis des centaines d’années. C’est Hussein et ses fils qui dirigeraient la nouvelle confédération arabe.
Ayant eu vent de cette promesse, les Français s’en inquiétèrent et exigèrent d’avoir leur part des anciens territoires ottomans. L’accord Sykes-Picot, conclu à Londres en mai 1916, leur donna droit au Liban et à la Syrie, l’Angleterre se réservant l’Iraq et la Jordanie. Lawrence allait-il renvoyer ses soldats dans leurs villages en leur révélant que ses promesses ne seraient pas tenues ? Il aurait ainsi trahi son pays.
Hussein eut à peine le temps de se réjouir de la déroute des Ottomans. En raison des promesses que lui avaient faites T.E. Lawrence, il était en droit de s’attendre à faire l’unité de sa région avec l’appui de l’Angleterre. Ibn Saoud, le pur et dur wahabite, l’avait toutefois devancé sur la voie de l’unité et quand il lui déclara la guerre l’Angleterre lui laissa les coudées franches, reniant ainsi les promesses faites par T.E. Lawrence.
(Aujourd’hui, l’État islamique occupe un territoire chevauchant la Syrie et l’Iraq artificiels de l’accord Sykes-Picot. Ces sunnites apparaissent comme des héritiers du fondamentalisme wahabite d’Ibn Saoud, fondateur du Royaume d’Arabie, en même temps que comme des descendants des terroristes qui occupèrent la Mecque en 1979 pour protester contre l’alliance des Saoudiens avec les Américains. Ce sont des sosies d’Ibn Saoud avant sa collusion avec les impurs d’Amérique.)
L’application de l’accord Sykes-Picotd brisa T.E. Lawrence. Il en ressentit une peine proportionnelle à la joie avec laquelle il avait profité de son charisme auprès des Arabes. Il n’avait que mépris pour Ibn Saoud. Avait-il flairé en lui le second Mahomet dont les fils financeront un jour le 11 septembre américain et sans doute bien d’autres exploits de ce genre?
À la fin de la guerre, il avait tenté d’échapper à cette tragique contradiction en incitant ses alliés arabes à occuper Damas, capitale de la Syrie, avant l’armée britannique. Il espérait ainsi amener les Français à renoncer à la Syrie. Ce plan du désespoir échoua. Lawrence ne s’en consolera jamais. Il avait eu des raisons de se croire surhumain, il se réfugia, comme pour expier cette démesure, dans ce que la condition humaine avait de plus humblement humain : le travail physique.
Que fait une personne responsable quand elle découvre qu’elle a trahi un peuple entier qui lui avait accordé toute sa confiance ? Elle en meurt de honte. Le passage qui suit, de Jacques Benoît-Méchin est tiré de Ibn Saoud ou la naissance d’un royaume.1 T.E. Lawrence y est longuement cité.
«Les Arabes étaient nos dupes, écrit Lawrence, et ils combattaient l'ennemi de tout leur cœur. Ils volaient au vent de notre volonté comme de la paille, et pourtant, ils n'étaient pas de la paille, mais les plus braves, les plus simples, les plus joyeux des hommes... Il aurait pu être héroïque d'offrir ma propre vie pour une cause en laquelle je ne pouvais pas croire; mais faire mourir les autres, sincèrement sur mon image sculptée, n'était qu'un vol — un vol d'âmes... J'ai dû posséder quelque tendance, quelque aptitude à la fraude. Je n'eusse pas sans cela, fraudé si bien, ni poursuivi pendant deux ans et fait aboutir une fraude que d'autres avaient conçue et mise sur pied. Je n'eus aucune part dans le début de la Révolte arabe; et à la fin, j'étais responsable des embarras qu'elle causait à ses inventeurs. A quel moment exact, dans l'intervalle, ma culpabilité, d'accessoire, était-elle devenue principale et à quel titre devais-je être condamné? Ce n'était pas à moi de le dire. Il suffisait que j'eusse amèrement regretté de m'être empêtré dans cette révolte assez amèrement pour me ronger aux heures d'inaction, mais pas assez pour couper mes attaches.»
Bientôt les plaintes ne suffirent plus. L'idée de sa déchéance le brûlait comme un acide, et commença à lui inspirer des idées de suicide. « En hâte je cloisonnai mon esprit, nous dit-il. L'instinct et la raison y étant comme toujours en bataille. L'instinct disait : « Meurs! » mais la raison disait que c'était là seulement couper la longe de l'esprit, le lâcher en liberté et le perdre. Mieux valait chercher quelque mort mentale, quelque lent gaspillage du cerveau qui le fît tomber au-dessous de ces énigmes. Un accident était plus bas qu'une faute délibérée. Si je n'hésitais pas à risquer ma vie, pourquoi faire tant d'embarras pour une salissure? La vie et l'honneur, cependant, paraissaient être dans des catégories différentes; aucun des deux ne pouvait payer l'autre. L'honneur, d'ailleurs, ne l'avais-je pas perdu, quand j'avais affirmé aux Arabes que l'Angleterre tenait ses engagements? Mes débauches de travail physique me laissaient inassouvi et le doute sans répit, la question incessante ligotaient mon esprit d'une spirale vertigineuse, qui ne me laissait aucun espace pour penser-. »
T. E. Lawrence mourut en 1935 des suites de ses débauches de travail physique.
1- Albin Michel, Livre de poche, Paris 1962, p.301-302.