La langue affranchie d'elle-même
Une image où l’on vous tire la langue, une mauvaise langue sortant déchaînée d’un trou noir, telle est la page couverture d’un livre, La langue affranchie [1]de Anne-Marie Beaudoin Bégin.
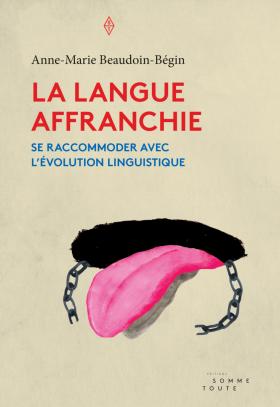 Cette page couverture m’indisposait à un point tel que je m’étais fait un devoir de démolir le livre sans m’abaisser jusqu’à le lire. De toute façon je n’aurais pas été en droit de le critiquer n’ayant pas été élu pour exercer cette fonction. D’une interview de Madame[2] au Journal de Montréal, j’avais en effet retenu cette citation. « T’es qui pour savoir de quels mots j’ai besoin dans mon quotidien? Pourrait-on au moins les élire ces gens-là? »[3]
Cette page couverture m’indisposait à un point tel que je m’étais fait un devoir de démolir le livre sans m’abaisser jusqu’à le lire. De toute façon je n’aurais pas été en droit de le critiquer n’ayant pas été élu pour exercer cette fonction. D’une interview de Madame[2] au Journal de Montréal, j’avais en effet retenu cette citation. « T’es qui pour savoir de quels mots j’ai besoin dans mon quotidien? Pourrait-on au moins les élire ces gens-là? »[3]
J’étais persuadé que cette révolte infantile contre l’autorité révélait l’essentiel du livre. Un sursaut d’honnêteté intellectuelle m’a tout de même incité à lire la préface endiablée de Matthieu Dugal. « Car oui, une langue, ça respire, ça transpire, ça rote, ça pète, c’est parfois déglingué, ça capote sa vie, ça radote, c’est lyrique. »[4] Lyrique vraiment ? C’est scatologique qu’on attendait. J’ai ensuite eu la curiosité de frapper à la porte du livre. J’ai été bien avisé car l’introduction est une allégorie sur la maison ancestrale de l’auteure, une maison passée de la cire à plancher appliquée rituellement chaque mois, au vernis, symbole de la modernité à laquelle la langue doit s’adapter, n’en déplaise à Mathieu Bock-Côté et Denise Bombardier, les cibles préférées de Madame l’affranchie. Oserai-je l’avouer, j’ai lu son livre avec plaisir, elle connaît son métier de linguiste, elle m’a appris deux ou trois choses, et elle a de la verve, ce prélude au style. A-t-elle du rythme ? Elle a de la cadence, ce qui convient mieux à ce souci de l’efficacité qui est son ultime critère en matière de style. Et elle ose faire aux règles anciennes, édictées par des non élus, des concessions qui rendent son texte intelligible, au risque de contredire son message libérateur.
C’est la pensée qui fait défaut chez elle, non la science, ni le bon sens, lequel lui donne souvent raison contre les puristes. Quant à ses têtes de souche (de turc serait du racisme), M. Bock-Côté et D. Bombardier, ce sont des essentialistes à ses yeux. Entendons par là qu’ils n’ont pas succombé à ces diktats de déconstruction, lesquels leur auraient permis de découvrir que « la langue française, comme le vert, n’existe pas. »[5] Ce ne sont que des concepts. Pour ce qui est du reste de la philosophie de madame, il s’agit d’un mélange de marxisme, de psychologisme, d’anticléricalisme, de misérabilisme et de progressisme.
Marxisme : l’autorité que s’arrogent les redresseurs de phrase, ces non élus, relève de la lutte des classes : « Les linguistes Laurence Arrighi et Isabelle Violette, de l’Université de Moncton, parlent « d’outil d’exclusion ». C’en est un. On se sert de la langue, ou de la non-maîtrise des règles, comme outil pour exclure, stigmatiser, ostraciser. […] C’est une lutte de pouvoir. »[6]
Psychologisme : Quand les correcteurs de fautes ne sont pas des agents du pouvoir, ils sont victimes de la compensation : « Mais le propre de certaines personnes insécures (sic) est de taper sur les gens qu’elles perçoivent comme étant plus « bas » qu’elles, pour se sentir supérieures. C’est bas, justement. »[7]
Anticléricalisme : Madame la linguiste n’aime pas le mot faute, il lui rappelle le confessionnal et la mainmise du clergé sur la morale en même temps que sur les classes de français. « Le parallèle avec la religion est tentant. […] Le terme faute est très parlant, également. Lorsqu’on ne respecte pas les préceptes écrits dans la Bible-Dictionnaire, on commet une faute. » [8]
Misérabilisme. Ce mot est peut-être excessif, car madame Beaudoin-Bégin éprouve une véritable compassion pour les humiliés de la langue. Jean-Paul Desbiens, pour lequel elle n’a pourtant que mépris, l’avait toutefois devancée sur ce point. Reprendre[9] son père à table est une faute qu’il ne s’est jamais pardonnée. Si les Québécois avaient senti un abus de pouvoir chez ce redresseur de langue, auraient-ils été plus de 100,000 à acheter les Insolences du Frère un tel. Cet abus de pouvoir, tout indique que les Québécois ne l’ont pas davantage senti chez la plupart des éducateurs (religieux et religieuses) au nom desquels Desbiens parlait. Sur ce point précis de l’apport de l’Église à l’apprentissage du français au Québec, madame Beaudoin-Bégin fait preuve d’incompétence en tant qu’historienne de la langue.
J’en reste au mot misérabilisme à cause de l’atmosphère marxiste qui enveloppe la compassion de madame. Il s’agit hélas d’un misérabilisme teinté de nihilisme, si l’on veut bien entendre par ce mot le fait de tourner le dos résolument à la beauté. Mme Beaudoin-Bégin reconnaît que la langue française a mérité son heure de gloire. Elle cite à ce propos Marc Fumaroli, l’un des écrivains français contemporains les plus raffinés :
Il n’empêche que madame préfère les systèmes de communication aux langues civilisatrices :« On a donc laissé le français évoluer pour qu’il réponde à ces besoins, en le rendant « beau » et prestigieux. Ce n’est pas surprenant qu’il soit l’une des langues les plus normées et qu’encore beaucoup de ses locuteurs le croient meilleur pour exprimer les nuances et la beauté.
Mais ces besoins d’esthétisme ont aujourd’hui été relégués aux oubliettes par d’autres besoins. Des besoins d’efficacité, de rapidité, de rendement. On veut tout, tout de suite, maintenant. Qu’on aime ou pas, les faits demeurent : les nuances et l’esthétique, si chères aux aristocrates des temps passés, ne sont plus de mise. »[11]
Il faut certes tenir compte de ce fait, et vue sous cet angle la langue affranchie est un bel exercice de lucidité, mais pour quelle raison transformer ce triste fait en une valeur à laquelle il faudrait s’adapter? Une seule raison se dégage du livre : Mme Beaudoin-Bégin professe un progressisme qui s’accorde très bien avec son marxisme : tout état de fait nouveau est supérieur à l’ancien tout simplement parce qu’il lui est postérieur.
Si la beauté n’est plus de mise, cessons d’enseigner les langues et passons directement au système de communication le plus efficace : le binaire. Ces ''moi"informes qui se replient sur eux-mêmes plutôt que d’avoir l’humilité de se laisser former par la langue des Lumières témoignent soit d’un état dépressif soit, ce qui revient au même, d’un glissement vers l’inerte, le mécanique. Les robots n’ont pas à s’élever jusqu’au génie d’une langue, ils ne parlent et n’écrivent qu’en binaire, les phrases qu’ils parviennent à synthétiser ne sont pas les effets de la créativité des vivants mais ceux de la correspondance entre des séquences binaires et des mots préfabriqués. À voir la façon dont nos gouvernements détournent les jeunes de la culture pour les pousser vers l’avenir des robots, on se demande s’ils croient encore à leur avenir parmi les vivants!
Vers les robots, avec le métissage, la « chiaquisation » ou la créolisation comme transition, pourquoi s’en inquiéter puisqu’aux yeux de Mme Bégin, ces chaos dans lesquels nous aurions sombré sans l’Église, n’existent pas plus que la langue française et le vert, ce ne sont que « des opérations de l’esprit. » On voit apparaître ici un nominalisme semblable à celui des théoriciennes des LTGBQIA2S. Il n’y a plus de sexe, il n’y a que des états individuels dans un continuum, il n’y a plus de langues, il n'y a que des mots que les locuteurs affranchis combineront entre eux dans un charabia multiculturel.
Tout au long de son livre, Mme Beaudoin Bégin associe la soumission des Québécois à la grammaire à la peur de l’étranger, autre généralisation sans fondement. S’il est vrai que la mondialisation incite les jeunes québécois d’aujourd’hui à découvrir le monde, il est tout aussi vrai que dans les générations précédentes, il y eut des armées de missionnaires, et avant eux des milliers de coureurs des bois.
Mme Beaudoin-Bégin a la plus grande admiration pour cette page de Mathieu Handfield :
«On est au meilleur temps pour partir, Dave, faut le faire là, faut partir là, straight maintenant, parce que, deux raisons, si on attend, on va perdre l’idée, comme le fil genre, on va perdre la drive puis on le fera jamais, puis deuxièmement, si on attend, ben il va être trop tard, on va manquer la saison, tu comprends, parce que personne va en acheter si on manque la saison, fait qu’il faut qu’on déguedine, Dave, faut qu’on déguédine d’icitte, parce qu’on a pogné le fond, le fond de ce dans quoi on est, on l’a pogné, on y touche pis là va falloir se donner une swing, Dave, mon gars, une grosse swing puis qu’on remonte, mais pas juste qu’on remonte là où c’est qu’on était. »[12]
De grâce madame, cessez d'enfumer nos esprits, vous nous feriez regettrer l'abbé Blanchard, curé de Weedon et linguiste à La Tribune de Sherbrooke, il y a un siècle. Il détestait d'autant plus les emprunts à l'anglais qu'ils étaient souvent associés à des fumées qu'il avait en horreur. «Le train bondé de voyageurs et chargé de marchandises crache l’anglicisme en même temps que sa noire fumée puante de charbon.»
Suite des leçons à tirer de La langue affranchie dans un second article intitulé Le français, de la défense à l'enthousiasme.
[1] Éditions Somme Toute, Montréal 2017
[2] Les prénoms et noms de famille composés posent aux écrivains un problème que le législateur n'avait pas prévu: ils sont trop longs pour qu'on puisse les répéter sans alourdir le texte. Faut-il les remplacer par un sigle ? Dans le cas présent cela donnerait AMBB, ce qui me paraît irrévérencieux. Comme le mot auteure me paraît ennuyeux, j'ai opté pour madame, que je remplacerai à l'occasion par Mme Beaudoin-Bégin.
[3] http://www.journaldemontreal.com/2017/04/07/vive-le-francais-libre
[4] A-M. Beaudoin-Bégin, op.cit. p.10
[5] Ibid., p.22
[6] Ibid., p.18
[7] Ibid., p.71
[8] Ibid., p.27
[9] « Or il arrivait que mon père déformât certains mots dans la conversation. L’un des mots qu’il abimait
c’était «bombarder». Nous étions pendant la guerre et un terme comme celui-là revenait souvent dans les conversations. À un moment donné, je lançais bombarder. Mon père disait bombarber. Ce fut la goutte d’eau. Mon père n’en pouvait plus. Il se mit à pleurer. […] Instantanément, j’ai compris mon crime. » Jean-Paul Desbiens, Sous le soleil de la pitié, Éditions du Jour, Montréal 1965, p.36)
[10] A-M.Beaudoin-Bégin, op.cit. p.95
[11] Op.cit., p.96.
[12] Op.cit., p.93






