Peut-on renoncer à sa vie privée ?
La vie privée exige des espaces privés. Les nouveaux médias les suppriment. Faudrait-il donc cloîtrer les maison, les écoles, les villes, les nations pour brouiller les ondes qui, en ce moment les transforment en des lieux communs, au détriment du bien commun, lequel suppose une liberté ayant besoin de solitude ?
- Que perdrions-nous en perdant notre vie privée ?
- Cette structuration binaire fondamentale de l’espace vécu est-elle universelle ?
- En quoi notre vie privée serait-elle menacée ?
- Le monde numérique menace-t-il l’existence de la vie privée ?
- La voie totalitaire
- Le sens de la résistance au nom de la vie privée
Rappelons-nous le début des années 2000. Nous vivions dans une atmosphère de libération liée à l’accessibilité de l’informatique, et à l’apparition continuelle de nouveaux outils numériques. Cela signifiait un immense élargissement de nos possibilités de choix – choisir son matériel, son système d’exploitation, ses logiciels (souvent téléchargés gratuitement), choisir de « naviguer » où bon nous semble, de communiquer, de nous exprimer à l’échelle du monde sur Internet, etc.
Mais moins d’une décennie plus tard l’atmosphère avait bien changé. On était passé d’une culture informatique de la confiance à une culture informatique de la défiance.
N’importe qui peut savoir ce que vous faites sur votre ordinateur connecté si vous ne mettez pas des dispositifs de sécurité. Il faut toujours mettre à jour les logiciels pour combler des failles de sécurité qui n’arrêtent pas de s’ouvrir. Ce qui n’empêche pas que nous constatons de multiples traces d’utilisations non consenties d’informations nous concernant – comme la réception de publicités ciblées.
Finalement, l’impact le plus significatif de ce qu’on appelle la révolution numérique ne serait-il pas le recul, voire la perte de notre vie privée ?
Et pourtant nous participons à peu près tous activement au développement du numérique …
N’est-il pas temps de nous poser la question de la valeur de notre vie privée ?
Que perdrions-nous en perdant notre vie privée ?
Le mot « privé » vient du latin privare qui signifie originellement « séparer », « mettre à l’écart ».
Du coup le latin privus est ambivalent car il signifie à la fois, ce qui est propre à un individu, et le fait qu’il soit privé de quelque chose.
Ce qui amène à interpréter le qualificatif « privée » accolé à « vie » comme cette part de la vie qui n’appartient qu’à soi, et c’est là sa face positive, mais qui n’est telle que parce qu’elle est privée de quelque chose.
Privé de quoi ?
De la vie publique, celle où l’on est confronté à tous les profils humains qui composent une société, et avec lesquels on doit se mettre d’accord pour vivre ensemble.
L’opposition entre public et privé remonte à l’antiquité grecque et exprime fondamentalement une structuration de l’espace.
L’espace public est celui de la vie sociale et de la politique ; l’espace privé est celui de l’habitation et de ses dépendances (la maisonnée) qui permet de satisfaire aux besoins d’entretien et de reproduction de la vie.
L’espace public est ouvert, l’espace privé est fermé pour qu’il ne bénéficie qu’à ceux qui y habitent. C’est pourquoi on en contrôle souverainement l’accès. Il est donc a priori soustrait à l’intrusion des pouvoirs sociaux.
Ainsi la vie privée implique une partition contraignante de l’espace ouvert de la planète, contraignante parce qu’elle est une restriction de la liberté de déplacement.
Mais, du point de vue des Anciens (grecs et romains) – et c’est ce dont rend compte l’étymologie – en notre espace privé, on est en effet privé de l’expression de la liberté propre à l’homme qui se réalise dans l’espace public par l’action politique. Car, nous dit Aristote, « l’homme est un animal politique », c’est-à-dire qu’il réalise son humanité en s’investissant dans l’espace public (comme nous le faisons en ce moment). Ce que ce philosophe justifie par la capacité de langage propre à l’homme qui lui permet d’intervenir dans l’espace public, là « où l’on décide du bien et du juste ».
Ainsi la vie publique, en laquelle s’épanouit la parole humaine pour définir le bien commun en fonction duquel on est d’accord pour vivre ensemble, et donc pour se donner des règles communes, serait la véritable finalité de l’existence humaine.
La vie privée apparaît alors n’être que relative à la vie publique : elle n’en est que le moyen nécessaire. Elle n’est pas une valeur en soi. Après tout, nos besoins vitaux ne nous apparentent-ils pas à l’animal ?
Pour mettre en perspective cette conception si clairement hiérarchisée de la partition vie publique/vie privée léguée par l’Antiquité, il faut se poser la question de son universalité : la retrouve-t-on toujours et partout ?
Cette structuration binaire fondamentale de l’espace vécu est-elle universelle ?

La partition spatiale selon l’opposition privé/public, établie par les Grecs et adoptée par les Latins, apparaît liée à l’histoire de l’Occident.
Mais ce que l’on peut constater, toujours et partout, c’est le besoin des humains de matérialiser un espace de confiance dont ils marquent et contrôlent la limite qui le circonscrit, par opposition à l’espace ouvert aventureux et risqué. Cela se retrouve même dans le camp provisoire du nomade ou chez nos campeurs estivaux.
Pour exprimer cette généralité, nous pouvons parler d’une loi anthropologique de partition de l’espace entre un « espace d’habitation », fermé, et un « espace aventureux », ouvert.
Il faut alors prendre en compte que, suivant les époques et les lieux, il y a de grandes variations dans la caractérisation de cette opposition entre deux espaces.
En extension, l’espace d’habitation peut être, comme aujourd’hui, ajusté à la cellule familiale, mais aussi se dilater jusqu’à la communauté, selon la définition qu’en donne l’allemand Tönnies (1887) : « Tout ce qui est confiant, intime, vivant exclusivement ensemble est compris comme la vie en communauté ». Les microsociétés dites « premières » (comme en Amazonie), mais aussi les unités villageoises traditionnelles ont ce caractère d’espace communautaire d’habitation protégé.
Est frappante alors la relation inverse qui s’établit entre l’extension de l’espace d’habitation, et la valorisation de l’espace aventureux – plus le premier est élargi, plus on se défie du second. Pendant tout le Moyen Âge, et jusqu’au XVIIIème siècle, en Occident, hors des limites du village, ou des fortifications du château, l’espace est considéré comme le réservoir de tous les dangers – bêtes féroces, bandits de grands chemins, soldatesque en transit, etc. D’ailleurs, c’est aussi l’espace des déclassés : mendiants et vagabonds, bandits de grands chemins, etc. Ce qui amène à noter que ces espaces privés élargis correspondent à des structurations sociales fortement hiérarchisées, avec une quasi impossibilité de mobilité sociale. Ce qui se comprend : l’espace aventureux est d’autant plus investi qu’il ouvre des possibles.
En contrepoint, là où l’espace d’habitation est réduit à la famille, même élargie (souvent aux 3 générations co-vivantes) – par exemple chez les Grecs et les Latins, mais aussi, avec l’époque moderne, la maison ou l’appartement bourgeois, l’espace extérieur devient espace public, avec possibilité de mobilité sociale et est, en cela, fort investi. C’est là que le maître de maison réalise l’essentiel de sa vie, c’est bien pourquoi la capacité à sortir de l’habitation, qui est alors, au sens propre, un domaine privé, devient une revendication de ceux qui lui étaient traditionnellement soumis, les femmes et les jeunes gens.
Or, cette espèce de loi de relation inverse, étonnamment, ne se vérifie pas pour notre époque moderne. Bien que l’espace d’habitation soit en général réduit à sa plus simple expression, celle de la cellule familiale basique, voire de la famille monoparentale, l’espace qui lui est extérieur est l’objet d’un investissement ambivalent. Certes il est toujours investi comme un espace public rendant possible une mobilité sociale, mais il est aussi vécu très négativement comme source de dangers pour sa vie privée.
Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui pour qu’on en vienne à se poser le problème de la sauvegarde de sa vie privée ?
En quoi notre vie privée serait-elle menacée ?
Par rapport à ce que nous avons déjà vu, il faut d’abord s’interroger, qu’elle est cette vie privée qui serait menacée ? A-t-elle quelque chose de commun avec la vie privée des grecs ?
Oui, en ce qu’elle correspond à l’unité d’habitation familiale.
Mais l’exigence de l’entretien et de la reproduction de la vie ne se posent plus du tout de la même manière. Elle est considérablement allégée dans notre société qui crée toujours plus de robots techniques pour accomplir les tâches quotidiennes, tout en mettant à disposition une abondance de biens nécessaires à la vie.
Dès lors que les besoins vitaux sont aisément assurés, n’est-il pas inévitable que, sa fonction fondamentale étant beaucoup moins impérieuse, la vie privée perde de sa sacralité ?
Au fond, comme l’avaient montré les Grecs, le domaine privé est d’abord le domaine de la nécessité, alors que le domaine public est celui de la liberté. À partir du moment où la pression de la nécessité diminue, il est normal que l’espace privé se restreigne et devienne beaucoup plus poreux à l’espace public.
C’est ainsi que, depuis quelques décennies, le quidam n’a eu aucun scrupule à ménager des entrées de l’espace public dans son espace privé – la radio, la télévision, le téléphone, le minitel, Internet, et maintenant le smartphone, soit la connexion permanente à l’espace public grâce à un terminal portable.
La régression actuelle de la vie privée n’est-elle pas le signe d’une libération de l’humanité (au moins en partie) de son asservissement immémorial aux nécessités naturelles ?
N’est-ce pas ce qu’illustre d’ailleurs le mouvement de libération des femmes qui auparavant étaient assignées dans l’espace privé ?
À ce stade on entend l’objection : c’est précisément Internet qui est en cause parce qu’il collecte des tas de données sur nous, que nous réservons à notre domaine privé, sans notre consentement, et dont il est fait un usage intéressé qui nous échappe, etc.
Notre participation au monde numérique ne menace-t-elle pas l’existence même de notre vie privée ?
Le monde numérique menace-t-il l’existence de la vie privée ?
Le monde numérique, en lequel nous sommes fortement sollicités à nous inclure, n’est-il pas la manifestation d’un pouvoir qui ambitionne de prendre un contrôle total sur notre personne, même dans sa vie privée, autrement dit un pouvoir totalitaire ?
Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se rappeler qu’à l’origine le monde numérique n’a été en aucun cas un projet de pouvoir totalitaire venant d’une caste dominante.
Le développement de la technologie informatique comme une multiplicité d’ordinateurs personnels connectés en un réseau global est né d’initiatives d’individus qui n’avaient ni capitaux, ni visée affairiste, ni positions de pouvoir, mais le savoir, la compétence intellectuelle et la curiosité d’explorer des voies techniques inédites et qu’ils jugeaient libératrices. C’est ainsi que, de naissance, Internet est un réseau de communication décentralisé, et qu’il s’est manifesté, pendant ses premières années, comme société alternative de solidarité et de partage, dans une organisation parfaitement sauve de pouvoirs dominant.
Or, cette technique de communication numérisée en réseau a une capacité remarquable : elle abolit l’espace ! Sur un terminal connecté vous communiquez aussi bien pour séduire un(e) éventuel(le) partenaire sexuel(le), que pour participer à un débat politique, acheter ou vendre quelque bien, et ceci où que soient géographiquement les interlocuteurs. Et vous communiquez dans l’immédiateté : ils sont là, en présence numérique. Autrement dit, vous êtes dans un espace qui annule la structuration à laquelle depuis toujours vous vous référiez en opposant espace privé et espace public.
Du point de vue des pionniers de l’informatique, cette disparition de la séparation vie publique/vie privée a été vécue comme une libération. C’est comme si la fameuse frontière qui a toujours circonscrit l’espace privée, s’était tout-à-coup dissoute, et que l’on pouvait à son gré, simplement en choisissant à qui on s’adresse, établir une communication soit en intimité, soit ouverte à tous, sans qu’il soit question de frontière à franchir.
Mais il a fallu assez vite, dès le début du millénaire, déchanter. On ne parle pas à quelqu’un sur Internet comme on parle sur la terrasse d’un bar, où l’on peut évaluer le contexte de l’émission vocale et si besoin baisser la voix, mettre sa main en cache, pour dire quelque chose de très personnel. Nous échappent totalement les canaux par lesquels transitent nos messages. On a pris conscience que n’importe quel tiers, par un agencement technique adéquat, pouvait avoir accès, et de multiples manières, au message et aux conditions de son émission, et même au contenu de l’ordinateur avec lequel on l’émet.
C’est ainsi qu’est arrivé le temps des mots de passe, des cookies, des pare-feu, des virus et antivirus, des mises à jour de sécurité, etc. On avait une frontière bien visible à surveiller. On en a aujourd’hui une multitude, avec, pour les surveiller, des outils que d’autres nous accordent et sur lesquels nous n’avons aucune maîtrise technique.
Désormais, chacun de ceux qui possèdent un terminal de connexion à Internet sait qu’il est profilé dans de multiples bases de données qui s’alimentent de ses passages sur le réseau, sans qu’il puisse les contrôler. Mieux ! La récolte systématique et aussi poussée que possible de données personnelles sur Internet, est promue comme la bonne pratique dans les écoles enseignant « les nouvelles technologies ». Et la généralisation récente des smartphones toujours connectés a surmultiplié la moisson abondant les bases de données.
Cette numérisation de la vie de chacun ne se source pas uniquement sur Internet puisque des caméras, voire des drones, sont placés en surveillance – et le plus souvent par les autorités publiques – de manière de plus en plus dense, avec la possibilité d’identification des individus par reconnaissance faciale.
Or, la loi protège la vie privée – art. 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée », reprise par l’article 9 du Code civil français. Ainsi, le droit est constamment bafoué, et même par ceux qui sont en charge de le faire respecter. En fait, il est clair que la rapide numérisation de la société, et les pratiques qu’elle a promues, ont rendu la loi inapplicable : comment chaque citoyen pourrait-il « gratuitement, sur simple demande avoir accès à l’intégralité des informations le concernant sous une forme accessible » ( CNIL) de la part de Google, ou de toute autre organisme qui le fiche ?
Donc, oui ! Le monde numérique menace gravement l’existence de notre vie privée, au sens où, en ce monde, il n’y a plus la possibilité de tracer une frontière contrôlable pour préserver tout ce que, en notre vie, nous voulons garder hors de tout regard extérieur à notre sphère personnelle.
Même les règles de droit gravées dans le marbre des textes les plus sacrés de notre civilisation, ne peuvent nous protéger de ces intrusions.
Mais, avons-nous fait ce qu’il fallait quand il le fallait pour que le droit prévale ? N’avons-nous pas fermé les yeux sur la vulnérabilité intrinsèque à la vie numérique, tout accaparés que nous étions à profiter des facilités de communication que nous offrait ce nouveau monde ?
D’ailleurs, même du point de vue de la sécurité, le bilan n’est peut-être pas si négatif. Le monde numérique, en quelques clics, met à disposition des informations qui permettent d’anticiper d’éventuels dangers pour soi ou ses proches, et lorsque ces proches se trouvent éloignés spatialement, il permet de s’assurer de leur bonne situation, d’une manière générale il facilite le repérage, par les autorités d’agissements d’individus malveillants pour la sécurité publique.
Où serait précisément le mal, si le bilan est positif entre la menace sécuritaire qu’implique l’aspiration de nos données privées – on en a l’idée en particulier avec les mésaventures, voire les drames, de certains qui se trouvent trop à découvert sur les réseaux sociaux – et le gain global de sécurité personnelle et collective qu’amène le monde numérisé ?
Mais, justement, la sécurité peut-elle être un but en soi ? La visée d’une existence humaine peut-elle être réduite au contentement de survivre, même douillettement ?
La voie totalitaire
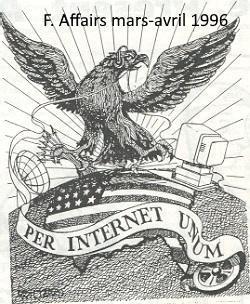 Nous savons que la venue du monde numérisé a abouti à donner un nouveau dynamisme aux échanges marchands, et a donc conforté la mercatocratie (le pouvoir du marché). Or, la finalité de l’existence humaine promue par l’idéologie marchande tient dans la formule « réussir sa vie ». Et cela signifie se donner les moyens, mieux que les autres, de satisfaire ses désirs, et donc de maximiser ses situations de bien-être liées à la consommation de biens marchands, et donc d’être gagnant dans la compétition pour l’enrichissement.
Nous savons que la venue du monde numérisé a abouti à donner un nouveau dynamisme aux échanges marchands, et a donc conforté la mercatocratie (le pouvoir du marché). Or, la finalité de l’existence humaine promue par l’idéologie marchande tient dans la formule « réussir sa vie ». Et cela signifie se donner les moyens, mieux que les autres, de satisfaire ses désirs, et donc de maximiser ses situations de bien-être liées à la consommation de biens marchands, et donc d’être gagnant dans la compétition pour l’enrichissement.
De ce point vue, le monde numérisé connecté en un réseau mondial se présente comme un formidable outil pour réussir sa vie : facilitation d’accès aux biens qu’on désire acheter ou vendre, comparatifs de prix, spéculation aisée sur les valeurs boursières et surtout sur les monnaies numériques, revenus acquis par les clics sur les pages aguicheuses que l’on a mis en ligne, etc. Ce n’est pas un hasard si des fortunes mirobolantes se sont construites, ces dernières décennies, par l’exploitation du monde numérique.
Or, il faut avoir conscience que ces désirs liés à la consommation se vivent généralement sur le mode du besoin, c’est-à-dire comme des nécessités : on dit qu’on a besoin d’un nouveau smartphone, de changer mon véhicule, etc. !
Pourquoi a-t-on besoin, par exemple, d’un véhicule surdimensionné pour faire individuellement de simples trajets interurbains sur des voies en parfait état ? Parce que l’imaginaire par lequel on investit cet objet est la réponse par réaction à une interpellation venant de la société – la publicité et les influenceurs de tout acabit finissant par créer un effet de mode – qui signifie à l’individu que c’est son identité qui est en jeu dans l’acquisition de ce bien. Alors, de ce point de vue, il n’a pas le choix. Il ne peut pas envisager de ne pas se reconnaître, de ne pas être reconnu, dans sa valeur propre, parce qu’il ne conduit pas le bon véhicule.
Et c’est bien parce que ces désirs sont vécus comme des besoins, que sont si nombreux les individus qui acceptent de consacrer la majeure partie de leur temps de vie en veille, comme l’essentiel de leur énergie vitale, à des activités qui ne les concernent que très peu, ou pas du tout, pour de l’argent.
On présente la société industrialo-marchande de consommation, comme la société du triomphe du désir et du plaisir. En réalité nous vivons dans une société essentiellement besogneuse, une société de nécessiteux.
Cela, Hannah Arendt l’avait déjà reconnu dès 1958 dans Condition de l’homme moderne : « On dit souvent que nous vivons dans une société de consommateurs et puisque, nous l'avons vu, le travail et la consommation ne sont que deux stades d'un même processus imposé à l'homme par la nécessité de la vie, ce n'est qu'une autre façon de dire que nous vivons dans une société de travailleurs. »
Or, dès cet ouvrage, la philosophe avait pointé un délitement de la vie privée de « l’homme moderne ». Elle montrait en effet que cet avènement de la société du travail et de la consommation impliquait une dégénérescence de l’espace public.
Rappelons que l’espace public avait été reconnu par les Anciens comme le lieu où prenait sens l’existence humaine, en ce que le citoyen y exerçait sa liberté la plus humaine, celle de s’investir pour le bien commun de la société. Mais l’espace « public » de la société moderne ne se préoccupe plus de l’avenir comme perspective de la réalisation d’un bien commun. Puisqu’il est absorbé par l’extension et l’intensification des flux marchands et l’enrichissement qu’ils génèrent – ce qu’on appelle la « croissance » (du PIB).
Ainsi, ce qui caractérise la condition de l’homme moderne, nous explique Arendt, c’est que la formulation de ses besoins et la gestion de leur satisfaction ne sont plus l’apanage de la sphère privée, mais sont devenus l’affaire essentielle de la société. Ce qui se voit clairement lorsqu’on vous fait comprendre, sur Internet, que, plus vous donnerez accès à votre vie personnelle, plus on sera à même de proposer la réponse adéquate à vos besoins, et même de les anticiper.
La société de travail et de consommation, c’est l’obsolescence de la vie privée par son absorption dans la vie sociale à la main des véritables maîtres, les majors de l’économie, qui sont en position d’orienter les besoins en fonction des biens qu’ils ont intérêt à mettre sur le marché. Pas de besoin de SUV sans une décision de concevoir et promouvoir des véhicules offrant une plus grande marge de bénéfices, pas de besoin de PMA sans une offre distillée dans les cabinets médicaux, etc.
Mais alors, la société, au lieu de nous ouvrir la plénitude l’avenir dans la visée du bien commun (ce qu’était l’espace public des Anciens), nous arrime au présent, puisque c’est toujours au présent qu’on a besoin. Et l’investissement de l’avenir ne va pas plus loin que l’attente du bien qui apportera la satisfaction, laquelle attente doit être la plus courte possible : nous savons que le commerce sur Internet ne cesse d’en réduire le délai. Au-delà, le seul avenir qui est pris en considération au-delà, est celui de l’anticipation, par les grands affairistes et les politiques qui leur sont liés, des besoins et des productions à venir – ce qui projette à une ou deux décennies.
C’est pour cela que la société moderne est intrinsèquement courtermiste, et donc incapable de maîtriser les conséquences écologiques de ses activités.
Hannah Arendt incriminait la société de consommation à une époque en laquelle on ne soupçonnait même pas la possibilité d’un monde numérique. Mais ce dernier étant advenu, on se rend compte qu’il a pleinement accompli la tendance qu’avait décelée Arendt, d’une disparition de la vie privée. En effet le monde numérique, en abolissant l’espace, élimine le seul pouvoir qu’ont les individus pour instituer leur domaine privé : circonscrire leur espace d’habitation et en contrôler souverainement la limite.
Certes, l’espace d’habitation est bien toujours là, mais le pouvoir social exerce une pression intense – particulièrement voyante dans l’extension de la polyvalence du smartphone – pour que de plus en plus d’actes de la vie courante se fassent par écran connecté interposé, c’est-à-dire dans le monde numérique.
Or là est la voie du totalitarisme, c’est-à-dire d’un système de pouvoir tendant à la totalité. Car, nous projetant ainsi dans un monde en lequel chacun peut lui être totalement transparent, le pouvoir mercatocratique se donne effectivement les moyens de contrôler la totalité de la société, mais aussi la totalité de la vie de ceux qui la composent, et donc de maîtriser les choix de comportements de chacun.
Il faut envisager que le « tous-connectés-toujours-et-partout » vers lequel est emmenée la société aujourd’hui nous avoisine dangereusement du totalitarisme.
Mais n’est-ce pas en ce contexte que la résistance au nom de la défense de sa vie privée prend son sens ?
Le sens de la résistance au nom de la vie privée
Chacun de nous sait, intuitivement, que son existence ne peut se limiter au courtermisme en lequel voudrait l’enfermer la société de consommation. Une vie humaine ne peut se satisfaire de l’accumulation de petites attentes et de petites satisfactions.
Que lui manque-t-il que la société moderne soit incapable de lui apporter ?
Il est temps de rappeler que la vie privée est l’espace qui prend en charge les nécessités de la vie. Or, il apparaît ici qu’il faut étendre ce domaine de la nécessité au-delà des simples besoins à court terme. Car il y a une nécessité proprement humaine et qui est à long terme, c’est la nécessité de donner un sens à sa vie ! Alors que les autres espèces ont une finalité assignée par la biosphère, l’humain seul doit choisir ce qu’il fait de sa vie.
C’est pourquoi chacun a une part de lui-même qui revendique la perspective d’un bien comme un idéal humain en fonction duquel se feront ses choix de vie. Et l’on sait qu’au niveau social cette finalité s’appelle le bien commun. Or, il y a une priorité du bien commun sur le bien personnel, car une vie sociale pacifiée est la condition nécessaire pour faire valoir son propre bien. Et la pensée du bien commun implique que l’on se place dans la filiation du passé – en fonction de quels bien commun les sociétés antérieures se sont-elles situées ? – et que l’on investisse l’avenir dans sa plénitude – dans quelle direction penser l’avenir de l’aventure humaine ? – ce qui n’est que vivre dans une temporalité humaine.
Par contre, c’est le propre du courtermisme de la société de travail et de consommation d’évacuer cette dimension humaine. Son seul horizon, c’est de pourvoir aux besoins présents quitte à ce qu’ils soient provoqués en fonction d’intérêts marchands. Or cette temporalité déterminée par les besoins et leur satisfaction est assurément la temporalité de l’animalité.
Laisserait-on penser que notre élite affairiste vivrait et voudrait nous faire vivre animalement ? L’expérience nous apprend, en tous cas, qu’elle est incapable de prendre en charge l’avenir puisque, malgré les alertes répétées, elle a mis l’humanité dans une crise, à la fois écologique et sociale, qui, tant qu’elle a le pouvoir, ne trouve aucune issue.
Pourquoi l’envahissement rampant de notre vie par les antennes de la société de consommation, afin qu’elle lui devienne totalement transparente, est-il vécu comme une menace, malgré tous ses avantages ? N’est-ce pas parce que nous sentons que c’est notre droit à nous projeter dans l’avenir, à donner un sens à notre vie, à exercer notre liberté humaine, qui est ici en cause ?
Car c’est bien d’un domaine privé dont nous avons besoin pour cultiver cette liberté ! Dans le cadre familial l’enfant essaie de comprendre les choix de ses proches (ce qu’illustre le questionnement du petit enfant à ses parents), dans son intimité personnelle il enrichit par son imaginaire le monde de possibles qu’il peut ensuite mettre à l’épreuve déjà par le jeu, et ensuite dans la réalité, soit en essayant, soit en se confrontant à l’opinion d’autrui.
L’exercice de notre liberté humaine est l’affaire la plus importante de notre existence. Avant d’être transplantée dans le grand air d’un espace public de débats, où elle s’épanouira, la liberté doit se cultiver de manière protégée, comme en serre. Et cette serre ne peut-être qu’un domaine de vie hors d’atteinte des menées d’une mercatocratie qui révèle aujourd’hui ses tendances totalitaires.
Il faut donc nous réserver un espace de vie privée ! Il faut savoir prendre le temps de lever la tête de nos écrans (merci quand même de m’avoir lu jusqu’au bout :). Non pas par peur d’un envahissement qui s’emparerait de je ne sais quel trésor sis en notre ego. Mais parce que c’est la voie pour que nous reprenions la main sur le bien commun, et donc la condition pour nous redonner un avenir.





