La liberté et les sciences humaines
Libres même et surtout quand, instruits par les sciences humaines, nous prenons acte de ce qui nous détermine à notre insu. La limite et l'obstacle reconnus sont déjà à demi franchis...Article tiré de Au secours des évidences, Mame, Paris, 2022.
La liberté – mot magique inscrit dans l’essence même de l’être humain, objet des aspirations les plus hautes comme des revendications les plus vulgaires. Depuis l’aurore des temps, l’homme s’est cru libre. La foi en la liberté est à la base, non seulement des religions un peu évoluées, mais de la morale, du droit, de l’éducation, de la sagesse, de la culture, bref, de l’ensemble des relations entre entre l’homme et Dieu, l’homme et lui-même, l’homme et ses semblables. S’il n’y a pas de liberté, il n’y a pas non plus de responsabilité, et tout l’édifice humain s’effondre.
Or voici que l’essor foudroyant des nouvelles sciences de l’homme (physiologie, psychanalyse, sociologie…) vient mettre en question, à l’aide d’observations de plus en plus précises, le pouvoir, et jusqu’à l’existence de la liberté. Celle-ci, nous disent les spécialistes de ces sciences, n’est qu’une illusion due à l’ignorance des mécanismes aveugles qui déterminent notre conduite, et l’illusion se dissipe à mesure qu’on avance dans la découverte et l’analyse de ces mécanismes. Bref, les conditionnements qui nous font agir – états du corps, pulsions de l’inconscient, pressions du milieu social – sont infiniment plus compliqués mais analogues dans leur nature à ceux qui soumettent une pierre aux lois de la pesanteur, ou qui pousse un animal vers la nourriture ou vers un représentant du sexe opposé…
Nous ne nions pas le rôle immense de ces facteurs dans la conduite, en apparence libre, des hommes. Mais le seul fait de s’interroger sur nos conditionnements, de les analyser, de les modifier (par la médecine, la psychanalyse, les propagandes, etc.) implique déjà l’exercice d’une activité non conditionnée. Etre capable de connaître son esclavage et d’en démonter les ressorts, c’est déjà faire preuve de liberté. « L’homme n’est que cela : un corps, un sexe, une marionnette sociale » – affirment les matérialistes de tout plumage. Réponse : s’il n’était que cela, il ne le saurait pas. A-t-on jamais vu une pierre méditer sur l’attraction universelle, ou une vache sur la fatalité qui la condamne à ne manger que de l’herbe ?
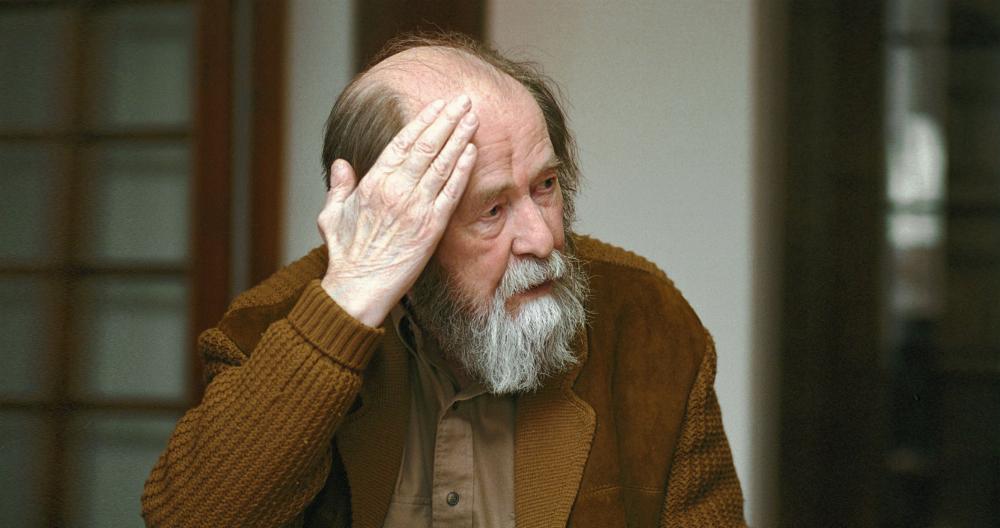
Ainsi, les sciences humaines, loin d’aboutir à la négation de la liberté, nous renseignent uniquement sur ses limites et sur les obstacles qui s’opposent à son exercice. Et par cette prise de conscience, elles renforcent notre indépendance, car la limite et l’obstacle reconnus sont déjà à demi franchis…
Ce qu’on oublie quand on discute sur l’existence de la liberté, c’est qu’elle n’est pas donnée une fois pour toutes à la façon des facultés sensibles, comme par exemple la vue et l’ouïe qui subsistent quel que soit l’emploi que nous en faisons. Si je passe mon temps à regarder des films idiots ou à écouter des insanités, je ne deviendrai pour cela ni aveugle, ni sourd. Tandis que la liberté – faculté élastique par excellence – se développe ou se perd suivant le bon ou le mauvais usage que nous en faisons. L’homme qui, dans les circonstances où il faut choisir entre le plaisir et le devoir, préfère le devoir, ou, entre une occupation futile et une occupation noble, opte pour celle-ci, devient de plus en plus libre ; et celui qui se laisse aller en sens contraire, l’est de moins en moins. L’alcoolique, le drogué s’intoxiquent d’abord de leur plein gré : après un certain temps, ils ne sont plus que les esclaves impuissants de l’alcool ou de la drogue…
Et c’est ici qu’éclate la malfaisance de ceux qui, au nom des sciences humaines mal interprétées, ruinent la foi en la liberté. Car, tout problème métaphysique mis à part, c’est un fait d’expérience courante qu’une homme placé devant un choix difficile, réagit très différemment suivant qu’il se croit libre ou non : dans le premier cas, il a beaucoup plus de chances de dominer sa faiblesse ou ses passions et, dans le second, de céder à ses mauvais penchants ou à la pression du conformisme ambiant.
Ce n’est d’ailleurs pas un des moindres paradoxes de notre siècle que de voir fleurir, dans les mêmes courants d’opinion et chez les mêmes hommes, d’une part une philosophie matérialiste grossière qui nie la liberté, et de l’autre, le refus de toute discipline, et un appel permanent à la révolte, non seulement contre l’ordre établi, mais contre les bases mêmes de la condition humaine. Le marxisme, le gauchisme nous enseignent que la réalité économique conditionne tous nos comportements et, simultanément, ils prêchent une « libération », une émancipation qui renversent toutes les lois de l’économie dont la première est qu’on ne peut consommer que ce qu’on produit… Marx n’a-t-il pas osé prédire comme réalisable une société où « tous les hommes travailleront selon leurs forces et consommeront selon leurs besoins » ?
Mais le paradoxe n’est qu’apparent, car ce que les foules modernes, agitées par les tripoteurs de l’opinion, revendiquent sous le nom de liberté, ce n’est pas l’autonomie de la personne humaine, c’est presque toujours la licence de céder aux impulsions et de satisfaire les désirs les moins libres de notre nature, aggravés et multipliés par les conditionnements sociaux. « La liberté à la bouche, le servage au cœur », disait Chateaubriand…
Plus qu’aucune autre, notre époque a besoin d’apprendre que les libertés extérieures n’ont de sens et de valeur qu’en fonction de la liberté intérieure et que, chez l’homme incapable de se gouverner lui-même, elles n’aboutissent qu’à des raffinements de servitude…





