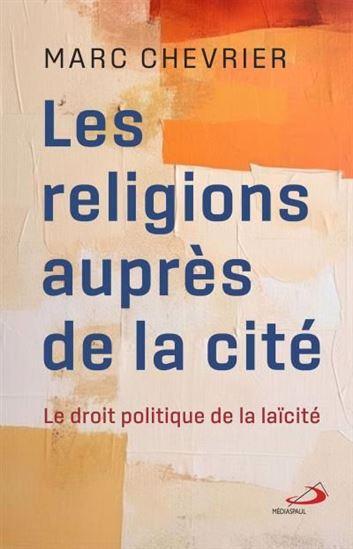Le français, langue infantile
Obligatoire jusqu’à la fin du secondaire seulement, le français est-il donc, au Québec, jugé indigne de la science avancée et de la haute culture ?
Au Québec, le français est une langue pour les enfants. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le législateur québécois lui-même, soit l’Assemblée nationale du Québec par la bouche de ses lois, qui l’affirme. Pour s’en convaincre, il n’est que de lire la Charte de la langue française qui depuis son adoption en 1977 dispose que « [l]’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires »[1] sous réserve des exceptions qui confèrent à certains parents la possibilité d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise. Or, la Loi sur l’instruction publique, qui régit l’éducation publique au Québec de la maternelle au secondaire, prévoit que tout enfant doit, règle générale, fréquenter une école — publique ou privée — entre les âges de 6 à 16 ans[2]. Donc l’enseignement en français ne comprend en fait qu’une partie de l’enfance, la petite-enfance et la fin de l’adolescence en étant exemptées — alors qu’en France, par exemple, l’instruction obligatoire commence à 3 ans[3]. Cependant, les mots requis par le législateur québécois pour formuler « l’obligation de fréquentation scolaire » en français sont particuliers. Ils visent l’enseignement offert dans les classes, comme si le français devait se circonscrire aux salles où les élèves, patiemment assis, attendent que le maître annonce le moment de la récréation. Si en France, c’est l’instruction qui est obligatoire, au Québec, c’est la fréquentation de l’école qui l’est, si bien qu’à la limite, les élèves, dans la mesure où ils assistent avec une assiduité acceptable les enseignements fournis en classe, sont dispensés d’apprendre quelque matière que ce soit exprimée dans la langue de Molière. Au Luxembourg également, tout enfant doit « fréquenter l’école », quoique la loi précise que la formation obligatoire « consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires »[4]. Au Québec, l’élève doit seulement « participer aux activités de l’école qu’il fréquente concernant le civisme, la prévention et la lutte contre l’intimidation et la violence[5]. » Mais qu’en est-il des activités d’instruction proprement dites? Silence. La seule autre obligation que la loi québécoise prévoit pour l’élève en classe est qu’il prenne soin des biens mis à sa disposition et qu’il les rende une fois l’activité scolaire terminée. La loi attend des élèves bien élevés, mais pas nécessairement bien instruits.
En somme, l’éducation publique en français au Québec se borne à la fréquentation de classes pour des élèves qui, pendant une décennie, ne sont guère tenus de s’instruire de quoi que ce soit en français. Mais qu’arrive-t-il, par exemple, si un élève ne remplit pas son obligation scolaire et décide, après avoir décroché de l’institution, de retourner en classe passé l’âge de 16 ans? Rien dans la loi ne l’obligerait à continuer en français les études secondaires qu’ils avaient abandonnées dans cette langue. La formation en français ne poursuit pas l’instruction réelle comme telle ; elle suit une règle purement temporelle. Il suffit de tomber dans la fourchette prévue par la loi pour y être assujetti ; sitôt qu’on a dépassé l’âge fatidique de seize ans, on échappe à la « classe » en français. En 2017-2018, du reste, 13 728 jeunes Québécois de 10 à 16 ans ont cessé leurs études, l’âge le plus critique pour les abandons étant celui de 16 ans[6].
L’idéologie du « libre choix » et le bilinguisme concurrentiel en éducation
16 ans est aussi l’âge qu’ont en général les finissants du secondaire qui, pour celles des personnes qui se destinent aux études postsecondaires facultatives, préparent les demandes d’admission aux différents collèges du Québec (cégeps), publics et privés, subventionnés par l’état québécois. Or, au Québec, ces finissants encore adolescents choisissent d’ordinaire à cet âge critique, outre leur filière d’études et leur établissement, la langue de leur instruction collégiale. On voit dès lors que le français est fait pour les enfants dans un double sens : 1- la fréquentation de classes en français ne vise que des enfants ; 2- c’est de mineurs pubères que dépend le sort de la langue française pour les études postsecondaires. L’avenir d’une communauté linguistique minoritaire en Amérique et au Canada même se repose sur les microdécisions de milliers d’adolescents qui découvrent les joies d’un marché aux diplômes délivrés par plus d’une cinquantaine d’établissements. En effet, le Québec est l’un de ces rares et curieux endroits du monde où deux systèmes complets d’éducation, de langues anglaise et française, coexistent parallèlement, de la maternelle à l’université, tous deux également financés par les fonds publics reçus du Québec et du gouvernement fédéral en matière de recherche. Comme si sur le territoire du Québec, le français et l’anglais étaient considérés, à parts égales, comme des langues nationales.
Avant l’adoption de la Charte de la langue française en 1977, ces deux systèmes se faisaient « librement » concurrence, tant et si bien que les parents se sont longtemps crus investis du droit souverain de choisir la langue d’instruction de leurs enfants, option dont notamment beaucoup de familles immigrantes se sont prévalues jusqu’en 1977 pour scolariser massivement leurs enfants en anglais, rampe du prestige et de l’ascension sociale. En 1974, par sa la Loi sur la langue officielle, le gouvernement libéral de Robert Bourassa avait tenté de restreindre l’accès à l’école anglaise, en imposant des tests préalables de compétence linguistique qui irritèrent aussi bien la communauté anglophone que les aspirants à la scolarisation en anglais. La Charte de la langue française rendit obligatoire la fréquentation, au primaire et au secondaire, de classes en français pour les francophones et les immigrants, quoique en laissant intact le régime de libre concurrence linguistique pour les établissements postsecondaires, cégeps et universités, avec la bénédiction des pouvoirs publics. Le fait que le français constitue une langue infantile pour le législateur québécois a pour contrepartie que le passage aux études en anglais paraît la récompense de l’arrivée aux marches de l’âge adulte.
Dans le discours public au Québec s’est ainsi installée une idée tenace, propagée par les médias, les acteurs politiques et même par certains organismes publics[7] qu’aussitôt parvenu près de l’âge adulte, un jeune posséderait le droit fondamental, imprescriptible, de se scolariser dans la langue de son choix, un choix personnel, qui ne regarde que lui ou elle, et devant lequel les institutions doivent s’incliner. On parle d’un supposé « libre choix » linguistique qui gouvernerait toute l’éducation postsecondaire et sur lequel se serait cristallisé, de l’avis de certains journalistes, un consensus. On est tellement persuadé de l’existence de ce droit qu’on le sert comme une évidence indiscutable, qui coupe court à toute velléité de pérenniser le français par l’éducation postsecondaire. Ce droit scandé dans le débat public, on l’imagine proclamé par quelque texte fondamental ou sacré, comme les chartes canadienne et québécoise des droits, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Rig-Véda ou les Upanishad hindous. C’est à croire qu’en France, l’État finance l’instruction universitaire en allemand, qu’en Espagne, l’accès à l’université en arabe est universel, et qu’au Vermont, les contribuables subventionnent dans l’allégresse les études universitaires en espagnol.
En droit strict, la seule exigence que formule la constitution canadienne en matière de langue de l’éducation ne concerne, là encore, que les enfants. L’article 23 de la Charte canadienne adoptée en 1982 consacre le droit des parents des communautés anglophone au Québec, et francophones ailleurs au Canada, de faire instruire leurs enfants dans leur langue maternelle, au sein d'écoles primaires et secondaires financées sur les fonds publics. Cet article laisse totalement en plan l’éducation postsecondaire, et bien loin de garantir une liberté de choix au profit des mineurs, il s’en remet plutôt aux parents pour la langue d’instruction. Et c’est tout, la constitution canadienne ne dit rien d’autre en la matière, et on peut difficilement déduire des libertés fondamentales une quelconque obligation de maintenir, au Québec ou ailleurs au Canada, un système d’éducation supérieure bilinguistique et d’accès universel[8].
La seule reconnaissance législative d’un certain libre choix linguistique en éducation s’est faite en 1969, par la loi que le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand adopta précipitamment en pensant mettre fin à la crise des écoles à Saint-Léonard, où Italo-Québécois et Franco-Québécois s’étaient dressés les uns contre les autres autour de controversées classes bilingues instaurées par leur commission scolaire, où la lingua del pane tenait le haut du pavé. Cette loi, communément appelée la loi 63, prévoyait que les cours de cycles primaire et secondaire sont donnés « en langue anglaise à chaque enfant dont les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font la demande lors de son inscription » ; elle reconnaissait donc, sans vraiment y fixer de limite, la liberté des parents d’inscrire leurs enfants à l’école anglaise, à charge pour celle-ci d’« assurer une connaissance d'usage de la langue française[9] » aux enfants scolarisés en anglais. Cette loi ne disait mot des études postsecondaires. Bien évidemment, cette loi n’est plus en vigueur aujourd’hui, mais il n’est pas à exclure qu’elle ait marqué les esprits et contribué à cristalliser le sentiment qu’un principe général de libre choix linguistique gouvernerait tout le système éducatif québécois, auquel la Charte de Camille Laurin aurait mis certes des tempéraments, pour le primaire et le secondaire uniquement.
Il faut dire que le législateur québécois affectionne particulièrement la notion de « choix » en matière scolaire. L’ancienne Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public[10], en vigueur de 1984 à 1989, consacrait le droit des « parents de l’élève » ou de « l’élève majeur » « de choisir l’école qui répond le mieux à leur préférence ou dont le projet éducatif correspond le plus à leurs valeurs. » En outre, elle prévoyait une forme de libre choix en matière d’enseignement religieux. Il est instructif de lire la disposition qui régissait ce droit particulier :
6. L’élève a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux catholique, l’enseignement moral et religieux protestant et l’enseignement moral.
Il a aussi le droit de choisir, à chaque année, l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante lorsqu’un tel enseignement est dispensé à l’école conformément à la présente loi.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
On voit notamment apparaître le concept de l’« enfant majeur », qui dès 14 ans, est jugé apte à exercer un droit d’option spirituel, soit retenir pour lui-même l’enseignement religieux ou l’enseignement moral séculier. En somme, le dualisme religieux qui a longtemps structuré le système des commissions scolaires au Québec, ainsi que le dualisme entre les enseignements religieux et moral ont vraisemblablement nourri une espèce de culture du choix, reflétée dans le langage même du législateur. Ces deux dernières lois, celles de 1969 et de 1984, n’ont aujourd’hui de valeur qu’historique. Elles éclairent cependant cette notion si répandue, admise sans réflexion, du libre choix linguistique, bien qu’elle ne possède pas de fondements juridiques véritables.
Il demeure que conformément à l’esprit britannique de l’empire, les règles les plus importantes ne sont écrites nulle part, et le principe du prétendu « libre choix » qui gouvernerait la langue de l’éducation postsecondaire au Québec fait sans doute partie de ces normes diffuses, qui informent les mentalités et les mœurs, et dont l’examen critique soulève la honte, la crainte, sinon un persistant malaise. Le peu de lois et de règlements que le Québec a adopté pour ses établissements postsecondaires ne prévoit d’aucune manière une telle liberté. Le silence du législateur sur la langue de l’éducation postsecondaire est tel qu’il n’a pas jugé bon d’accorder aux cégeps et aux universités une identité linguistique précise, sauf pour quelques exceptions choyées ; il les laisse « s’autodéfinir », en se contentant depuis 2002 d’une vision purement statistique de leur identité linguistique, selon que l’établissement enseigne à une majorité de ses élèves dans une langue ou une autre[11].
Mais si on a l’impression persistante qu’une telle liberté de choix existe vraiment, elle résulte plutôt de l’organisation même de l’offre des formations postsecondaires par l’état du Québec, qui a mis en place un marché bilinguistique aux étudiants dont les établissements se disputent les inscriptions à la sortie des écoles secondaires et à la fin des études collégiales. Ce marché bilinguistique repose sur une formule de financement qui règle les subventions versées par l’État aux établissements postsecondaires sur le nombre des étudiants inscrits et sur leur domaine de concentration. En somme, l’argent suit l’étudiant. Ce marché aux étudiants est « aveugle » à l’identité linguistique des établissements, francophones ou anglophones, et avalise donc les succès d’inscription remportés par les établissements anglophones auprès des francophones et des allophones, qui se précipitent vers les établissements anglophones depuis plusieurs années et propulsent leur expansion en effectifs, en programmes et en pavillons au détriment du réseau francophone, systématiquement sous-financé et voué désormais à l’éducation des étudiants moins performants. La « liberté de choix » recouvre pour l’essentiel le phénomène d’étudiants scolarisés en français migrant vers les établissements anglophones; la migration inverse, des établissements anglophones vers les francophones, est presque inexistante. C’est, en somme, une liberté asymétrique, sans réciprocité réelle.
Pour soutenir cette concurrence, nombre d’établissements francophones sont tentés par l’offre de programmes en anglais ou bilingues. La Charte de la langue française leur pose d’ailleurs peu d’obstacles, puisqu’elle les autorise à fournir un enseignement en anglais — ou en mandarin — à 49,9 % de leurs élèves. Donc l’impression que la langue du postsecondaire suivrait la liberté de choix intangible des étudiants finissant le secondaire s’avère le produit, par l’habitude et la rhétorique du choix personnel, d’un système qui met artificiellement deux langues d’enseignement en concurrence directe pour capter les meilleurs étudiants là même où se concentrent la population, la richesse et le pouvoir, c’est-à-dire à Montréal, à Québec et à Gatineau, fondue dans la banlieue d’Ottawa. Autrement dit, après que le marché des boissons gazeuses eut accoutumé pendant de longues années les consommateurs à l’alternative entre Coca-Cola ou Pepsi, ces derniers croient posséder le droit inaliénable de boire l’un ou l’autre. Le français serait, en quelque sorte, le Pepsi du postsecondaire québécois.
Le français, une langue de peu, qui rapporte peu
La concurrence bilinguistique entre les établissements postsecondaires est révélatrice d’un ordre sociopolitique qui, loin de contrer le rapport inégal entre les langues française et anglaise sur le continent, entérine la subordination de la première à la deuxième. Le caractère obligatoire du français n’étant attaché qu’à l’enfance, la langue française devient, pour les jeunes adultes ou « enfants majeurs » aux portes de l’éducation supérieure, un simple idiome facultatif, qu’aucun choix collectif ne soutient et dont l’usage se plie aux fluctuations des demandes d’inscriptions enregistrées sur le marché aux étudiants chorégraphié par l’Administration québécoise. Elle symbolise pour plusieurs d’entre eux l’enfermement dans une enfance scolaire malheureuse, une langue punitive que l’on boude ou que l’on quitte sitôt sorti de la « classe » où un diplômé en pédagogie socioconstructiviste s’est évertué à transmettre quelques rudiments d’une langue mal aimée, vite refoulée par les cris multilingues qui fusent dans les cours d’école. En clair, la fréquentation scolaire en français n’est qu’une mesure transitoire, sinon dilatoire, qui retarde la promotion sociale qu’un nombre grandissant de jeunes allophones et mêmes francophones recherchent dans les diplômes en anglais et qui scelle pour plusieurs d’entre eux leur intégration sociale et psychique au monde anglo-saxon.
En entrant dans des cégeps anglophones, qui pavent la voie à leur admission aux universités de langue anglaise du Québec et d’ailleurs sur le continent, ces jeunes anglotropes vont certes continuer à étudier le français, quoique ravalé au rang de langue seconde rétrogradée. Ce système de bilinguisme concurrentiel accrédite ainsi l’idée que pour participer à la vie adulte au Québec, il suffit d’avoir du français une connaissance sommaire qui ne dépasse pas le niveau d’un 5e secondaire, c’est-à-dire celle d’un ado. En somme, le français vaut un simple patois véhiculaire pour les comptoirs, les services à la clientèle, la prestation de soins, les petits boulots, qui ne nécessite pas un apprentissage soutenu tout au long de la formation intellectuelle des jeunes, notamment aux étapes ardues et déterminantes pour leur avenir de leur parcours postsecondaire. C’est une langue faite pour la vie ordinaire, la « p’tite vie », et non pour la science et la haute culture. Bref, avec en poche son petit « secondaire V » en français, on peut se débrouiller au Québec et y acquérir ensuite tous ses titres professionnels en anglais, à même les fonds publics.
Malgré un certain rattrapage salarial des francophones observé au Québec par rapport aux anglophones, le français serait encore loin d’avoir remonté la côte. Le déclassement du français sur le marché du travail au Québec se révèle aujourd’hui dans la structure de rémunération des travailleurs selon leur secteur. On pourrait s’attendre à ce que le corps d’emploi où la connaissance du français serait une compétence très prisée, comme la fonction publique québécoise, offre à ses membres des salaires attrayants. Bien au contraire, c’est au vrai le secteur où les salaires sont les plus à la traîne, comparativement à ceux qu’on touche dans les administrations municipales, la fonction publique fédérale ou le secteur privé, là où justement le français est moins systématiquement requis, et souvent ignoré ou marginalisé[12]. Langue du surplace salarial, le français a perdu le peu de notoriété et de prestige qu’il possédait naguère dans la diplomatie fédérale canadienne, au point de cesser d’exister dans la haute direction des Affaires étrangères et d’obliger son personnel francophone refoulé aux échelons inférieurs à embrasser l’anglais pour avancer dans leur carrière[13].
L’anglais, langue de référence du français
Il est du reste révélateur que les cours de philosophie ne sont obligatoires que dans les cégeps francophones, alors que dans les cégeps anglophones, des cours d’humanités tiennent lieu de philosophie, ce qui montre bien que la connaissance de Platon, de Descartes et de Rousseau ne découle pas d’une exigence universelle. Il s’agirait là au plus d’un simple atavisme culturel qu’une minorité nationale transmettrait au solde résiduel de sa jeunesse qui poursuivrait ses études supérieures dans sa langue de première instruction. D’ailleurs, la présence des cours de philosophie, faut-il le rappeler, remonte à la création même des cégeps à la fin des années 1960. Elle se voulait un substitut à la culture humaniste dispensée par les collèges classiques que la réforme de l’éducation entreprise à la suite du rapport de la commission Parent avait abolis.
Or, cette culture classique héritée de la tradition européenne que l’Église avait perpétuée dans ses collèges et séminaires reposait sur un régime des langues particulier. Les pays en Europe se sont construits en privilégiant une langue nationale unificatrice, enrichie et raffinée par une comparaison incessante et méthodique avec les langues anciennes, le grec et le latin, que les élites du pays apprenaient, bon gré mal gré. En ce sens, l’éducation des élites de la nation passait par l’étude de langues de référence, non pour la vie courante, mais pour la culture, auxquelles leur langue vernaculaire, confrontée à des modèles d’éloquence, d’expression et d’intelligence, se grandissait sans être menacée dans son existence. Plusieurs pays en Europe ont conservé l’enseignement du latin et du grec ancien dans leurs écoles nationales, même si l’anglais ou d’autres langues étrangères se sont ajoutés au cursus scolaire ; pensons à l’Italie ou même à la France qui, sous François Hollande, voua à la disparition les options de langues anciennes au secondaire, puis les rétablit sous Macron à l’instigation de son ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer[14]. Au Québec, la disparition du grec et du latin dans le cursus scolaire a finalement laissé toute la place à l’anglais pour jouer le rôle de langue de référence ; mais à la différence du grec et du latin, l’anglais est une langue bien vivante, dont les jeunes Québécois font un apprentissage intensif précoce à l’école primaire et dont ils sont imprégnés par immersion du matin jusqu’au soir par les médias de tous types sous domination américaine. Au cours de leur formation primaire et secondaire, du moins à l’école publique, ils sont rarement exposés à une troisième langue, si bien que leur apprentissage du français se déroule dans l’ombre de celui de l’anglais, sans pouvoir enrichir le premier, ni relativiser le deuxième par le détour d’une langue tierce qui musclerait leur maîtrise de la grammaire, leur donnerait du recul historique et des points de comparaison autres que l’anglais dont ils sont journellement environnés. Cessant de boire aux fontaines des langues anciennes, le français est devenu au Québec une langue allégée, nue et sèche, repliée sur ses réserves propres et sommée de se bonifier — ou de s’appauvrir — au seul contact avec l’anglais. C’est ainsi qu’insensiblement, le système d’éducation québécois a destitué la langue qu’il croyait naïvement valoriser en l’accolant dans un duel monogame à l’anglais, érigé en langue tutrice pour une autre destinée aux enfants.
Le principe impérial de l’épreuve concurrentielle
Mais d’où vient cette idée étrange que le français ne puisse prétendre à l’existence qu’au travers de sa confrontation exclusive et sans répit avec l’anglais? Nous touchons ici au cœur de l’idéologie impériale canadienne. Le fondateur du nouvel ordre constitutionnel et moral canadien institué en 1982, Pierre Elliott Trudeau, nous fournira des éléments de réponse éclairants. L’intellectuel public et professeur de droit qu’il était en 1965 réalisa pour l’institut de recherche en droit de l’université de Montréal une étude qui devait à l’origine être déposée comme mémoire au « comité de la Constitution » instauré alors par l’Assemblée législative du Québec. Intitulé « Le Québec et le problème constitutionnel », ce texte formule la position de Trudeau sur les revendications politiques, à ses yeux pour la plupart excessives et mal fondées, des nationalistes québécois, et sa condamnation sans appel de toute velléité d’indépendance[15]. Il rejette notamment l’idée que le Québec devrait jouir d’un statut constitutionnel particulier parce qu’y serait concentrée une minorité linguistique de fait. Mais ce fait n’entraîne pas un droit automatique à la préservation de la langue, et encore moins à la reconnaissance d’un État national canadien-français identifié à l’état provincial québécois. Pour Trudeau, l’État n’a pas à corriger les injustices passées infligées à une minorité linguistique ni à lui accorder de traitement de faveur. Il peut certes officialiser une langue ou plusieurs, mais seulement dans une perspective individualiste et comptable, qui l’oblige à servir les citoyens dans celles des langues dont le nombre de locuteurs est jugé assez important pour justifier l’engagement de ressources publiques. En somme, les pouvoirs publics ont vocation à relayer l’état des rapports de force entre les langues sur le territoire administré ; la vitalité de telle ou telle langue dépend de valeurs culturelles que l’État doit se garder de protéger, d’immuniser contre l’attraction ou l’hégémonie d’une autre langue. Pour Trudeau, les valeurs culturelles d’une minorité linguistique ne peuvent légitimement survivre et prospérer que si elles ont passé « l’épreuve de la concurrence. » Il écrit : « Plus encore que la technologie, une culture ne progresse que par l’échange et l’affrontement ; or, dans le fédéralisme canadien, les valeurs culturelles françaises peuvent trouver un heureux mélange de concurrence et de protection de la part d’un État assez puissant[16]. » Assujettir sa minorité principale à l’épreuve de la concurrence, c’est là la mission fondamentale et le mérite distinctif du fédéralisme canadien selon Trudeau. Il le dit en ces termes :
[…] le fédéralisme canadien est idéal. Tout en obligeant les Canadiens français, sur le plan fédéral, à soumettre leur culture politique à l’épreuve de la concurrence, le système fédératif leur permet en même temps de se donner, dans le Québec, la forme de gouvernement qui convient le mieux à leurs besoins[17].
Qu’il faille attacher le français à la discipline d’une saine concurrence revient aussi dans les discours et entretiens du premier ministre, dont le journaliste Ron Graham a extrait quelques perles, comme celle-ci :
La langue française ne pourrait véhiculer des valeurs de progrès que si ceux qui la parlent en Amérique du Nord tiennent eux-mêmes à l’avant-garde, c’est-à-dire s’ils acceptent de rivaliser d’excellence avec les Canadiens de langue anglaise dans un combat égal[18].

C’est pourquoi donc il fallait à tout prix éviter selon Trudeau que le Canada français fasse du Québec son État national. Mieux valait introduire sur le territoire même du Québec un régime de rivalité linguistique qui contrecarre toute velléité de l’état fédéré d’y appliquer une politique qui généralise la langue française dans tout le système éducatif. Le stratagème préconisé par Trudeau, dont il esquisse l’idée dès son texte de 1965, a consisté à consacrer de manière symétrique dans la constitution les droits scolaires des anglophones du Québec et ceux des francophones hors Québec, du moins pour l’enseignement primaire et secondaire. Ce faisant, les restrictions d’accès que l’Assemblée nationale avait tenté de mettre à l’école publique anglaise en 1977 en adoptant la Charte de la langue française tombèrent sous les coups de boutoir de la contestation judiciaire.
En réalité, c’est toutefois dans l'ordre postsecondaire que le principe de l’épreuve concurrentielle a connu son apogée, alors que dans les cycles primaire et secondaire, la Charte de la langue française a réussi malgré tout à rendre obligatoire le français dans les « classes » pour les francophones et les enfants issus de l’immigration. Dès que s’entrouvrent les portes du cégep, se dévoile un autre monde, où l’élève habitué à une langue « normale » pour ses apprentissages découvre qu'elle n’est plus qu’optionnelle, voire suppressible, doublée par l’anglais offert par des établissements publics et privés subventionnés par l’État lui-même qui se disputent le magot étudiant. La langue obligatoire, par décision collective d’une assemblée parlementaire, devient, vers l’année critique de 16 ans, un idiome qui ne concerne soudain que l’individu adolescent hésitant sur l’orientation à donner à son existence. À la société des citoyens gardiens d’une volonté collective se substituent d’un seul coup les volontés individualisées de mineurs encore à charge de ces mêmes adultes. La collectivité s’anéantit elle-même, sans héritage, sans volonté qui la précède, et s’incline devant la somme de microchoix récoltés par un encan d’inscriptions.
Si la langue française subsiste dans les cégeps et les universités du Québec, c’est donc par suite d’un concours généralisé, d’une course aux inscriptions entre établissements qui jouent de leur réputation et de leurs atouts pour remplir leurs programmes. Une course curieuse où l’on tient pour acquis qu’à la grandeur du Québec, notamment à Montréal, le français et l’anglais s’affrontent à armes égales. Supervisant cette compétition financée de ses derniers, l’état du Québec agit à la manière d’un opérateur neutre, d’une agence de cotation, d’un commissaire-priseur, qui remet aux établissements postsecondaires leurs subventions statutaires réglées sur les enchères du marché individualiste aux diplômes.
D’une certaine manière, ce marché bilinguistique qui organise tout l’ordre postsecondaire au Québec va au-delà de l’épreuve concurrentielle espérée par Trudeau. Pour ce dernier, il incombait à l’État fédéral de plier les Québécois à la discipline formatrice de cette épreuve. Or, c’est l’état du Québec qui prend sur lui de l’imposer tout entière à l’éducation postsecondaire, comme si l’État fédéral et celui du Québec ne faisaient qu’un en ce domaine. Cependant, l’épreuve concurrentielle par laquelle Trudeau voulait réformer les Québécois francophones devait les obliger à rivaliser d’excellence avec les autres Canadiens dans les institutions fédérales plutôt qu’à se rabattre sur leur petit état provincial. Or, celui-ci fait descendre cette épreuve au cœur de chaque adolescent de 16 ou 17 ans, pour faire peser sur son « choix personnel » la transmission ou pas d’une langue et d’une culture que les Québécois adultes, s’abstenant d’en décider pour l’avenir, abandonnent à leurs fils et à leurs filles dubitatifs, déjà ensorcelés par la séduction d’une langue enveloppante.
On remarquera que l’épreuve concurrentielle ne joue que de manière asymétrique, c’est-à-dire que la médecine administrée au Canada français présumé immature n’est pas pareillement appliquée au Canada anglais, qui n’a pas à se civiliser au contact obligatoire avec une culture concurrente de langue française. Le Canada anglais incarne déjà la civilisation et c’est plutôt sa pupille encore frustre qu’il doit civiliser, en anglicisant ses ambitieux méritants. Il paraîtrait inconcevable et profondément absurde à un résident de l’Ontario, de Nouvelle-Écosse ou de Colombie-Britannique que l’accès à des études supérieures en anglais soit conditionnée à l’offre, au moins équivalente en qualité et en disponibilité, d’un réseau complet d’institutions postsecondaires francophones soutenues par l’état provincial. L’Anglosaxon étant exempté de cette épreuve qualifiante de sa propre culture, il daignera certes accorder à sa minorité en probation quelques « facilités » accommodantes, un petit collège français à Edmonton ou à Saint-Boniface, ou même des universités bilingues, comme l’université d’Ottawa déjà anglicisée à plus de 70% de ses effectifs[20], concessions largement insuffisantes pour assurer la continuité de ce qui reste de français hors du Québec.
Salomé, bien-aimée patronne du Québec?
Le passage à la vie adulte, pour les individus comme les nations, est parfois long et ardu, sinon jamais achevé. Jusqu’à l’aube des années 1960, la nation canadienne-française se reconnaissait dans la figure de Saint-Jean-Baptiste. Même l’hymne national canadien original composé par Adolphe-Basile Routhier nomme le patron biblique, « précurseur du vrai Dieu ». À l’occasion des défilés patriotiques qui parcouraient les rues de plusieurs villes du Québec et même de la Nouvelle-Angleterre paradait un enfant prépubère aux cheveux bouclés, porté glorieusement sur un char allégorique en compagnie d’un agneau. Cependant, ce symbole innocent de l’âme catholique du Canada français finit par irriter le nouveau nationalisme québécois, en quête de signes de puissance et non de soumission. Déjà, en 1962, lors du défilé à Montréal, des militants indépendantistes subtilisèrent l’agneau rituel ; pour répondre à la critique, la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal avait mis en tête de la procession une statue adulte, en laissant un Jean-Baptiste juvénile fermer la marche. Mais, à partir de 1964, seul se dressa un Saint-Jean-Baptiste majeur, aux allures de géant, brandi comme l'annonciateur de la nation à naître, ainsi que le Jean-Baptiste biblique fut le précurseur de Jésus de Nazareth.

Or, d’après le récit qu’en firent les évangiles de Marc (6 : 17-29) et de Mathieu (14 : 3-12), c’est une jeune fille qui obtint la tête de Jean le Baptiste. Le jour de son anniversaire, Hérode de Galilée avait donné un grand festin où la fille de son épouse Hérodias, qui avait laissé un premier mari (le frère du roi), exécuta une danse qui charma la cour. À la suggestion de sa mère hostile au prophète qu’Hérode avait fait emprisonner, la jeune fille, qui s’appelait Salomé selon Flavius Josèphe, demanda au roi que la tête du précurseur lui fût servie sur un plat. Le Nouveau Testament n’indique pas l’âge de la belle-fille d’Hérode ; seulement les nombreuses représentations artistiques de Salomé la figurent en adolescente de 15 ou 16 ans[23].
Tout compte fait, s’il est vrai que la tête de Jean-Baptiste tomba une deuxième fois au défilé avorté de juin 1969, il semble que la société québécoise a remis par la suite le sort de son Jean-Baptiste fleurdelisé dans les mains de ses adolescents au terme de leur « fréquentation scolaire » obligatoire. Après avoir exécuté pendant dix ans un petit rigaudon gaulois en classe, ceux-ci doivent, telle jadis Salomé au palais d’Hérode, trancher une grave question : dois-je faire sauter la tête de Baptiste-le-fatiguant ?
Notes
[1] Art. 72, Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11.
[2] Art. 14, Loi sur l’instruction publique, RLRQ, C. I -13.3.
[3] Art. L131-1, Code de l’éducation, République française.
[4] Art. 8, Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, Mémorial A no 20 de 2009, Grand-Duché du Luxembourg.
[5] Art. 18,1, Loi sur l’instruction publique, déjà citée.
[6] Daphnée Dion-Viens, « Le bas âge des décrocheurs inquiète », TVA Nouvelles, 20 janvier 2020, https://www.tvanouvelles.ca/2020/01/20/le-bas-age-des-decrocheurs-inquiete-1 ,
[7] Comme le Conseil supérieur de la langue française, voir son avis La langue d’enseignement au cégep, 2011, en ligne http://www.cslf.gouv.sxqc.ca/publications/avis205/a205.pdf .
[8] Dans une étude publiée en 2015, les juristes Éric Poirier et Guillaume Rousseau concluent à l’inexistence en droit canadien d’un tel « libre choix » linguistique en matière d’éducation supérieure. Ils écrivent : « À notre avis, dans l’état actuel de la jurisprudence canadienne et québécoise, encadrer la langue d’enseignement collégial en y appliquant les dispositions de la CLF actuellement réservées aux écoles primaires et secondaires respecterait vraisemblablement les droits de la personne. La validité constitutionnelle d’une telle réforme serait sans doute confirmée au regard de l’article 23 de la Charte canadienne, du principe constitutionnel sous-jacent de la protection des droits des minorités, du droit à la liberté et du droit à l’égalité prévus dans les chartes canadienne et québécoise. » Voir Éric Poirier et Guillaume Rousseau, « L’application de la Charte de la langue française à l’enseignement collégial : étude de la validité d’une idée de réforme latente à la lumière de développements récents en droits de la personne. » Revue générale de droit, 2015, 45 (2), p.401.
[9] Art. 2, Loi pour promouvoir la langue française, L.Q., 1969, c. 9.
[10] Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public, L.Q., 1984, c. 39.
[11] Sur cette question, voir l’étude publiée dans le site de la revue Argument, Marc Chevrier, « La langue invisible. Le confinement du français dans l’enseignement supérieur au Québec », juin 2020, en ligne : http://www.revueargument.ca/article/2020-09-09/740-la-langue-invisible-le-confinement-du-francais-dans-lenseignement-superieur-au-quebec.html .
[12] Voir cette étude de l’institut de la statistique, Rémunération des salariés – État et évolution comparés, 2020, en ligne : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/remuneration-des-salaries-etat-et-evolution-compares-2020-faits-saillants.pdf .
[13] Boris Proulx, « Les francophones quasiment absents des postes clés de la diplomatie canadienne », Le Devoir, 14 décembre 2020, en ligne : https://www.ledevoir.com/politique/canada/591673/langues-diplomatie-unilingue-au-sommet
[14] Violaine Morin, « Jean-Michel Blanquer relance l’enseignement du latin et du grec au collège », Le Monde, 1er février 2018, en ligne : https://www.lemonde.fr/education/article/2018/02/01/jean-michel-blanquer-relance-l-enseignement-du-latin-et-du-grec-au-college_5250132_1473685.html .
[15] Texte reproduit dans Pierre Elliott Trudeau, Le fédéralisme et la société canadienne-française, Montréal, éditions HMH, 1967, p. 7-59.
[16] Ibid., p.40.
[17] Ibid., p. 41.
[18] Pierre Elliott Trudeau, avec la collaboration de Ron Graham, Trudeau, l’essentiel de sa pensée politique, Montréal, Le Jour, 1998, p. 147.
[19] Voir son autre essai, « La nouvelle trahison des clercs », p. 179, publié dans Le fédéralisme et la société canadienne-française, déjà cité.
[20] Sur la situation linguistique dans cette université, voir Linda Cardinal, « Une responsabilité collective. Un plan d’action pour la francophonie à l’université d’Ottawa », Université d’Ottawa, janvier 2019 :
[21] Geneviève Zubrzycki, « Aesthetic revolt and the remaking of national identity
in Québec, 1960–1969 », Theory and Society, 2013, 42, p. 423–475.
[22] Ibid., p. 460.
[23] Annick Saxton et Arnold Saxton, « Présentation de Salomé », Équivalences, 1996, 26(1), p. 21-30.