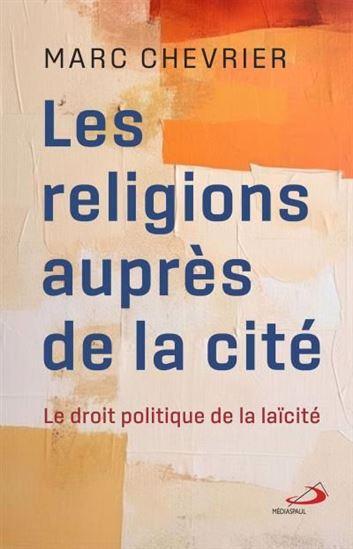Anatomie d'une certaine chute
Le cinéma demeure un outil privilégié pour propager par des procédés subtils des visions du monde et des normes sociales sous couvert d’une œuvre offerte comme divertissement. L'Anatomie d’une chute, qui a remporté la Palme d’or à Cannes en 2023, puis l’Oscar du meilleur scénario en 2024, nous fournit un bon exemple de cette fine propagande sociologique.

Anatomie d’un suspense judiciaire et conjugal
Le film plonge le spectateur dans un drame judiciaire, où la vie intime d’un couple est déballée au fur et à mesure que progressent l’enquête policière et le procès qui met en cause une écrivaine, Sandra Voyter (jouée par Sandra Hüller), accusée du meurtre de son mari, Samuel Maleski (interprété par Samuel Theis). Ce couple a un fils d’environ onze ans, Daniel, devenu aveugle depuis un accident survenu à l’âge de quatre ans, et qui joue du piano malgré son handicap, notamment la pièce célèbre du compositeur Isaac Albéniz, Asturias (Leyenda), dont la pulsation frénétique vient plusieurs fois hanter le film. C’est l’enfant qui, revenu d’une promenade avec son chien guide Snoop, découvre le corps inanimé de son père, tombé vraisemblablement du haut de la maison campagnarde où vivait la petite famille dans un coin retiré non loin de Grenoble. Le père est étendu de tout son long, le visage tourné vers le ciel et les poings fermés, la tête marquée d’une plaie sanguinolente qu’un objet contondant aurait créée. Tout le film tourne autour du sens de cette chute : est-ce un accident, un suicide ou un meurtre ? Est-il tombé de la fenêtre du grenier ou du balcon de l’étage d’en dessous ?
Une enquête est diligentée pour connaître la cause du décès. Les soupçons de la police pèsent vite sur l’épouse, en raison de son emploi du temps (elle était seule avec son mari lors du drame), d’un bleu au bras suggérant une lutte, et de ses déclarations contradictoires et incomplètes qui rendent concevable la possibilité d’un meurtre commis après une dispute conjugale survenue la veille et dont la conversation avait été enregistrée sur une clé USB par le défunt à l’insu de sa femme et dont le contenu a été révélé lors des audiences devant le tribunal d’assises qui doit juger Sandra. Les experts qui témoignent à la barre établissent que par le fait des blessures que le corps du défunt a subies, la thèse d’une chute provoquée à la suite d’un coup porté à la tête est plus probable que celle d’un suicide, que le mari aurait commis en se jetant du haut des combles où il avait l’habitude de se réfugier pour faire des rénovations auxquelles il s’appliquait méticuleusement. Or ces expertises laissent quand même subsister un doute, d’autant plus que d’autres révélations faites au procès pourraient accréditer la thèse du suicide, en raison de la culpabilité que le père aurait ressentie à l’égard de l’accident de son fils et de frustrations professionnelles, comme son incapacité à devenir écrivain, alors que sa femme avait connu le succès littéraire par ses romans. Sandra soutient même au procès, mais sans fournir de preuve autre que son témoignage, que son mari avait tenté quelques mois avant le drame de se suicider par ingestion d’aspirine, après avoir arrêté de prendre des antidépresseurs. Bref, le film est ainsi construit qu’on se met tantôt à soupçonner Sandra, tantôt à expliquer la chute par un suicide, sans jamais pouvoir trancher définitivement. Placé en étau entre son père disparu et sa mère ombrageuse et distante, le fils Daniel jouera un rôle clé dans le dénouement du procès, après avoir changé à plusieurs reprises sa version des faits, pour protéger sa mère.
La disparition de la langue maternelle
Si l’on considère le film à un premier niveau de lecture, on voit se dérouler un suspense policier et judiciaire, qui se transforme en affaire de mœurs, où les relations conjugales entre un homme et une femme révèlent peu à peu leurs tensions, leurs récriminations à demi tues et leur ambiguïté. Cependant, à un autre degré de lecture, on découvre un fait sociologiquement curieux, la langue du couple est l’anglais, alors qu’il s’agit d’un film français. Ce qui fait que le film Anatomie d’une chute se débobine en grande partie en anglais.
D’ailleurs, le film commence par une scène d’entrevue entre Sandra et une étudiante en littérature (Zoé) venue l’interroger à son domicile alpin sur son œuvre. L’entretien a lieu en anglais, sur fond de musique stridente et oppressante (celle d’un groupe Funk allemand [Bacao Rhythm & Steel Band]), devenue en fait tellement forte que l’écrivaine, qui savourait un verre de vin et avait expliqué à l’étudiante en lettres que c’était son mari qui avait l’habitude de faire jouer de la musique à tue-tête pendant ses travaux manuels, a dû mettre fin à l’entrevue. (Au procès, on suggère que son mari avait fait jouer cette musique assourdissante par jalousie.) Or, le malaise qui se crée entre l’écrivaine et l’étudiante et qui se communique au spectateur — sans doute conformément à la trame tracée par les scénaristes du film — se prolonge bien au-delà de cette entrevue apéritive et abrégée. On découvre que Sandra, d’origine allemande, parle en anglais à la maison, ainsi qu’à son avocat engagé pour la défendre, Vincent Renzi, en fait une ancienne flamme de jeunesse.
Cette circonstance à peine expliquée au début du film s’éclaire en partie lorsqu’à l’audience, on fait entendre la dispute entre Sandra et Samuel ; elle se déroule entièrement en anglais. On apprend ainsi que Samuel et Sandra ont vécu à Londres, où Samuel, un Français, s’était expatrié pour enseigner dans une institution de la capitale britannique. La question même de la langue du couple est du reste posée sans ambages dans la conversation enregistrée. Samuel s’est plaint de l’anormalité de sa situation linguistique, il parle en anglais à sa femme alors que tous les deux résident en France. L’écrivaine lui rétorque que l’anglais non plus n’est pas sa langue maternelle et que lors de leur séjour au Royaume-Uni, ils ont trouvé un terrain d’entente pour converser dans une langue tierce qui n’est la langue maternelle d’aucun des deux.
Sandra ne dit presque rien de sa langue maternelle, si ce n’est qu’elle produit de temps à autre des traductions pour des éditeurs allemands. L’allemand semble totalement absent de sa vie familiale. Ses œuvres ont connu des succès d’édition, mais le film n’aborde pas la question de la langue originale de ses écrits. De même, on ne sait trop dans quelle langue Samuel, un écrivain frustré, aspirait à écrire. Pendant la dispute, il reproche à sa femme de lui avoir volé une idée de fiction qu’il avait conçue et dont Sandra aurait fait son miel pour publier un roman dont le mérite a rejailli sur elle seule. Dans cette dynamique familiale où la langue semble un champ de bataille où s’affrontent deux belligérants aux ambitions littéraires inégalement réalisées, seul le jeune Daniel, que la perte de son père laisse inconsolable, parle une langue autre, le français, une langue paternelle que le père s’est refusée à lui-même vis-à-vis de sa femme, quand bien même ils vivraient en France.
La question de la langue de Sandra s’est posée à nouveau dans le film dans ses démêlés judiciaires. Son avocat Vincent lui explique qu’elle devra faire face à l’épreuve d’un procès devant jury, qui se déroulera en français, insiste-t-il, en laissant entendre que le français judiciaire s’imposera au détriment de l’accusée, qui devra s'exposer à une langue qu’elle dit mal maîtriser. Mais il n’empêche que Sandra, s’adressant au tribunal, parviendra à parler directement en anglais, comme si la justice française devait se plier à la langue choisie par l’accusée, qui reste de marbre devant les questions incisives que lui pose le procureur de l’État. Sans crier gare, la réalisatrice Justine Triet présente comme une évolution naturelle et logique le bilinguisme de la justice française, qui s’adapte à l’anglais d’une étrangère résidente et membre de l’Union européenne. De toute évidence, le film est conçu pour plaire à des Américains : il leur fait savoir que ce film européen, typically french, « très français » affirme Triet[2], ne les embêtera pas trop avec des langues qu’ils ne comprennent pas.
Si le film dirige l’attention du spectateur vers la solution d’une intrigue policière — Sandra est-elle coupable ou non ? —, il met aussi en scène, en toile de fond, la disparation de la langue, en tant que fait maternel. On le voit tout d’abord chez le mari, Samuel, qui visiblement souffre de ne pouvoir parler sa langue maternelle dans sa relation avec Sandra et qui a fait le sacrifice d’un bon emploi à Londres pour retourner dans son pays, en espérant se faire une nouvelle situation et se faire pardonner ce qu’il ressent comme une négligence de sa part, soit le fait de n’avoir pu prévenir l’accident qui avait frappé son jeune fils et endommagé sa vision. Et puis, Sandra refoule de même sa langue maternelle : elle n’utilise l’allemand ni avec son mari ni avec son fils et, bien loin d’être mal à l’aise dans l’usage de l’anglais, elle le parle avec force et naturel. On se demande même si ce n’est pas la langue dans laquelle elle écrit. C’est dans cette langue qu’elle renoue avec Vincent, qui vole à son secours comme avocat affecté à sa défense, qui semble timidement espérer en vain un retour de flamme, alors que le film révèle la bisexualité de Sandra, qui avait commis plusieurs infidélités féminines qu’elle a avouées lors de sa dispute. Dans ce film, la langue cesse d’être maternelle, la transmission maternelle de la langue bute sur les choix individuels de deux conjoints qui se cabrent l’un contre l’autre au point que la communion des sentiments passe par une langue tierce.
Pourtant, encore aujourd’hui, on tient pour une supposition anthropologiquement fondée que la langue connaît le plus souvent une transmission maternelle. L’expression « langue maternelle » est toujours usitée comme un indicateur d’analyse démolinguistique. Des pays célèbrent même l’idée de langue maternelle, tel que le Canada, dont le parlement fédéral qui a voté une loi pour désigner le 21 février comme jour international de la langue maternelle, belle façon de diluer le français sans cesse plus minoritaire dans un maelstrom de langues, autochtones et immigrantes, sans compter l’anglais conquérant[3]. Cependant, l’horizon du long métrage Anatomie d’une chute demeure européen. L’éclipse de la langue maternelle, que le film annonce inopinément comme un fait banal, semble se conjuguer à notre époque avec l’accession au pouvoir suprême de puissantes figures féminines, qui ont fait de l’anglais l’instrument de leur ascension. Pensons à l’Allemande Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et à la Française Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne à Frankfort, qui utilisent presque exclusivement ou uniquement l’anglais dans leurs communications publiques.
La loi et la clairvoyance au temps du pouvoir féminin
Ce qui nous conduit à un autre enjeu implicite du film, le pouvoir féminin. Il est notable que le père et le fils dans cette histoire portent des noms bibliques. Samuel, dans son sens hébraïque, signifie « Le Nom de Dieu » ou « le Nom (de Dieu) est El » selon la Bible de Jérusalem. Samuel incarnait ce qu’on appelait chez les Hébreux divisés en tribus dans le pays de Canaan, un juge, soit un libérateur charismatique qui délivre son peuple de l’oppression étrangère par sa justice, sa vaillance et sa sagesse. Samuel en particulier est doué de la capacité d’identifier parmi le peuple celui que Yahvé a reconnu pour être roi d’Israël, ce que fit le juge Samuel pour Saül et David, en sacrant chacun d’une onction d’huile. Il organisa même un tirage au sort entre les tribus pour confirmer la royauté de Saül et rédigea le pacte unissant le roi à son peuple. En somme, Samuel exerçait le pouvoir constitutionnel suprême, celui de fonder une monarchie — sans être lui-même titulaire de la royauté. Quant à Daniel, il figure parmi les grands prophètes d’Israël selon l’Ancien Testament. Son nom est dérivé de l’hébreu Dâniyyé’l, qui veut dire « Dieu a rendu justice », selon le Robert encyclopédique des noms propres. Pendant sa captivité à Babylone où Daniel est conduit pour recevoir une éducation poussée et entrer dans la cour du roi Nabuchodonosor, le serviteur montra des dons exceptionnels, dont celui d’interpréter les songes du roi ou de faire lui-même des rêves et des prophéties apocalyptiques sur la succession des empires à venir. Cependant, Daniel refusa de diviniser le roi Darius, si bien que, selon le récit biblique, le prophète est jeté dans la fosse aux lions, mais sa foi et sa fidélité au vrai Dieu le préservent de toute morsure.
Dans l’Anatomie d’une chute, la fonction législatrice de l’homme est anéantie. Le Samuel du film apparaît pour la première fois comme un cadavre renversé dans la neige iséroise, dont la tête baigne dans une auréole de sang. Peu importe que sa chute ait été causée par son suicide ou l’agression de sa femme, Samuel figure l’homme faible, qui n’a pas trouvé sa voie, frustré dans ses ambitions, rongé par l’angoisse d’avoir failli à son rôle protecteur de père et tenaillé par l’insatisfaction d’un mari qui ne sent plus le désir de sa femme. S’il existe une loi dans ce couple dont les époux font chambre à part, c’est une loi négociée âprement entre eux, à l’avantage, le plus souvent, de la femme — c’est du moins ce que Samuel laisse entendre dans l’enregistrement furtif révélé au procès. Cet enregistrement fait retentir, après les reproches que Samuel et Sandra se font mutuellement, des coups violents, sans que l’on sache qui les porte, qui les reçoit. Cette loi négociée aboutit à un chaos sentimental, au fracas indiscernable.
Quant aux dons visionnaires du fils, ils apparaissent limités. Il devient néanmoins, en dépit de sa malvoyance, un des témoins clés du procès, en raison de sa proximité avec ses parents et des lieux de l’incident. Mais sa mémoire, confrontée à des tests de l’enquête policière, se révèle incohérente et imprécise, à telle enseigne que Daniel a changé plusieurs fois sa version des faits. À la fin du film, cependant, les co-scénaristes semblent prêter à Daniel une capacité soudaine d’affabulation ou de ressouvenir, ainsi que d’ingéniosité, déterminante dans l’issue du procès. Outre le père et le fils, les autres personnages masculins dans le film se présentent sous un jour défavorable : prétentieux, « retors » et discourtois comme le procureur de la République (au crâne rasé), ou un peu terne et malléable, comme Vincent, à propos duquel on apprend qu’il n’avait pas vraiment gagné de causes avant le procès de Sandra. Vincent incarne un double de Samuel, aux dires mêmes de la cinéaste Justine Triet.
Si la loi et la clairvoyance échappent aux hommes, c’est que le film les attribue aux femmes. Le procès devant jury est présidé par une juge dont le rôle n’est pas qu’arbitral. Elle prit deux décisions qui vont changer totalement le cours du procès. La première est d’autoriser le fils et la mère à cohabiter dans leur maison pendant la durée du procès, même si le premier est témoin, et la mère, accusée. Pour garantir que la mère n’essaie pas d’influencer ou de manipuler son fils pendant leur cohabitation, une tutrice, Marge, sera nommée pour demeurer avec eux et surveiller leurs rapports mutuels. On verra Daniel développer une certaine complicité avec cette tutrice, au point qu’il lui exprimera son désir de voir sa mère quitter la maison lors des jours précédant son témoignage final. L’autre décision capitale est d’autoriser Daniel à assister au procès, y compris à l’écoute de l’enregistrement de la dispute qui déchira ses parents la veille de la chute mortelle.
Le déroulement du procès dévoile aussi clairement la nouvelle éthique du rapport entre les sexes qui doit désormais prévaloir. L’étudiante en lettres qui avait tenté une entrevue avec Sandra peu avant l’incident insiste, au moment d’être interrogée par le procureur de la République, pour se faire appeler « Madame », ne souffrant guère qu’on la désigne par la mention de son état civil. Le film, en accord avec les diverses théories féministes aujourd’hui courantes dans l’enseignement supérieur, montre l’intrication du privé et du public, de l’intime et du légal, ce qu’illustrerait un procès criminel mettant à nu la vie conjugale d’un couple peut-être mal assorti, où se déploieraient, selon ces théories, d’inévitables « relations de pouvoir ».
Or, c’est dans l’exécution même des décisions de la juge au procès que réside le vrai pouvoir. La tutrice Marge jouera un rôle crucial dans la marche du procès ; c’est elle qui tiendra le discours décisif relativement à la recevabilité et à l’appréciation de témoignages contradictoires et tous plausibles. Daniel est le dernier témoin attendu à la barre, après le visionnement de l’enregistrement qui change entièrement la dynamique du procès. Seul avec Marge pendant la fin de semaine avant son témoignage, il administre une grande quantité d’aspirine à son chien Snoop pour voir sa réaction ; l’animal tombe dans un état comateux qui ressemble à celui dans lequel il était apparu, quelques mois plus tôt, mal portant et dégageant une odeur de vomissure. Ce qui rendrait plausible l’idée que son chien ait à ce moment ingurgité les régurgitations médicamenteuses de son père qui aurait alors tenté de s’intoxiquer, comme l’avait soutenu Sandra au procès. Son chien revenant à la vie, Daniel dit à la tutrice son désarroi, ne sachant plus que croire, entre la version de sa mère — qui se disculpe de la mort de son mari, qui aurait commis l’irréparable en se jetant de désespoir du haut du grenier après une tentative ratée de suicide survenue quelques mois plus tôt —, et la version du parquet, un meurtre qu’étayent les expertises et certains faits concordants. Cédant aux demandes implorantes de Daniel, Marge lui répond que dans l’incertitude, il appartient à chacun de décider ce qui lui semble vrai, de se déterminer en fonction de la version des faits que l’on peut le mieux s’expliquer.
Or, le jour attendu de son témoignage, Daniel déclare se souvenir d’une conversation qu’il avait déjà eue en voiture avec son père après une visite chez le vétérinaire au sujet de Snoop quelque temps avant la mort de Samuel. Celui-ci, sur un ton rassurant, lui a dit qu’il devait s’habituer à l’idée que son animal de compagnie, vieillissant, ne sera pas éternel, qu’il devra un jour disparaître et que lui, Daniel, devra continuer à vivre. Était-ce une histoire inventée de toute pièce ou le reflux tardif d’un souvenir véridique et enfoui qu’un enfant livre innocemment au jugement des adultes ? Le film ne le dit pas.
Cependant, ce témoignage, à lui seul, accrédite la thèse du suicide, comme si le père avait voulu préparer son fils à cette éventualité. Celui-ci déclare même comprendre le suicide de son père, mais guère le meurtre qu’aurait perpétré sa mère. Tel est donc le « songe » final de Daniel, jeté dans une fosse aux lionnes judiciaire. Sandra est donc innocentée par les jurés (que la caméra n’avait pas montrés). Elle et son avocat vont ensuite dîner pour célébrer la victoire. Sandra n’affiche ni jubilation ni grand soulagement ; elle lui confie ne pas sentir la « récompense » qui devrait accompagner d’ordinaire un acquittement ; on ne sait si c’est en raison des remords d’une criminelle dissimulant son jeu ou de la confusion qui s’empare d’une innocente qui doit accepter le suicide de son mari. Elle ira retrouver son fils dans la maison que la tutrice a quittée ; son fils dit avoir craint le retour de Sandra, qui lui répond avoir nourri une même peur. Ils se font l’accolade, mais sans s’attarder. Sandra dormira seule, avec Snoop allongé à ses côtés.
Certains prétendent que l’Occident libéral se dirige de plus en plus vers des formes matriarcales, ou du moins matrilinéaires de sociétés. On pourra bien sûr avoir à ce sujet d’interminables discussions. Ce que nous enseigne Anatomie d’une chute, c’est que dans des sociétés où se recomposent les relations entre les sexes, où la transmission de la langue n’est plus automatiquement maternelle, où les femmes prennent une part grandissante, sinon prépondérante, dans la fabrique de la loi, les hommes continueront certes à vaquer à leurs affaires, quoique sous l’empire de certaines présomptions. Comme celle que dans l’incertitude d’une situation conjugale, il vaut mieux présumer, vu la relativité de toutes choses, la défaillance du père que la malice de la mère.
[1] Voir à ce sujet Patrick Chastenet « Jacques Ellul et la propagande », Cahiers de psychologie politique, (38), 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.34745/numerev_1398
[2] Voir l’entrevue avec Justine Triet, Distribution le Pacte, https://le-pacte.com/storage/uploads/7b2f79c5-da03-4e29-88af-0cb358cb5425/DP---ANATOMIE-D%27UNE-CHUTE.pdf .
[3] Loi sur la Journée internationale de la langue maternelle, L.C. 2023, ch. 5 (parlement du Dominion canadien).