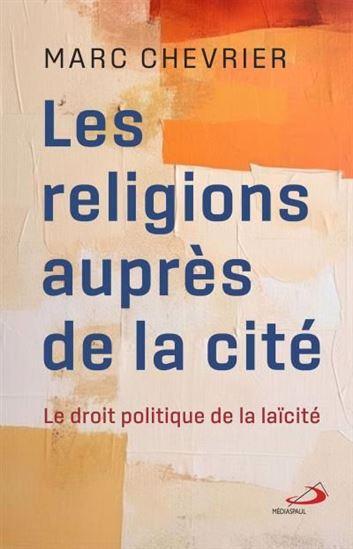Le cauchemar grammatical. À propos de l’ouvrage Malaise dans la langue française.
Que se cache-t-il derrière l’écriture dite « inclusive » que des militants et des organismes présentent comme un progrès obligatoire de la langue? Des auteurs de tous horizons nous mettent en garde contre cette nouvelle pratique dans l’ouvrage Malaise dans la langue française.

Vers un nouvel ordre langagier ?
Sous la bannière de l’écriture dite « inclusive », de nouvelles graphies du français se sont ainsi propagées, dont on réclame à cor et à cri l’application contre les défenseurs de l’ancien ordre langagier. Au nom de cette inclusivité à laquelle dorénavant la langue devrait se soumettre pour devenir « neutre » et « égalitaire », on pratique systématiquement la double flexion du féminin et du masculin, comme « les citoyens et les citoyennes », « celles et ceux », « chères et chers » ; on ajoute aux mots, précédés d’un et de deux points médians ou d’une barre oblique, un « e » supplétif pour souligner le féminin à visibiliser : « cher.es ami.e.s » ; on féminise automatiquement les fonctions, comme clowne, pompière et ambassadeuse ; on accorde les suites de mots mêlant masculin et féminin en fonction de la proximité du dernier genre mentionné dans la phrase ; enfin, on tâche de recourir à des termes dits « épicènes », assez généraux pour signifier à la fois hommes et femmes sans prêter aux uns ou aux autres une quelconque préférence. Ainsi, au lieu de parler des « citoyens », on choisira le terme « population ». Et même un dictionnaire réputé s’est ingénié à ajouter à sa liste révisable des mots entrés dans l’usage un tout nouveau pronom, « iel », qui remplacerait les incommodes « il » ou « elle », tributaires de la division sexuée et binaire de la langue. Des esprits forts en synthèse ont aussi mis sur le marché linguistique les termes celleux et toustes.
Or, tous ces changements sont loin d’être accueillis dans le plus grand des enthousiasmes. En France, le débat sur ces pratiques grammairiennes fait rage depuis plusieurs années, même si les voix dissidentes peinent à se faire entendre. Un ouvrage paru en 2022 rend justice à leurs critiques, qui montrent de l’écriture dite « inclusive » les inconséquences, les excès, les non-dits, les faussetés et les dangers. Plus d’une dizaine d’auteurs de tous horizons en font le relevé minutieux et exposent leurs arguments sans ambages. Le titre du collectif dit bien le sentiment qui anime les auteurs : Malaise dans la langue française, dirigé par le philosophe Sami Biasoni, publié aux éditions du Cerf[i].
Sauver le bien commun de la langue
L’ancien professeur de lettres et députée à l’Assemblée nationale française, Annie Genevard, sonne l’alarme dans la préface de l’ouvrage. L’écriture dite « inclusive », qui érige la langue en champ de bataille sociétal, produit en fait de l’exclusion, en compliquant inutilement la langue pour les jeunes, et l’instrumentalise à des fins politiques. On ne saurait y voir qu’une simple mode passagère, une évolution naturelle ; le bien commun de la langue serait menacé, ce dont devraient s’inquiéter les pouvoirs publics.
Sami Biasoni souligne dans son propos liminaire que c’est pour former une « citoyenneté éclairée » et ne pas abandonner les débats sur la langue aux experts que les auteurs de l’ouvrage y ont rassemblé leurs principaux arguments relativement à ce qui cloche avec l’écriture dite « inclusive ». Contre les coups du butoir des militants qui désespèrent de conformer la langue à leur idéologie, il faut garder en tête la plus fondamentale des libertés exigibles « dans une société saine et apaisée : celle de disposer d’une langue intelligible, commune et axiologiquement neutre ».
Biasoni prend soin de cerner le phénomène : « On utilise, en France, l’expression “écriture inclusive” pour désigner l’ensemble des pratiques et contraintes appliquées à la langue afin qu’elle traite également les individus selon leur sexe. En Suisse, il est, dans cette optique, question de “rédaction non sexiste”, comme si, dans l’un ou l’autre cas, la langue telle qu’elle est serait discriminatoire. » Biasoni constate qu’au sein de l’État français règne une cacophonie langagière. Alors que certains organismes de l’État parrainent des guides d’écriture dite inclusive, on s’est déjà chamaillé à l’Assemblée au sujet de la formule « Madame le/la Ministre ». La pratique de cette écriture bute rapidement sur la lourdeur des procédés qu’elle encourage, note Biasoni. Ainsi s’agissant du point médian accroché aux mots pour neutraliser leur apparence masculine, Biasoni observe que « de nombreux usagers ne l’utilisent que partiellement, la plupart du temps pour signifier leur engagement idéologique. » Ce genre d’écriture détourne l’attention portée sur le discours pour signaler plutôt la moralité affichée de la personne qui en use. La vertu grammaticale rime donc avec la tartufferie.
L’écriture dite inclusive au regard de la linguistique
Mais qu’en pensent les linguistes, qu’un tel sujet devrait interpeler ? Dans un texte sur l’histoire du genre dans la langue française, Yana Grinshpun fournit de précieux éclairages sur cette notion qui suscite aujourd’hui malentendus et confusion. Provenant de l’indo-européen gene, le genre signifiait originellement « donner naissance » et a servi de base pour nommer les choses et les êtres selon qu’ils sont considérés comme animés ou inanimés. Les êtres animés se sont déclinés en deux catégories, féminin et masculin, des notions qui sont essentiellement des faits de langue, qui ne décrivent aucunement le sexe ou la sexualité des êtres ainsi classés. C’est pourquoi il faut distinguer en français le genre morphologique du genre sémantique, le premier indiquant les mots portant la marque du féminin ou du masculin, alors que le deuxième vise le sens extralinguistique des mots. On voit la complexité du genre grammatical à travers le mot « Génoise », qui peut signifier à la fois une habitante de Gênes et un type de biscuit. Que la langue recoure à deux genres grammaticaux, masculin et féminin, ne constitue pas un fait linguistique universel. Plusieurs langues ignorent ce type de distinction ou divisent les mots autrement. Le grec ancien et le latin comportaient, outre le masculin et le féminin, le neutre. Influencé par ces deux langues, le français en a repris quantité de mots, issus du neutre en grec et en latin, qui ont été féminisés ou masculinisés en français. Cependant, en latin, le masculin et le neutre possédaient des terminaisons similaires, comme librum (masculin en latin à l’accusatif) et templum (neutre en latin) ; le masculin est donc apparu en français comme le prolongement naturel du neutre du latin et a acquis ainsi la qualité de « genre par défaut », souligne Grinshpun, qui le définit comme « le genre dans lequel le féminin et le masculin se trouvent dans un rapport d’inclusivité. »
Au cours des siècles, le genre des mots a beaucoup varié, à tel point que Nicolas Boileau a qualifié le français dans sa XIIe Satyre de langage « bizarre hermaphrodite ». Il fut un temps où l’on écrivait une arbre, comme chez Rabelais, une art, un cuiller, etc. Mais est-on justifié d’affirmer que le français a subi des cures de masculinisation, comme le claironnent les « inclusivistes » militants d’aujourd’hui ? La réponse de Grinshpun est formelle : « Les inclusivistes présentent régulièrement le travail des grammairiens comme la transposition directe des sexes sur la langue. Or, il s’agit là de leurs propres projections que seuls les psychanalystes peuvent analyser ». Au banc des accusés siègent les grammairiens du XVIIIe qui auraient prétendument infligé à la langue la domination masculine. Ces grammairiens, selon Grinshpun, connaissaient toutefois fort bien le caractère arbitraire de la division genrée des mots, qui n’établissait aucun lien logique et stable avec la qualité des êtres ainsi catalogués. Bien loin de consacrer le monopole des hommes sur la parole, ces grammairiens ont plutôt reconnu le rôle crucial des femmes pour façonner et « lisser » la langue, notamment dans les salons, où elles arbitraient le bon usage. Un grammairien comme Antoine Furetière a pu même penser que le français penchait vers le féminin. « Le génie de notre langue est de féminiser les mots autant que l’on peut », écrivait-il en 1690. Bref, selon Grinshpun, les inclusivistes méconnaissent l’histoire et la morphologie de la langue française et cherchent à tout prix à régler son fonctionnement sur leur vision du monde, qui est le fait d’une « minorité élitiste, revendicative et narcissique. »
Cela dit, le français, devenu la langue nationale de la France, à la faveur de l’école publique, a participé à ce que des historiens ont appelé le « roman national » et a servi un dessein politique. Or, souligne le professeur de lettres Xavier-Laurent Salvador, à la suite de Roland Barthes qui affirmait que « [l]a langue est fasciste » et des travaux de penseurs comme Bourdieu, Foucault, Deleuze, etc., on s’est fait gloire en sciences humaines de diaboliser ce dessein et d’ériger ainsi « la critique de l’orthographe-grammaire » en critique sociale dans le but avoué de « lutter contre l’académisme » et de « détruire le consensus orthographique ». À travers la refonte de la langue on croit pouvoir, sur des bases en réalité peu scientifiques, changer la société tout entière. Salvador sort de l’oubli la figure attachante de Geoffroy Tory, peintre et graveur, qui fut aussi « réformateur de l’orthographe et de la typographie sous François 1er ». On lui doit le premier emploi du mot « orthographe » dans la langue française qui, à l’époque, était tiraillée entre les emprunts savants au grec et au latin, l’omniprésence de l’italien dans les facultés et le souci, dont Tory a formulé les exigences, de favoriser une littérature qui parle à tout le peuple, qui lui ne parle ni latin, ni grec. De plus, Tory a salué l’action déterminante des femmes pour fixer la bonne prononciation de plusieurs mots, dont l’habitude de ne plus prononcer les « s » finaux du pluriel, sauf « quand le mot suivant commence par une voyelle ». Les Parisiennes, en particulier, auraient défini les règles de la liaison des mots dans la langue orale.
Salvador ne nie pas que la langue ait subi l’influence des idéologies au cours du temps ; c’est en fait une évidence ; seulement, il trouve réducteur de n’y voir qu’une « lutte autour du genre » alors que selon les époques, le français s’est adapté à plusieurs cultures exogènes. Les inclusivistes aiment à citer la phrase du grammairien Claude Favre de Vaugelas pour incriminer le penchant « sexiste » de la langue : « Pour une raison qui semble commune à toutes les langues que le genre masculin étant le plus noble doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin sont ensemble ». Selon Salvador, Vaugelas énonçait ici « des propositions de correction » pour une pratique grammaticale qui n’allait pas encore de soi et estime que l’adjectif « noble » ne voulait pas nécessairement dire « supérieur » au XVIIe siècle, comme l’opine l’inclusiviste Éliane Viennot, mais renvoyait plutôt à l’institution du mariage, où l’époux transmet le nom et les quartiers de noblesse. La recommandation de Vaugelas ne fut pas unanimement reçue chez les grammairiens qui l’ont suivi. Pendant le XIXe siècle, on recommanda même la prédominance du féminin. Toutefois, ce fut l’utilisation d’un manuel, « réédité plus de quatre-vingts fois entre 1832 et 1889 », dans les premières écoles primaires françaises de ce siècle qui scella le sort de la règle énoncée par Vaugelas.
Quand la militance prend le pas sur la science
Dans un texte s’employant à distinguer la grammaire militante de la grammaire linguistique, le linguiste Jean Szlamowicz a voulu montrer les assises fragiles sur lesquelles repose le discours selon lui « pseudo-féministe qui s’est constitué autour de la langue pour imposer l’écriture inclusive. » C’est par un « forçage interprétatif » que ce discours établit une équivalence entre masculin et féminin, d’une part, et mâle et femelle d’autre part. C’est même avec une certaine légèreté que ce discours a ainsi déterminé qu’il y aurait un lien évident entre le masculin grammatical générique et une vision dominatrice de la masculinité, lien en fait supposé, mais jamais prouvé, ce qui implique que des femmes, au même titre que des hommes, « Montaigne comme Simone de Beauvoir », auraient pêché par sexisme en suivant les usages de la langue. Comme si le fait de dire « il pleut » au lieu de « elle pleut » témoignait d’un privilège masculiniste ou d’un complot ourdi par les hommes pour soumettre les femmes[ii]. Comment prendre au sérieux le lien prétendu entre l’accord de genre et le patriarcat, quand plusieurs langues, telles que le finnois, le turc, le kmer, le comanche et le basque, ignorent le genre sexué dans leur système ? se demande Szlamowicz[iii]. Les sociétés qui parlent ces langues ne sont pourtant pas reconnues pour avoir pratiqué de toute éternité l’égalité entre les sexes.
De plus, le discours inclusiviste postule que la langue influence la pensée, et donc véhicule les injustices de la société. Or, ce déterminisme linguistique reprend la « doctrine depuis longtemps dépassée selon laquelle les peuples se voient dicter leur pensée par la langue qu’ils utilisent. » En effet, « [l]a correspondance entre langue et société n’est pas de l’ordre de l’influence parce qu’une langue ne pense pas à la place des individus. » Quant à l’idée que l’écriture dite inclusive aide à « visibiliser » les femmes, Szlamowicz juge que cette métaphore n’a aucun sens sur le plan grammatical. On peut affirmer qu’une femme est médecin-urgentiste ou mannequin sans que le masculin grammatical emporte la disparition de la femme biologique concrète qui exerce tel ou tel métier. C’est comme si les formes de la langue devraient refléter l’organisation sociale.
En réalité, dans le système de signes propre à la langue, les mots ne créent pas de similarité ou d’appariement automatiques et substantiels avec ce qu’ils nomment, être vivants ou inanimés. La langue permet d’employer indifféremment des termes masculins et féminins pour nommer des êtres féminins et masculins et les fonctions qu’ils occupent. Outre la variation du genre, le français s’amuse à nommer des réalités tantôt par le singulier, tantôt par le pluriel (les eaux du Gange, l’eau de pluie), avec une liberté déconcertante. « L’écriture inclusive, écrit Szlamowicz, impose la morale comme fondement d’une monovalence sémantique que la réalité empirique des langues dément. » Ce discours qui importe l’anglicisme gender dans la langue française pour attribuer aux mots l’équivalent fixe d’une identité sexuelle constitue selon Szlamowicz un détournement de la linguistique scientifique, dont les principes d’objectivité et de factualité le cèdent à la « militance socio-sexuelle ».
L’arrière-plan idéologique de l’écriture dite inclusive
Cette pratique orthographique, qui curieusement ne touche pas à la langue orale, prospère grâce à un arrière-fond idéologique que plusieurs auteurs de l’ouvrage ont tenté de cerner. Pour les philosophes Mazarine M. Pingeot et Jean-François Braustein, l’écriture dite inclusive se nourrit de courants de pensée américains, le pragmatisme et le féminisme radical de Judith Butler, célèbre pour sa théorie du genre. Celle-ci, note Pingeot, s’appuie sur la performativité du langage, un terme savant qui désigne la possibilité pour un locuteur de créer de la réalité par son seul acte d’énonciation, ce que fait un juge quand il déclare : « la séance est ouverte ». Pour Butler, le « sexe » est assigné à la naissance, par la simple puissance performative du langage, ce qui laisse entendre que cette désignation est arbitraire, imposée de l’extérieur sur l’enfant au genre supposé indéterminé. L’écriture dite inclusive se construit sur le sentiment de toute-puissance qui accompagne le sujet qui croit pouvoir ordonner l’univers social et la langue à son identité, appelée à se libérer de tout carcan normatif. Ce faisant, c’est la dimension symbolique de la langue qui s’en trouve amoindrie ou même niée, puisque la langue est habituellement un système de signes qui font un écart avec le réel signifié ; les mots ne sont pas des images concrètes, des représentations purement analogiques, de ce qu’ils sont censés désigner. Ils pratiquent avec le réel une distance — une altérité — que l’écriture dite inclusive voudrait combler par un « social sans dehors », constitué d’identités autoproclamées réfractaires à toute terminologie qui s’éloignerait de leur perception d’elles-mêmes.
Du déni du symbolique, on passe ainsi selon Pingeot au littéralisme, le mot devenant ainsi la chose ; il se confond avec la différence sexuelle vécue et réfractée dans la société en une myriade d’identités refermées sur leur particularité revendiquée. L’écriture dite inclusive, bien loin d’enrichir la langue, l’appauvrit, notamment celle que nécessite l’écrivain pour jouer des mots et des conventions. Elle ressemble plutôt à la froide langue administrative dont Kafka a dépeint l’enfer dans La Colonie pénitentiaire ou Le Château. Ce littéralisme grammatical s’inscrit selon Pingeot dans une tendance plus générale de nos sociétés où, à la faveur du règne horizontal d’internet, l’écart entre le réel et l’idéal n’est plus toléré, et l’égalité est rabattue sur la mêmeté.
Le linguiste François Rastier a également souligné l’étrange propension au littéralisme qui caractérise selon lui le discours sous-jacent à l’écriture dite inclusive, en particulier excluante pour « les dyslexiques, dysphasiques et dyspraxiques » confrontés à des mots imprononçables et indécodables. Il y a quelque chose de superstitieux dans le littéralisme, rappelle Rastier, en citant Montesquieu qui disait que « La superstition est la mère du sens littéral. » C’est que les mots auraient la vertu magique de correspondre, en raison de leur apparence graphique, aux êtres et aux choses auxquelles ils renvoient. C’est ce littéralisme qui voudrait que les mots soient des signaux univoques, dont la signification est ramenée systématiquement à sa dimension genrée ou sexuelle, ce qui pousse certains à écrire individu.e quand ce terme désigne une femme.
Ce littéralisme confond aussi l’usage et la mention d’un terme. Le seul fait de prononcer un mot tabou ou chargé d’une histoire douloureuse dans une classe peut valoir à l’enseignant qui croyait faire œuvre de pédagogie anathème et lynchage médiatique, si ce n’est pas la perspective d’une perte d’emploi. La langue perdant sa subtilité symbolique se transforme alors en code évocatoire, qui cherche à purifier le langage en ligotant les mots à des référents préterminés, conformes à une doxa idéologique. Rastier voit un lien entre la désymbolisation de la langue dont l’écriture dite inclusive fournit une autre manifestation et l’effet nivelant de l’informatique, qui aplatit la langue, réduite à « des mots-clés, symboles décontextualisés devenus signaux. » Le littéralisme aboutit à de loufoques assertions, comme celle de l’inclusiviste Éliane Viennot, pour qui l’accent aigu en français se compare au pénis dressé.
De la gnose à la tentation totalitaire
Comme Pingeot et Braustein, Rastier constate que l’écriture dite inclusive s’appuie sur la théorie de la performativité de la langue, reprise par Butler, mais aussi par le penseur du postmodernisme, Jean-François Lyotard. Mais si savante que paraisse cette théorie, elle renoue avec la magie. « Quand l’esprit transforme la matière par profération, on entre dans le domaine de la magie », écrit Rastier, qui relève également la dimension religieuse contenue dans cette théorie[iv]. De même, pour Braustein, l’écriture dite inclusive apparaît comme « une sorte de corollaire linguistique de la théorie du genre », qui postule la fluidité des identités dites genrées et que le corps humain forme un pur produit du discours. Ce type de théorie s’assimile selon Braustein à la « gnose, pour laquelle le corps est tout à fait inessentiel. » (En effet, la gnose s’est avérée dans l’histoire une forme de connaissance ésotérique qui a aspiré à délivrer l’âme de ses attaches charnelles.) L’écriture dite « inclusive » s’ajoute donc à l’arsenal déployé par les adeptes de la théorie du genre pour neutraliser la différence sexuelle à travers une refonte du langage lui-même. Toutefois, cette ambition, constatent aussi bien Braustein que Biasoni, risque de buter sur les contestations des « non-binaires » et des trans, que pourrait offenser une écriture qui exalte paradoxalement les marqueurs orthographiques du féminin et du masculin.
Braustein et d’autres auteurs de l’ouvrage soulignent également la dimension totalitaire que couve le projet de l’écriture dite inclusive. Le philosophe évoque la langue artificiellement remaniée sous le Troisième Reich et la dystopie langagière imaginée par les écrivains Zamiatine et Orwell. S’appuyant sur le témoignage de Vaclav Havel, il observe que l’écriture dite inclusive sert à « créer un climat global d’intimidation » et à « essayer de persuader chacun qu’il n’est maintenant plus possible d’écrire dans l’“ancienne langue”, l’“oldspeak”, désormais chargée de tous les péchés. » Le caractère orwellien de l’entreprise est de même souligné par l’essayiste et sociologue Mathieu Bock-Côté, pour qui l’écriture dite inclusive a fourni au régime diversitaire qui gouverne aujourd’hui l’intelligentsia sa novlangue distinctive, promue « en signe ostentatoire de ralliement à ses dogmes ». Écrire en français normalisé ne va ainsi plus de soi ; il entraîne alors un coût politique et s’inscrit dans la « dissidence orthographique ».
L’écrivain Jean-Michel Delacomptée voit également entre cette écriture et le néoparler décrit dans le roman 1984 de troublantes similitudes, en particulier la réduction de la langue à des oppositions binaires et la contraction de la pensée par le toilettage des mots et de leur capacité à exprimer des nuances. Selon Delacomptée, la démocratie se fortifie de la richesse du langage, alors « que sa pauvreté constitue l’instrument premier des régimes totalitaires. »
Le féminisme contemporain divisé
L’ouvrage Malaise dans la langue française a le mérite d’illustrer le fossé qui sépare les féministes dites universalistes et celles qu’on nomme communément différentialistes ou néo-féministes, parmi lesquelles la pratique de l’écriture dite inclusive recueille de nombreux appuis[v]. Connue pour sa critique de la théorie du genre qu’elle a comparée à une forme nouvelle de puritanisme (La théorie du genre ou le Monde rêvé des Anges, Grasset, 2014), Bérénice Levet s’inscrit en faux contre les transformations que les néo-féministes ont voulu infliger à la langue française, à commencer par la féminisation systématique des titres, dont Yvette Roudy, ministre du gouvernement Fabius, a trouvé l’inspiration lors d’une visite officielle au Québec en 1983. En réalité, le néo-féminisme français a puisé ses idées en Amérique et en Europe du Nord pour soumettre la langue à une exigence croissante et sans limites de visibilité du genre féminin dans la langue même, au mépris des qualités et des propriétés de la langue française qui lui avaient assuré universalité et lisibilité.
L’écriture dite inclusive obéit en fait à une logique de séparation systématique des sexes, en empêchant qu’un genre grammatical particulier ait une valeur extensive et non marquée. Que ce soit l’usage de la double flexion, du point médian ou de marqueurs du féminin pour rendre visibles les femmes dans la langue, Levet juge toutes ces inventions impraticables ou vaines, d’autant plus que « sous couvert de servir la cause des femmes, on les avilit, les infantilise, les rabougrit en les enfermant dans le cercle étroit de leur identité sexuée. » Le bannissement de la valeur générique du masculin grammatical revient à dire selon elle qu’il n’y a rien de commun entre les hommes et les femmes. Ainsi le français, dans lequel Descartes écrivit Le discours de la méthode pour être compris des deux sexes, cesse d’être une langue conçue pour s’arracher de sa condition. Dans la cohorte des termes importés des États-Unis qui se sont imposés en France et ont précipité une certaine décomposition de la syntaxe et du lexique, Levet a vu également des mécanismes ressemblant à ceux que Victor Klemperer a décrits dans La langue du Troisième Reich. Elle termine son article en citant André Gide : « Un peuple qui tient à sa langue est un peuple qui tient bon ! ».
Bérénice Levet n’est pas seule dans son combat contre la féminisation des titres. Nathalie Heinich, sociologue de l’art internationalement connue, revient dans l’ouvrage sur un texte qu’elle avait déjà publié en l’an 2000 (et reproduit en annexe), où elle expliquait pourquoi le féminisme doit viser non à féminiser systématiquement les termes lorsqu’ils se rapportent aux femmes, mais à mettre en suspension la différence sexuelle quand elle ne s’avère pas pertinente. Plus encore que leur identité sexuée, c’est le plein potentiel des femmes en tant qu’êtres humains qui doit transparaître dans les usages linguistiques. Cet universalisme devrait ainsi tirer avantage du masculin qui « fait office de neutre », pour mettre en avant la liberté des femmes de se définir comme telles quand cela leur importe, peu importe le genre grammatical des termes utilisés pour décrire leurs activités. Il s’agit, en quelque en sorte, d’aspirer « au repos du neutre ». Elle constate que ses arguments contre l’écriture dite inclusive n’ont pas été entendus par les néo-féministes qui, cédant aux sirènes du communautarisme et d’un égalitarisme poussé jusqu’à l’absurde, ont miné le socle commun de la langue, au grand dam des plus faibles, « les peu dotés en capital linguistique ».
L’écriture dite inclusive est-elle contraire au droit constitutionnel et administratif ?
L’ouvrage se termine par l’analyse juridique d’Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public. La langue française jouit d’un statut constitutionnel dans le pays de Molière et de Colette depuis 1992 seulement, même si en 2008 la France a reconnu des langues régionales sur son territoire. La France n’a certes pas attendu 1992 pour légiférer relativement à la langue. Le français est institutionnellement normé depuis la création de l’Académie française en 1635, fondée par le pouvoir royal pour « fixer la langue » et en « maintenir le caractère et les principes ». Dans l’exercice de ses fonctions, l’Académie peut être assimilée à une cour supérieure. Or, à deux reprises, en 2017 et 2021, elle a condamné l’usage de l’écriture dite inclusive, entre autres parce qu’elle « offusque la démocratie du langage » et fabrique une langue seconde écrite dont la complexité risque d’échapper aux personnes souffrant d’un handicap cognitif. De plus, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont établi que les normes édictées par le législateur national doivent se conformer à des critères d’intelligibilité et d’accessibilité, que l’on peut faire remonter à la fameuse ordonnance adoptée par François 1er en 1539 au château de Villers-Cotterêts pour faire du « langage maternel français » la langue de la justice — ordonnance que cite Delacomptée dans son texte. Cette ordonnance, en effet, exigeait que les « arrêts soient clairs et compréhensibles » et écrits sans susciter de l’ambiguïté ou de l’incertitude.
Le Pourhiet estime que pour mettre le holà à la « pratique pernicieuse » de l’écriture dite inclusive au sein même des institutions publiques, le législateur français dispose des outils juridiques requis pour imposer « l’usage obligatoire d’une terminologie officielle. » Chose amusante, le président Emmanuel Macron a décidé de convertir le château de Villers-Cotterêts en Cité internationale de la langue française, qui devrait ouvrir ses portes au printemps 2023. À quelle langue exactement trinqueront les dignitaires de Belgique, de Suisse, de Tunisie, de Moldavie, du Vietnam, du Gabon, du Sénégal, du Québec, de Madagascar, de Roumanie et du Nouveau-Brunswick lorsqu’ils se réuniront sous les belles voûtes en caissons ornés du château ?
Le retour du cratylisme
À plusieurs reprises, le bel et riche ouvrage Malaise dans la langue française, qui gagne à être lu dans tous les continents de la francophonie, a mentionné le dialogue de Platon où celui-ci s’interroge sur la nature du langage, soit le Cratyle. Ce nom est resté dans le langage savant pour signifier, par le vocable de cratylisme, la théorie qui sous-tend le projet de l’écriture dite inclusive, à savoir « que les noms, quand ils sont bien établis, ressemblent aux objets qu’ils désignent et qu’ils sont les images des choses » et que « quand on sait les noms, on sait aussi les choses[vi]. » Cette vision naïve du langage comme le dit Heinich, qu’on croyait rejetée dans l’histoire des idées anciennes en linguistique, renaît avec une prospérité déconcertante dans nos maisons d’enseignement, tentées par le littéralisme. Nous voilà peut-être entrés dans ce que la grande poétesse italienne Christina Campo a appelé le « cauchemar horriblement littéral où tout a valeur de ce qu’il paraît[vii]. »
[i] Référence exacte : Sami Biasoni (dir.), Malaise dans la langue française, Paris, Cerf, 2022, 258 p, ISBN : 978-2-204-14546-6.
[ii] Voir aussi ce que Szlamowicz en dit dans son ouvrage Les moutons de la pensée. Nouveaux conformismes idéologiques, Paris, Cerf, 2022, p. 44.
[iii] Yana Grinshpun et Jean Szlamowicz fournissent une liste plus complète des langues qui ignorent le genre dans leur système ou fondent le genre sur autre chose que l’opposition sexuelle. Voir leur article « Le genre comme catégorie linguistique », dans Yana Grinshpun et Jean Szlamowicz (dir.), Le genre grammatical et l’écriture inclusive en français, Observables, no 1, 2021, p. 26.
[iv] L’aspect magique du littéralisme inclusiviste est également souligné par Jean Giot, « Aspects problématiques de l’écriture inclusive pour l’épistémologie linguistique », dans Yana Grinshpun et Jean Szlamowicz (dir.), Le genre grammatical et l’écriture inclusive en français, Observables, no 1, 2021, p. 168.
[v] Sur les pratiques langagières du néo-féminisme, voir aussi les analyses publiées par Yana Grinshpun, Chantal Wionet et Sonia Branca-Rosoff, dans Yana Grinshpun et Jean Szlamowicz (dir.), Crises langagières. Discours et dérives des idéologies contemporaines, Paris, Hermann, 2022. Voir la partie III Le discours de l’intimidation.
[vi] Platon, traduction Émile Chambry, Protagoras, Euthydème, Gorgias, Ménexène, Ménon, Cratyle, Paris, Garnier, 1967, p. 465 et 470.
[vii] Voir Une Digression sur le langage. En italien : l’« incubo orrendamente letterale dove tutto vale quel che sembra ».