La religion en Occident: Grandes ou petites vérités?
Août 2013. Je redécouvre ce texte, qui fut d'abord une conférence, mais une conférence écrite, plus de trente ans après sa publication. J'ai le sentiment de retrouver un classique, un écrit savant et pourtant marqué par la plus haute inspiration, celle d'un homme pour qui la vérité, même quand elle l'oblige à renoncer aux illusions constitutives de son histoire, personnelle et collective, est toujours bonne à dire. «Lucidement maintenue, écrit-il, la mémoire comporte des "souvenirs dangereux", c'est-à-dire une sympathie pour ceux qui hier ou avant-hier passèrent par des épreuves, un sens donc de la solidarité avec les morts, les vaincus et les désespérés. Le souvenir de la souffrance des hommes d'autrefois nous libère du souvenir de nos seules souffrances à nous, souvenir que chaque vainqueur en puissance qui existe en nous cultive avec dilection.» JD
«Depuis une décennie, les intellectuels chrétiens ont beaucoup parlé de sacré, de spiritualité, de quête spirituelle, d'esprit religieux. On a appris un nouveau vocabulaire: au lieu de Dieu, on a parlé du point Oméga, de la transcendance, de la religion et de la culture; pour ceux qui ont lu Tillich il y a, bien sûr, l'ultimate concern. L'essor de ce nouveau jargon indique un net décrochage par rapport à d'anciennes préoccupations: on apprend le langage abstrait, généralisateur, de celui qui pose sur sa vie spirituelle le regard objectif qu'il veut poser sur tout ce que font les humains.
Mais rappelons ici l'avertissement de Rousseau: "une des commodités du christianisme moderne est de s'être fait un certain jargon de mots sans idées, avec lesquels on satisfait à tout hors à la raison (1)." Tout ce beau langage, qu'il soit phénoménologique, sociologique, psychologique et maintenant religiologique, emplit notre tête de généralisations sur la religion. Il prend la succession du jargon théologique. Je doute qu'il nous aide à vivre. Et surtout je crains que ces nouvelles belles et bonnes grandes vérités soient tellement générales, tellement soucieuses de cerner l'homme religieux dans ce qu'il a d'universel qu'elles nous empêchent de nous pencher sur notre passé spécifiquement chrétien. En nous cachant d'où nous venons, tout ce discours risque bien de ne pas réussir à nous dire ce que nous sommes et où nous allons.
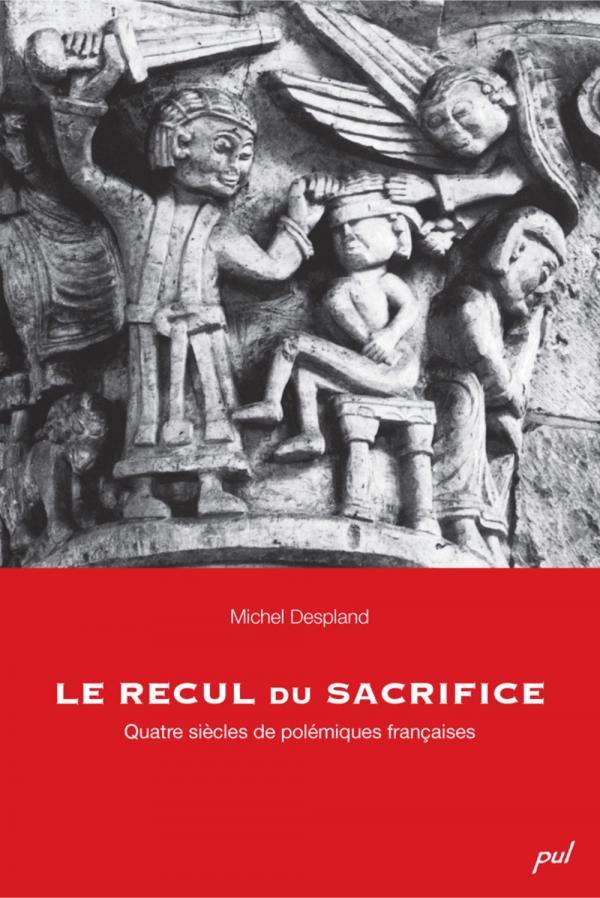 En fait, est-il nécessaire de le redire, notre quête spirituelle, notre vie religieuse, notre sens du sacré - utilisons n'importe quelle expression à la mode - ont été façonnés par la religion chrétienne. C'est là un phénomène historique: la tradition chrétienne a fait ce que nous sommes. Massive, durable, pénétrante, cette tradition nous a structurés, nous et nos pères. Le Coran a été la parole de Dieu pour les Musulmans depuis 632. Il n'a été disponible en français qu'à partir de 1710. Le premier ouvrage sur l'Islam publié en Amérique française sortit en 1975, date qui vit aussi le premier ouvrage sur le bouddhisme (2). Avant ces dates, rares étaient au Québec ceux qui pouvaient parler de religion autrement qu'à la manière de chrétiens ne connaissant pas grand-chose en dehors de leur christianisme.
En fait, est-il nécessaire de le redire, notre quête spirituelle, notre vie religieuse, notre sens du sacré - utilisons n'importe quelle expression à la mode - ont été façonnés par la religion chrétienne. C'est là un phénomène historique: la tradition chrétienne a fait ce que nous sommes. Massive, durable, pénétrante, cette tradition nous a structurés, nous et nos pères. Le Coran a été la parole de Dieu pour les Musulmans depuis 632. Il n'a été disponible en français qu'à partir de 1710. Le premier ouvrage sur l'Islam publié en Amérique française sortit en 1975, date qui vit aussi le premier ouvrage sur le bouddhisme (2). Avant ces dates, rares étaient au Québec ceux qui pouvaient parler de religion autrement qu'à la manière de chrétiens ne connaissant pas grand-chose en dehors de leur christianisme.
J'ajoute un deuxième jalon d'ordre historique. Depuis le XVIe siècle européen, la religion chrétienne s'est voulue à la fois une religion savante et une religion policée. Sur ces deux points, tous les chrétiens modernes se ressemblent et font contraste avec les chrétiens du Moyen Age. Il y a lieu de rappeler que nous tous, protestants et catholiques, avons des sources au Moyen Age; mais nous en sommes sortis de manière différente. Et nous en sommes sortis parce que nos élites, tant catholiques que protestantes, se sont voulues didactiques et formatrices: elles se sont crues en possession de la vérité religieuse et appelées à l'inculquer au peuple. Chez les protestants comme chez les catholiques, il y eut, d'une part, ceux qui savent et qui surveillent: les pasteurs, probes, savants et zélés et, d'autre part, ceux qui écoutent et obéissent: les fidèles, puis les croyants qui mémorisent leur catéchisme pour apprendre ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent espérer (3).
Cette religion chrétienne omniprésente sur les terres européennes et si résolument puissante dans le façonnement des moeurs a évidemment, à la longue, suscité de profonds ressentiments. Les verdicts sévères abondent. En particulier, beaucoup font remonter un mal profond à l'impact de la conception monastique de la perfection chrétienne. Les moines étant les seuls modèles, les chrétiens, disent-ils, se sont figés dans les ornières de l'obéissance et de l'abstinence. Prenons quasiment au hasard le témoignage de deux poètes français, qui évidemment s'applique avant tout au catholicisme qu'ils ont connu. "Quand les ténèbres chrétiennes se furent abattues sur le monde occidental, écrit Aragon, l'homme n'osa presque plus rien penser (4)." Pour sa part, André Breton ajoute: "le renoncement à l'amour, qu'il s'autorise ou non d'un prétexte idéologique, est un des rares crimes inexpiables qu'un homme doué de quelque intelligence puisse commettre au cours de sa vie (5)."
A l'intérieur même de l'Eglise, les jugements sévères (aigris ou exaspérés?) ont abondé. Les plus mémorables sont ceux formulés par les intellectuels qui s'élèvent contre l'absence de liberté dans la recherche théologique. Un seul exemple suffira. En 1920, les lettres que le Père La Berthonnière envoie à Maurice Blondel contiennent les expressions suivantes: "On a fini par se laisser imposer une doctrine de l'obéissance selon laquelle on doit se comporter comme si on n'avait même plus le droit d'avoir une conscience quand on est en face de l'autorité ecclésiastique; la courtisanerie est devenue la vertu suprême (6)." "Ceux d'en haut ne demandent qu'une chose: qu'on paraisse au moins les approuver. Et si pour obéir il faut en effet paraître approuver quand on ne les approuve pas, ce sera jusqu'au bout le mensonge élevé à la hauteur d'une institution (7)".
Aujourd'hui, le chrétien sent, confusément parfois, que de tels jugements, si sévères soient-ils, sont quelque peu fondés. Tous ceux qui s'occupent de la santé des hommes savent que nos systèmes médicaux, tout en guérissant bien des maux, parfois aussi transmettent ou aggravent des maladies. Depuis des siècles, la religion chrétienne nous a invités à cheminer vers le mieux-être. Plus encore, elle a prétendu indiquer la route. Mais ce guide nous a aussi fourvoyés de temps en temps. Posons la question franchement: est-il possible aujourd'hui de réexaminer notre tradition chrétienne pour en diminuer les virus pathogènes? Pouvons-nous démontrer les mensonges? Pouvons-nous refaire le christianisme? Est-il assez en miettes pour que l'on puisse le rebâtir? La déconstruction est-elle allée assez loin (8)? Et pourrions-nous rassembler les morceaux pour en faire quelque chose de convenable?
Ici l'expérience des protestants pourrait être évoquée à propos. En particulier nous autres réformés avons voulu changer la religion. Dès le début nos théologiens ont noirci des pages et des pages pour établir qu'ils ne faisaient que remettre à l'honneur la foi biblique et celle de l'Eglise primitive. Mais dès le début nos pasteurs et nos magistrats ont aussi voulu changer la religion, changer les moeurs des chrétiens et les manières de faire dans l'Eglise: mariage du clergé, abaissement des barrières entre clergé et peuple, gouvernement de l'Eglise à partir de la base, lecture de la Bible par tous à l'école et en famille, sens individuel des responsabilités, etc. Certaines transformations accomplies semblent indiquer qu'à la longue la volonté de changer la religion chrétienne peut aboutir. Et pourtant, nous autres protestants devons bien admettre que nous n'avons pas réussi à changer la religion autant que les meilleurs d'entre nous l'auraient voulu, et que nous avons obtenu des changements qui n'étaient pas ceux que nous désirions et qui de plus semblent aujourd'hui peu désirables. (L'individualisme et l'égoïsme économique viennent tout naturellement à l'esprit.)
Voilà donc l'exercice de pensée que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Considérons la religion chrétienne non pas comme un système de croyances et de commandements, mais comme un monde de symboles qui peuplent depuis longtemps notre homme intérieur et façonnent encore notre homme extérieur. Et voyons quel travail ces symboles ont fait et font encore aujourd'hui, quelles libérations et quelles oppressions ils apportent. Faisons porter notre attention surtout sur les injustices, les souffrances causées par ces symboles qui légitiment si sourdement tant de nos habitudes, tant de nos pensées et tant de nos moeurs (9).
Mais, comme notre religion a été depuis trois siècles une religion enseignée par des théologiens, apprise dans des manuels, nous aurons parfois de la peine à pénétrer sous les doctrines et les manières de faire pour arriver jusqu'à ce foisonnement de symboles et cette vie affective qu'ils modifient. Le jugement sévère que je serais tenté de porter sur notre religion, c'est qu'elle a été trop souvent prescrite par des théologiens qui se croyaient les détenteurs d'une science complète. De plus, ces théologiens ont souvent cherché à produire de fraîches orthodoxies pour masquer les blessures causées par les anciennes. Aux théologiens conservateurs acharnés ne s'opposent trop souvent que des théologiens progressistes et conciliateurs qui élaborent une pensée perpétuellement dépassée par les événements, mais qui néanmoins cherchent toujours à enserrer la mouvance de la vie dans les filets de doctrines qu'il faut croire. Ce "jargon de mots sans idées" nous permet d'avoir toujours le sentiment de posséder la vérité, d'être du côté d'un Dieu qui voit tout, qui sait tout. En fin de compte, et je reviendrai là-dessus, ce jargon nous séduit parce qu'il prétend nous protéger des atteintes de notre commune misère.
Au lieu de mettre nos vérités générales au goût du jour, je propose donc une exploration historique. Là, j'avoue rencontrer un autre obstacle. Notre religion a une histoire riche et variée. Les historiens occidentaux connaissent aussi le passé mieux que quiconque. Pourtant, aujourd'hui, nous avons fort peu de culture historique et encore moins de connaissances lorsqu'il s'agit de notre propre histoire religieuse. Pendant des décennies, on n'en connaissait que quelques pages édifiantes, et toujours filtrées selon les exigences d'une orthodoxie cléricale. Mais comment, en 1981, redécouvrir notre histoire religieuse réelle, alors que la sensibilité contemporaine est si peu soucieuse du passé, ou si désireuse de n'y trouver qu'une image rassurante?
Peut-être le goût nous en viendra-t-il si aujourd'hui nous brassons un peu la cage de notre imaginaire chrétien. Au théologien qui marque la différence qualitative fondamentale entre l'imaginaire païen, idolâtre et naturaliste, et l'imaginaire chrétien, historique et eschatologique, je propose d'aller un peu plus loin et de voir comment, dans les faits, cet imaginaire chrétien a fonctionné. Je suggère d'emblée que l'on y trouvera beaucoup de choses à guérir. Je rappellerai aussi la définition de Malraux: "La profondeur de l'imaginaire n'est pas faite de ce que les hommes imaginent, mais de ce qui s'imagine en eux (10)."
Ces régions de notre univers chrétien restèrent longtemps inexplorées. Fort heureusement, d'excellents guides sont maintenant disponibles. J'en signalerai deux.
Tout d'abord, Jean Delumeau et son histoire intitulée La Peur en Occident (11). Ce professeur d'histoire religieuse au Collège de France a démontré qu'à partir du XVe et jusqu'au XVIIIe siècle, les élites théologiques ont réussi à transformer les peurs collectives du peuple chrétien. Au Moyen Age, les gens avaient peur de la famine, de la guerre, des impôts, de la peste, de la mort. Bref ils avaient les peurs ordinaires de gens normaux. Mais les clercs, sentant leur citadelle ecclésiastique assiégée, ont commencé à craindre les désordres populaires qui ébranlaient leur pouvoir en tant qu'élite religieuse. Ils ont pris peur des pauvres, des hérétiques, des Juifs, des femmes, du diable et de l'enfer. Par la prédication, dans les pèlerinages, ils ont communiqué ces peurs à l'inconscient collectif des chrétiens ordinaires, qui dès lors, pour leur malheur, ont eu l'imagination infectée par des virus d'origine théologique.
Comme deuxième exemple, prenons l'ouvrage récent de Maurice Bellet: Le Dieu pervers(12). Le Dieu pervers, précise Bellet, est un Dieu qui prétend donner par amour une loi d'amour qui, en fait, rend l'amour impossible. Pourquoi, demande ce psychologue, le christianisme est-il si habile pourvoyeur de névroses? La névrose chrétienne, ajoute Bellet, c'est la fuite de la personne vers l'amour idéal de Dieu et loin de tout amour humain. Cette névrose est-elle un accident de parcours, se limite-t-elle à quelques simples excès isolés? Ou serait-elle au contraire la réussite même du christianisme, c'est-à-dire ce vers quoi il tend depuis toujours à partir d'un germe de mort présent dès le début? La question paraît tendancieuse. Mais ne faut-il pas admettre avec Bellet et d'autres qu'il existe bel et bien un type chrétien de névrose. N'y a-t-il pas lieu dès lors de songer à discerner dans notre histoire religieuse, non pas quelques difficultés psychologiques isolées, mais plutôt une sorte de cauchemar collectif (13)? J'ajoute que Bellet me semble avoir raison lorsqu'il attire notre attention sur le simple fait suivant: "Là même où Dieu n'intéresse plus, où parler de lui ne rencontre qu'un silence ennuyé, parlez du Dieu pervers; l'intérêt renaît (14)." Ceux-là même qui ne s'attendent plus à trouver Dieu devant eux se souviennent encore d'un Dieu derrière eux, dont ils doivent se libérer.
Brasser la cage de notre imaginaire chrétien, rouvrir des vieilles plaies pour les mieux guérir, contourner les vérités générales, si rassurantes, si facilement apprises, que les théologues et autres idéologues nous offrent si gentiment pour un prix si modeste, la tâche est ambitieuse. Il nous faut voir des images.
Commençons par souligner quelques traits propres au XVIIe siècle, la période qui donna le ton au christianisme moderne.
Au XVIIe tous les princes et la plupart des penseurs sentent la religion menacée et veulent venir à son secours. Le tableau du Titien rend bien l'état d'esprit L'Espagne vient au secours de la religion. Les rois, épée en main, protègent la foi et la morale. La religion est sauvée grâce à la puissance de l'Etat. Au XVIIe les Etats européens mettent aussi en place les énormes machines du pouvoir. Regardez la façade de l'Escorial. C'est à partir de cet austère quartier-général que Philippe Il envoya ses ordres vers près de la moitié du monde connu. Dans le plan rigoureux de ce bâtiment, l'architecte situa une église, un monastère, une école, une caserne, des bureaux, un palais royal et un tombeau dynastique. Tous les fils du pouvoir se rassemblent auprès du roi derrière cette façade sévère et imposante. L'Eglise aussi se met à bâtir d'imposantes façades, théâtrales, propres à impressionner jusqu'à ceux qui restent sur la place, hors du sanctuaire. Voilà l'ancêtre des façades baroques: l'église du Gesù à Rome. C'est là la forme architecturale de ce que Maurice Bellet appelle le style obsessionnel de la religion au XVIIe (15). Les évêques après le Concile de Trente reprennent leur clergé en main et visent à mieux encadrer leurs ouailles. Les techniques de dressage des masses urbaines se multiplient. Les processions religieuses deviennent solennelles, le comportement dans les églises devient guindé, et saint Charles Borromée invente le confessionnal: les confessions cessent d'être sporadiques et informelles; prêtres et pénitents utilisent maintenant une machine qui permet la fabrication en série. Les maîtres de la religion transmettent au peuple leur conception de la sainteté; leur architecture et leur mobilier par leur conditionnement subtil imposent une piété, une sensibilité et une manière de vivre.
Au Nord de l'Europe, les républiques protestantes entrent dans un jeu semblable. Le pouvoir municipal adapte l'architecture monumentale à ses propres fins civiques: voyez l'Hôtel de Ville d'Armsterdam. Ici aussi on manifeste sa puissance devant la foule. En République, c'est évidemment la ville libre (ou plutôt ses élites) qui donne un spectacle au peuple.
Le XVIIe siècle façonna nos moeurs modernes aux niveaux les plus intimes: à cette période, dans de larges couches sociales, les familles se mirent à socialiser les enfants selon des modèles précis. Elles se mirent en particulier à conditionner le corps aux comportements jugés hygiéniques et décents par les élites protestantes et catholiques. Ces usages (fourchette, mouchoir, etc.) furent transmis jusque dans les campagnes. Le XVIIe introduit donc les premières habitudes de savoir-vivre de l'homme catholique et de l'homme protestant.
Je sais fort bien que la plupart de mes auditeurs sont issus de familles catholiques. Je suis sûr néanmoins qu'un peu de la sensibilité protestante s'est infiltrée en eux. Il fut un temps où le Musée du Prado n'avait aucune peinture de Rembrandt (16). Il fut aussi un temps où un petit gaspésien pouvait s'imaginer que le golf était une cérémonie religieuse protestante; il voyait les Anglais faire ça le dimanche matin, il pouvait conclure à une espèce de procession. Mais maintenant nous recevons des images venant du monde entier (Fart oriental décore nos intérieurs) et nous imitons certains comportements d'êtres qui nous étaient autrefois étrangers. Même si nous n'avons pas appris les catéchismes des autres, nous avons été affectés par leur mentalité, peut-être intimement remués par les modèles qu'ils nous offrent.

Cherchons donc à retrouver la forme originale des modèles protestants et catholiques. La Famille de paysan de Le Nain nous montre une famille catholique française du XVIIe: une grand-maman, un couple, six enfants; du pain, de la soupe, du vin; un chat et un petit chien. On est en famille dans le quotidien d'une paysannerie plutôt pauvre. Une louche traîne par terre. La vie en commun est à la fois digne, détendue et chaleureuse. L'aîné des fils joue du fluteau. Le Nain a aussi peint une famille paysanne endimanchée, au Retour du baptême. L'intérieur, toujours humble, est propret. Le nouveau-né porte de beaux atours. C'est toujours l'aïeule qui tient le pichet de vin, mais cette fois le verre est dans la main du père. Le chef de famille se trouve aujourd'hui franchement au centre; la joie se lit sur son visage. La mère et l'aïeule restent songeuses et n'ont pas l'air de partager cette euphorie.
Les protestants de leur côté prennent les nouveau-nés pour en faire des individus, plutôt que les membres d'une famille. Et ceux-ci, devenus grands, se réunissent en comité, pour entreprendre des affaires ou administrer des choses. Voici, peints par Jean de Brays les régents d'un orphelinat hollandais. Leur entreprise est chrétienne, caritative. Le comité a donc l'honneur d'une peinture officielle. Mais ces messieurs se rencontrent aussi pour des déjeuners d'affaires.
L'accès à la vie de comité, la vie organisationnelle active, est aussi ouvert aux femmes. Ces quatres bourgeoises peintes par Johannes Verspronck dirigent un hospice. On reconnaît la présidente, la main sur le registre. A côté d'elle, la secrétaire. A droite en avant, la trésorière, la main ouverte et tendue. Voici, par Frans Hals, les régents ou syndics qui gèrent les affaires d'un asile pour hommes indigents. A gauche, on reconnaît encore le geste de la trésorière toujours soucieuse d'équilibrer son budget.

La vie bourgeoise protestante assure aussi la promotion du couple. Cela commence bien sûr avec le mariage des pasteurs. La conception vétérotestamentaire du mariage est remise de l'avant. Les époux reçoivent du ToutPuissant des bénédictions quotidiennes. Voilà le pasteur Anslo et son épouse, peints par Rembrandt. Monsieur le pasteur est un homme bon; il n'est pas un mari de comédie qui bat sa femme à coup de trique; il est pédagogue; la puissance de sa parole suffit à la tenir en respect. Madame, bien sûr, est portée à la déférence face à son supérieur. On sent que ce couple n'a pas de plaisirs sinon ceux qu'autorisent la raison et la morale. Le couple bourgeois exploite avec plus de hardiesse et un peu moins d'inégalité cette légitimation biblique et pastorale. Ces deux-là, Isaac Massa et Beatrix van der Laen, sous leurs habits noirs, ont le corps content, heureux de leur association et de leurs fêtes intimes. Ils osent se faire peindre (par Frans Hals) sans leurs enfants ou avant d'en avoir. Il ne faut pas voir l'existence bourgeoise du XVIIe sous les traits des bourgeois nantis, apeurés et moralisateurs du XIXe. Lors de son émergence, le bourgeois est libéré, responsable: il a le goût d'un bonheur actif et il a pris sa vie en charge. Il veut améliorer les conditions de vie et poursuit à cette fin des stratégies individuelles ou communes. Il acquiert une discipline de travail, un goût de la vie bien rangée. Il ne vit plus le dos courbé sous les servitudes et les souffrances traditionnellement proclamées inévitables.
Au début de l'ère moderne, le catholicisme et le protestantisme se donnent aussi des images de héros qui façonnent l'idée que l'on se fait de part et d'autre du chrétien idéal.
Du côté catholique, le modèle, c'est le saint ou la sainte. Chacun évidemment connaît sainte Thérèse d'Avila, ne serait-ce que par Claire Bretécher. La placer dans son contexte économique est fort éclairant. Aux XIV, et XVe siècles, Avila était une ville prospère. Des artisans musulmans, des commerçants juifs et une noblesse chrétienne qui possédait les terres environnantes et les faisait cultiver par d'autres chrétiens, assuraient ensemble la prospérité de la ville. Avila édifia une magnifique muraille. Au cours du XVIe, l'Espagne se purifie: on expulse les Juifs et repousse les musulmans. A la fin du siècle, Avila est en pleine décadence économique. Cet état de choses dure plusieurs siècles. On trouve en ville une seule grande construction post-médiévale, le sanctuaire baroque érigé sur l'emplacement de la maison natale de la sainte. En 1981, Avila vit toujours à l'intérieur de ses murailles médiévales, et un poème loue cette ville "austère, forte, mystique et profonde enfermée dans des murailles qui la défendent et l'entourent". Que penserions-nous d'une Montréal mystique vivant encore à l'intérieur de son mur du XVIIIe? Et que pensons-nous du cheminement de sainte Thérèse? Elle naît dans une famille noble et appauvrie, son imagination juvénile s'échauffe dans l'au-delà des romans de chevalerie. Sentant monter en elle le goût des choses "terrestres", elle décide que cette voie la mènerait droit vers l'enfer; elle se fait donc violence et se contraint à adopter la vie religieuse pour rompre avec un monde où toutes les joies sont creuses. Sa mystique est travaillée par la passion de l'absolu, elle renonce à tous les bonheurs transitoires pour ne chercher que les biens éternels. Cette mystique marqua toute la Contre-Réforme. Ne pourrait-on pas discerner à sa source l'héroïsme et le dépit d'une aristocratie déchue?
Les protestants conservent, entre autres, la mémoire de Jean Calvin. Ce fils de Noyon était né à l'ombre des tours de la cathédrale. Mieux encore, son père avait prévu pour lui le bien-être de l'état de chanoine. Le fils avait fait de bonnes études. Tout semblait arrangé. Jean allait être un ecclésiastique nanti, notable urbain, brasseur d'affaires. Et pourtant au cours de ses études, le jeune homme est séduit par de nouvelles idées. A la mort de son père, une dispute financière entre la famille Calvin et les chanoines assombrit les funérailles. Jean se fâche, rompt avec la cathédrale et renonce à son poste lucratif. Jamais il ne prendra place à la Salle du Chapitre. Il rompt avec les vieilles élites en place et lie son sort à celui des nouvelles élites lettrées. Mieux, il devient le maître à penser des plus militants parmi ces hommes instruits. Il se fait l'architecte rigoureux, puis le porte-parole infatigable de l'idéologie réformée.

Cette gravure polémique (La Balance) montre l'essentiel de ce que les protestants croient avoir à dire. D'une part, il y a les corruptions de l'Eglise Romaine: le Pape, les cardinaux ct les moines. Ceux-ci jettent tiares, crucifix, clefs de saint Pierre de leur côté de la balance; et ils s'accrochent même à leur plateau. Tout cela ne fait pas le poids; du côté des réformés, la Bible à elle seule fait pencher la balance. Observez la mine des réformés: tous les hommes sobres, paisibles, sûrs d'eux-mêmes, en robes universitaires avec bonnets de docteurs. La même odeur se dégage du Chandelier, cette autre gravure polémique. Les réformés sont encore des hommes, des savants, des maîtres du nouveau savoir écrit. ils parlent au peuple qu'ils alphabétisent: ils restent tout au long les maîtres de l'écriture qu'ils commentent et expliquent. Ces gens-là ont rompu avec les superstitions de bénitiers, d'indulgences, de pèlerinages, de reliques et de cimetières. Ils organisent la scolarisation conçue dans la rupture d'avec la culture orale, la culture des conteurs et des fêtes populaires rurales et urbaines. ils abolissent ainsi le carnaval, les fêtes de dérision et mettent une sourdine au franc-parler populaire. Et surtout ces messieurs sont pédagogues: toujours ils expliquent pour commencer; ils sont aussi prêts à admonester et disposés à punir s'il le faut. Ces travailleurs implantent le dégoût pour l'existence irréfléchie. Ils respectent l'argent et organisent la monétarisation de l'économie. Ils façonnent des protestants qui sans cesse s'efforceront de rationaliser l'existence. Dorénavant tout comportement doit être prudent, calculé, économique, justifiable. Tout doit être travail payant ou adjuvant au travail payant. La parole nous est donnée pour communiquer des faits, pour marchander et pour nous exhorter mutuellement à plus d'efficacité et à la vertu. Les protestants mettent en place la mentalité nécessaire à l'essor des réalités modernes telles que le travail industriel et la bureaucratie. Et il faut être protestant pour savoir à quel point toute vie non laborieuse a pu être culpabilisée en Occident.
Voyez enfin ce classique de l'iconographie pieuse du XIXe: on y voit Calvin sur son lit de mort; autour de lui les pasteurs de Genève. Peu d'émotion, pas de larmes. En fait, nous assistons à un cours d'exégèse. Sur un pupitre posé sur le lit: la Bible. Le maître donne à ses collaborateurs une dernière leçon dans le maniement savant de l'écriture.
De telles images évoquent les grandes forces culturelles qui ont fait de nous ce que nous sommes. N'allons surtout pas sous-estimer le poids de ces traits culturels. Plusieurs auteurs soulignent que l'acculturation protestante, plus intériorisée, organisa une répression à la fois plus subtile et plus forte (17). La question est difficile à apprécier. Il est facile d'observer que dans les pays catholiques beaucoup se sont émancipés par rapport à l'Eglise catholique sans avoir réussi à s'en débarrasser. Tout comme beaucoup de protestants se sont émancipés par rapport à leur conscience protestante, mais gardent encore avec elle un commerce journalier.
Allons maintenant plus avant et cherchons à renouer avec des souvenirs mieux refoulés et plus pénibles. Je vous propose ici de nous laisser guider par le philosophe juif allemand Walter Benjamin. Nous autres Occidentaux, dit-il, avons pris l'habitude d'écrire l'histoire du point de vue des vainqueurs. Les histoires de France ou d'Allemagne s'étendent sur les victoires plus longuement que sur les défaites. De leur côté, les historiens marxistes montrent comment, au milieu des défaites, les vaincus peuvent apprendre à devenir vainqueurs à leur tour. Or, ajoute Benjamin, chaque victoire, loin d'être une étape dans les progrès de l'humanité, s'accompagne en fait d'une corvée anonyme imposée à des vaincus qui eux restent silencieux. Chaque beau moment dans l'histoire d'un groupe cache un vilain moment passé par un autre. De là sa formule: "il n'est aucun document de culture qui ne soit aussi document de barbarie (18)."
Le théologien allemand J.B. Metz a repris ce thème tout au long d'un article sur le souvenir (19). Il nous invite à cesser de concevoir le souvenir comme une valeur bourgeoise, ou comme la source des nostalgies de droite ot antithèse de l'espérance. Lucidement maintenue, la mémoire comporte des "souvenirs dangereux", c'est-à-dire une sympathie pour ceux qui hier ou avant-hier passèrent par des épreuves, un sens donc de la solidarité avec les morts, les vaincus et les désespérés. Le souvenir de la souffrance des hommes d'autrefois nous libère du souvenir de nos seules souffrances à nous, souvenir que chaque vainqueur en puissance qui existe en nous cultive avec dilection.
Avouons donc que notre ordre actuel, c'est-à-dire notre désordre contemporain, est issu de violences fondatrices. Et ces violences sont aussi celles que nous avons commises. Nous ne sommes pas les vainqueurs contents que nous voudrions être, loin de là. Mais nous avons quand même profité des défaites que nous avons fait subir à d'autres. Ces souvenirs-là sont évidemment ceux que nous refoulons le mieux.
Prenons un exemple. Vous connaissez le magnifique plafond de la basilique Ste Marie Majeure à Rome. Ces caissons ont été dorés avec la première cargaison d'or ramenée du Nouveau-Monde et que le Roi d'Espagne se fit un plaisir d'offrir au Pape. Nous avons tous admiré l'opulence d'un tel intérieur. Certains d'entre nous ont admiré la grandeur retrouvée d'une papauté qui redorait son blason après les hontes de la Renaissance. Comment avons-nous pu négliger que cet éclat fut le fruit du vol colonialiste, que cette grandeur fut bâtie sur les larmes des Indes (20)?

Et pourtant, au XVIe siècle, certains Européens virent bel et bien que notre arrivée en Amérique signifiait la spoliation des Indiens. Un dominicain espagnol, Barthelemy de Las Casas, passa toute sa vie à dénoncer l'exploitation des Indiens autorisée et aménagée par la Couronne d'Espagne. Jan Mostaert (1475-1555), peintre hollandais, peignit un épisode de la conquête de l'Amérique. On y voit une caravelle d'où sortent des chevaux et une troupe européenne cuirassée et armée jusqu'aux dents. Ces soldats poursuivent des Indiens nus: les hommes se défendent avec des gourdins, les enfants se blottissent près des femmes. L'Europe n'était donc pas tout à fait ignorante, imbue de son bon droit. Certains d'entre nous savaient fort bien ce qui se passait: ils ont nommé les crimes, les ont peints et nous ont laissé des témoignages. Pourtant nous avons vite oublié. Des millions de touristes ont vu l'or du Nouveau-Monde au plafond de la basilique, combien ont vu le modeste tableau de Mostaert dans son petit musée provincial de Haarlem?
Simone Weil a accusé les chrétiens d'avoir écrit l'histoire de leurs crimes pour pouvoir s'en glorifier. Elle a dit, en particulier, des choses fort dures sur la Bible, qui nous invite nous, les enfants de Dieu, à déposséder les autres de leurs terres pour en faire notre pays. Elle nous donne les Grecs en exemple: ils étaient plus lucides. Leur histoire "a commencé par un crime atroce, la destruction de Troie. Loin de se glorifier de ce crime, comme font d'ordinaire les nations, ils ont été hantés par ce souvenir comme par un remords. Ils y ont puisé le sentiment de la misère (21)." Ils ont ainsi appris à ne pas se flatter; ils n'ont pas refoulé les sentiments d'amertume devant la misère humaine dont nous souffrons et que nous causons. Rendons-nous tout de même cette justice: dans notre passé nous trouvons certaines voix lucides qui ont su dénoncer nos propros crimes. La majorité d'entre nous a néanmoins réussi à les oublier. En mars 1981, nous avons appris par tous les médias que le pape était allé en Bavière à Altötting, ce grand centre de pèlerinage de l'Allemagne catholique. On a négligé de nous apprendre - ou de nous rappeler - que cet illustre sanctuaire à miracles fut érigé au XVe sur les ruines d'une synagogue brûlée par une foule de chrétiens déchaînés.
Notre civilisation nous aide à oublier notre propre barbarie. (La barbarie à visage humain ne se trouve pas seulement chez les autres.) Passons maintenant à la violence que nous avons exercée sur nous-mêmes. Nous avons en effet porté atteinte à notre capacité de voir le monde tel qu'il est et de nommer les choses telles qu'elles sont.
Dans son interprétation du devenir de l'art en Occident, André Malraux découvre au début de l'ère moderne la montée de l'irréalisme et de l'idéalisation. On se met à peindre ce qui n'existe pas, ce qui n'existera jamais. On déclare les droits de l'irréel. L'imagination entreprend de créer un monde qui, pour être irréel, n'en est pas moins un monde où l'homme prétend vivre (22).
Un premier exemple vient à l'esprit. Le XVII, siècle a connu des guerres cruelles. En fait, sa première moitié est assombrie par ce que nous appelons la Guerre de Trente ans. Les historiens ne s'accordent pas sur les détails, mais l'ampleur des pertes en vies humaines est universellement admise. En 1648, la population de l'Allemagne est réduite à la moitié ou au tiers de ce qu'elle était au départ. Imaginons trente ans de guerre et, en l'an 2011, un Québec de deux millions d'habitants. Et pourtant à cette époque, la peinture officielle se met à peindre la guerre sans montrer aucune souffrance, la guerre sans sang ni larmes. Les Espagnols assiègent Breda, puis les Hollandais, défaits, affamés, donnent les clefs de leur ville. Velasquez, en 1634-35, en fait un grand tableau. Pas un blessé, par un mort, pas un uniforme abîmé; point d'amertume. Voyez les deux chefs: une courtoisie exemplaire. On dirait deux courtisans qui viennent de finir une partie d'échecs. Le vaincu est noble, le vainqueur généreux. Personne, au fond, nous dit l'artiste, n'a rien perdu. Sauf évidemment tous les blessés, tous les morts et tous les endeuillés que l'art ne montre pas. Un an auparavant, le graveur français Callot avait pourtant su porter sur la guerre un regard lucide. Il a fait de petites gravures, Les Misères de la Guerre, et non de grandes huiles. Mais il a tout vu et nous le montre. Durant la guerre, on massacre, on exécute, on règle des comptes, des soldats vivent sur l'habitant, maraudent et pillent.
L'idéalisme et l'idéalisation pénètrent jusque dans les recoins les plus intimes de notre mentalité. Malraux signale en particulier une évolution dans l'art de peindre le visage et le corps des femmes. Au XVe, siècle, la peinture flamande peint Vénus ou Eve comme femmes, com-vraies femmes en chair et en os, en sourires et en charmes. Cette peinture ne connaît que "ce qui existe (23)." Regardez cette Eve de Van Eyck. On sait que cette femme a existé: elle a touché d'autres êtres, elle a été touchée par eux. Manifestement elle connaît les joies et les souffrances ordinaires. A la même époque, l'Italie se met à faire d'admirables portraits, Dans cette céramique d'Andrea della Robbia, on reconnaît sans hésitation quelqu'un qui a existé. Cette jeune fille est surprise dans sa jeunesse: elle a la vie devant elle.

Dans sa peinture religieuse par contre, l'Italie part dans l'irréalisme. Cela s'observe d'abord dans la peinture mythologique. Cette Vénus n'existe pas. Botticelli, écrit Malraux, la peint parce qu'elle n'existe pas (24). Une femme comme cela, on n'en a jamais vu, et jamais on n'en verra. Cela ne se trouve pas dans le monde. Le même irréalisme se donne libre cours dans les portraits que Botticelli fait de la Vierge. Laissons de côté les remarques propres à un historien de l'art et passons à l'histoire de la religion: l'apparition puis le succès d'un tel art religieux signifient que la piété se fait évasion. Elle décolle des gestes corporels de l'hommage ou de la prière pour s'enfuir dans la contemplation rêveuse de beautés, qui ne sont de nulle part. Ces vierges du Perugino sont devenues classiques. C'est la Vierge belle, aimable, adorable. Beaucoup d'émotions pieuses ont été suscitées chez les jeunes comme chez les vieux par ces doux visages. Et pourtant, quelle est la nature exacte de telles émotions?
L'historien de la sexualité peut offrir ici quelques indications. Le modèle du comportement monastique a tendu aux chrétiens le piège de l'angélisme. Le chrétien parfait, pur, était perçu comme libre de tout désir sexuel, bref comme un ange. Maurice Bellet note avec raison que le Christianisme, avant de censurer les moeurs, a censuré le statut sexuel (25). Les reliques sont des ossements; libérés de leur chair, les saints sont plus puissants. La stratégie chrétienne dès lors en fut une d'occultation: on a cru qu'il suffisait d'être aveugle face à son désir pour ne pas y succomber. Ou alors on a cru qu'en connaissant son désir on pouvait le changer par la prière et y substituer un désir de choses plus pures. D'une manière ou d'une autre, le système chrétien de la sexualité n'a réussi qu'à organiser le malheur du désir, la fuite hors de notre propre vie (26).
Angélisme monastique et peinture pieuse de la Renaissance italienne convergent donc sur un point précis: le conflit entre les sexes est entièrement occulté; il n'est pas assumé (27). Les hommes rêvent pieusement à des visages ou même des corps de femmes pour lesquels ils ne ressentent aucun désir et avec lesquels aucun conflit ne saurait jamais surgir. On s'évade en pensée dans un système de perfection, dans une pureté sans tache ni conflit. Mais ce système sans conflit est impossible; il ne peut être maintenu qu'en représentation (28). La religion fournit les représentations illusoires qui permettent le mensonge. Les relations réelles entre les hommes et les femmes deviennent de moins en moins susceptibles d'être représentées et connues. Le Ciel, croyait-on, soulage de l'épreuve du désir. Et pendant ce temps, sur terre, les guerres du désir se poursuivent dans la nuit, dans des conflits inextricables dont femmes et hommes font les frais.
Ici encore l'opinion fausse, certes majoritaire, n'a pas entièrement dominé notre imaginaire. Au sud, le Caravage peint des scènes religieuses sans partir dans l'irréel. Sa Vocation de St Mathieu ne contient ni angelots, ni halo, ni nuages ambigus ou rayons de soleil douteux. La dimension religieuse se trouve dans la profondeur du drame humain. Ici le Christ qui appelle. Là saint Mathieu interpellé. Ce tableau n'eut pas l'heur de plaire; il fut rejeté. Mais il fut quand même peint et il a survécu, Au Nord, Rembrandt fait de même. Il peint L'Adoration des bergers dans une vraie étable; Le Retour de l'enfant prodigue dépeint une expérience que nous sommes tous susceptibles de vivre. Même un sujet théologique aussi complexe que Le Repas d'Emmaüs ne comporte que de la lumière et trois personnages attablés.
En fin de compte, nous pourrons peut-être voir plus clair en nous-mêmes si nous apprenons à discerner une maladie dans notre imaginaire chrétien; parmi les symboles qui foisonnent en nous, certains travaillent sourdement et constamment à nous cacher les violences que nous commettons.
1. Il y a d'abord les violences contre les autres. En chrétienté, nous avons trop souvent appris une foi qui nous masquait la crainte que nous ressentions face aux autres. Roch Carrier nous a décrit le gaspésien qui faisait un énorme détour pour ne pas avoir à traverser le village protestant (29). Cet exemple local n'est pas grave. En fait, à peine évoqué, il fait déjà sourire. Autrement plus grave et plus tenace est le composé de peurs et de haines qui depuis des siècles fabrique l'antisémitisme en nous. Les Juifs ont été vus comme les voisins rebelles, dangereux, hostiles, qui refusaient obstinément d'adhérer aux merveilles de notre foi. Y aurait-il peut-être lieu d'apprendre à voir en eux ceux qui rejettent silencieusement nos illusions chrétiennes et refusent d'entrer dans nos mensonges? N'avons-nous pas la foi en la résurrection bien facile? Avons-nous le droit de nous réjouir à l'ouïe de ce message de vie quand nous avons été si souvent porteurs de mort pour les faibles parmi nous? Prenons un exemple. Cette admirable statue de la Vierge, Ste-Marie la Blanche, se trouve maintenant offerte à la vénération des fidèles dans la cathédrale de Tolède. Fruit de l'Ecole Bourguignonne, cette Madonne ne manque pas de séduire par son sourire et par l'affection qu'elle partage gaiement avec son fils. Non loin de la cathédrale, le touriste découvre une synagogue, Santa Maria la Blanca, bâtie au XIIIe. Pourquoi donc une synagogue porte-t-elle un nom si catholique? Parce qu'en 1391, un samedi, jour de sabbat, le prédicateur populaire saint Vincent Ferrier alluma la ferveur d'une foule de chrétiens et les emmena à la synagogue massacrer les Juifs en prière. Conquise pour le Christ et sa mère, la synagogue devint une église et on y installa la Madone. Au XIXe siècle, à une période où le vent soufflait dans un sens libéral, l'évêque fut invité à renoncer au bâtiment et celui-ci fut restauré dans sa condition de synagogue. (On voit donc aujourd'hui ce qu'était le lieu de prière avant le crime.) Et l'évêque transporta la Madone dans sa cathédrale. En tant que chrétiens, pouvons-nous, aujourd'hui, osons-nous simplement éprouver de la joie devant cette statue? N'avons-nous pas aussi le devoir de savoir quels crimes ont été commis autour de cet objet, quitte à en éprouver quelque souffrance? Et que penser lorsque le dictionnaire de l'iconographie chrétienne nous avertit que saint Vincent Ferrier est parfois représenté avec des fonds baptismaux, "à cause des nombreux Juifs espagnols qu'il avait convertis (30)."
 2. En deuxième lieu, il y a aussi les violences contre nous-mêmes. Voyons quelques exemples de peintures de martyrs. La Contre-Réforme a rempli les églises de ce genre de spectacles. Saint Sébastien, tel que peint par Mantegna et le Pérugin, est le jeune homme chrétien idéal. Il a le corps transpercé de flèches et les yeux au ciel. Il est content. imberbe, propre, les membres lisses, sa masculinité évidemment ignore le désir; en fait son corps n'est que le support temporaire et négligeable d'une âme qui aspire à voir Dieu. Voyez en contraste le vilain archer païen de Mantegna. Aucune mère chrétienne ne voudrait donner sa fille en mariage à un tel homme. Et pourtant, que penser d'un corps ainsi meurtri, qui ne répand aucun sang et n'est tordu par aucune douleur? Ne faut-il pas vivre dans l'illusion la plus totale pour trouver une telle peinture édifiante? "L'homme qui n'est pas protégé par l'armure d'un mensonge, écrit Simone Weil, ne peut souffrir la force sans en être atteint jusqu'à l'âme (31)." Les chrétiens n'ont-ils pas été violents parce qu'ils croyaient avoir une âme à l'abri de la souffrance, cuirassée à l'intérieur d'un mensonge presque à toute épreuve?
2. En deuxième lieu, il y a aussi les violences contre nous-mêmes. Voyons quelques exemples de peintures de martyrs. La Contre-Réforme a rempli les églises de ce genre de spectacles. Saint Sébastien, tel que peint par Mantegna et le Pérugin, est le jeune homme chrétien idéal. Il a le corps transpercé de flèches et les yeux au ciel. Il est content. imberbe, propre, les membres lisses, sa masculinité évidemment ignore le désir; en fait son corps n'est que le support temporaire et négligeable d'une âme qui aspire à voir Dieu. Voyez en contraste le vilain archer païen de Mantegna. Aucune mère chrétienne ne voudrait donner sa fille en mariage à un tel homme. Et pourtant, que penser d'un corps ainsi meurtri, qui ne répand aucun sang et n'est tordu par aucune douleur? Ne faut-il pas vivre dans l'illusion la plus totale pour trouver une telle peinture édifiante? "L'homme qui n'est pas protégé par l'armure d'un mensonge, écrit Simone Weil, ne peut souffrir la force sans en être atteint jusqu'à l'âme (31)." Les chrétiens n'ont-ils pas été violents parce qu'ils croyaient avoir une âme à l'abri de la souffrance, cuirassée à l'intérieur d'un mensonge presque à toute épreuve?
Mais renversons le saint Sébastien de Guido Reni. Cette peinture ne dégage-t-elle pas alors une légère odeur d'obscénité? Le mensonge est-il vraiment si réussi? L£ corps humilié, ignoré, ne réussit-il pas toujours à réaffirmer son existence, fut-ce d'une manière sournoise? L'ignorance quant à nos désirs ne débouche-t-elle pas rapidement sur des perversions (32)?
Passons aux cycles iconographiques de sainte Agathe. Cette vierge et martyre fut exécutée par les païens, après qu'un bourreau lui eut arraché les seins avec des tenailles ou les eut tranchés avec des cisailles. Son martyre a été peint avec une complaisance qui m'étonne. (Voir par exemple les peintures de Tiepolo et de Zurbaran.) Quelles visions du corps féminin fermentaient dans l'esprit des adolescents et adolescentes, quels frissons passaient dans leurs corps, lorsqu'ils voyaient cela sur les murs de leurs églises? (A ma connaissance, aucun martyr masculin n'a été représenté subissant de mutilation sexuelle.) Quels secrets désirs de violence, quels désirs pervers de puissance étaient éveillés par ces images de femmes brutalisées dans les parties les plus intimes de leur corps? Voyez le contraste: saint Jacques peint par Zurbaran conserve son droit à la dignité: il meurt décapité.
Il n'y a pas si longtemps, la religion chrétienne croyait que de telles images exprimaient et enseignaient la foi. Celles-ci ne sont plus à l'honneur de nos jours. Mais faut-il s'étonner que la Curie enseigne encore dans ses écrits que Dieu ne veut pas que l'Eglise fasse des prêtres à partir d'êtres humains de sexe féminin? J'ajoute que les églises protestantes ont des pasteurs de sexe féminin qui se sentent prêtes à concélébrer le mystère eucharistique avec des évêques ou à donner la communion à des prêtres, voire même à écouter le Pape faire la confession de ses péchés. Mais quand l'oecuménisme ira-t-il jusque-là? Le pouvoir du mâle célibataire se sentirait-il menacé? Et, le cas échéant, par l'hérétique ou par la femme?
Il est temps de conclure: la religion, pouvons-nous dire, est "une recherche de ponts à lancer entre la misère humaine et la perfection divine (33)." Mais pour lancer de tels ponts, encore faut-il sentir la misère humaine. Or nous avons, profondément ancrée en nous, une pratique de la foi qui nous rassure en cherchant à nous faire croire que nous avons un pont parfait, très solide, bâti une fois pour toutes. Cette pratique de la foi nous fait croire que la misère n'existe pas pour nous ou sera bientôt abolie. C'est un mensonge: on croit se servir d'une cuirasse alors qu'en fait on reste nu ou à peine vêtu de toile. Et une fois revêtu d'une armure, l'homme s'enivre de sa force, et en glorifie l'usage au nom de ce qu'il appelle les bonnes fins. On ose alors haïr les ennemis, mépriser les malheureux, piétiner les femmes, mortifier son corps, bref commettre toutes les violences de l'illusion et du fanatisme (34).
Il faut bien le dire: notre religion nous a inculpé une foi apprise, verbale, orthodoxe, sûre d'elle-même, qui occulte le sens de notre propre misère. Elle a bâti autour de notre vie réelle une version idéologique de la foi qui parfois encore nous empêche de mesurer la portée de nos actes. Dans sa préface à l'ouvrage de Maurice Bellet, Jean Sullivan invite les théologiens à "réduire l'écart entre d'une part les idées, les mots de la foi, de l'amour, et d'autre part le corps réel de notre vie", car, dit-il, "une vérité transmise dans une langue morte est pire que l'erreur". Une erreur parfois peut réveiller (35). Il a raison. La tradition théologique chrétienne a produit beaucoup de théories déjà mortes avant d'être complètement élaborées. Nombre de théologiens ont fonctionné comme des machines qui croyaient pouvoir digérer deux mille ans de vie animée par les symboles pour en extraire de grandes vérités abstraites. Ils ont ainsi occulté la présence de la transcendance à laquelle ils voulaient rendre témoignage. Nombre de religiologues, philosophes et autres penseurs leur emboîtent le pas sur ce point avec une unanimité touchante. Eux aussi font tourner le moulin à idées pour produire une saisie d'ensemble, une leçon définitive et rassurante qui mette fin aux incertitudes et aux bouleversements. Eux aussi masquent notre misère et continuent à rendre, et les autres et nous-mêmes, misérables à notre insu. Je cite encore Sullivan: "Tout se passe comme si l'on nous avait fait une âme standard dans la cage du corps des mots qui nous dispenseraient du relais intérieur et singulier, sans que nous puissions nous apercevoir, portés que nous sommes par un milieu, acagnardés dans des mentalités, justifiés par l'enseignement, de l'artificialité de notre manière d'être et de parler (36)."
Veillons donc à ne pas réparer et renforcer cette cage de mots. Ne passons pas notre colloque à élaborer une nouvelle et meilleure théorie sur la religion et la culture. Cherchons plutôt à nous inviter l'un l'autre à une pratique plus vivace et de la religion et de la culture. Notre vie religieuse se meurt d'indigestion à force d'avoir été gavée de grandes vérités. Notre vie culturelle se trouve à son tour menacée par ceux qui ne créent pas, mais dissertent sur les créateurs. Nous avons donc, plus que jamais, besoin de petits aperçus, surtout de ces toutes petites vérités qui réussissent à ébranler les gros mensonges. Surtout, n'oublions pas qu'une telle pratique subversive de l'intelligence fait partie de nos traditions. Certes, beaucoup soupèsent maintenant ce qu'ils appellent la faillite de l'Occident, sa banqueroute intellectuelle et morale, son égoïsme et son incapacité à s'adapter aux conditions mondiales contemporaines (37). Certains n'hésitent pas à condamner notre histoire d'Occidentaux. D'autres, au contraire, réaffirment la supériorité de l'Occident avec une assurance qui m'effraie. Renvoyant ces deux partis dos à dos, je revendique sans honte mon appartenance à l'Occident parce que j'ai trouvé dans notre mémoire occidentale des souvenirs dangereux et des souvenirs subversifs. Souvenons-nous de Callot et de Jan Mostaert. Lisons Delumeau, Bellet et J.B. Metz. Nous avons eu des poètes, des prophètes, des minoritaires qui ont su décrire les crimes alors même qu'ils se commettaient dans une bonne foi entière, légitimée par l'Eglise et par l'Etat. Nous avons même eu quelques auteurs théologiques qui ont su répéter que la foi n'était ni ceci, ni cela, que la vérité n'était ni dans les propos de l'un, ni dans ceux de l'autre, et qui ont su ainsi faire une troisième hypothèse sans la déterminer, qui ont su ainsi nous inviter à un mieux, à un à venir encore absent (38). Si nous retrouvons leur tradition, derrière nos orthodoxies, nous pourrons alors, sachant taire les clichés, "retrouver le secret d'un langage dont les éléments (cessent) de se comporter en épaves à la surface d'une mer morte (39)."»
Notes
1. ROUSSEAU, J.J., "Lettre à C. de Beaumont", dans Oeuvres complètes, La Pléiade, vol. IV, p. 948.
2. MILOT, René, L'Islam et les Musulmans, Montréal, Fides, 1975; LANGLAIS, Jacques, Le Bouddha et les deux bouddhismes, Montréal, Fides, 1975.
3. Pour un examen des deux morales, catholique et protestante, voir Fuchs, Eric, Le Désir et la Tendresse, Genève, Labor et Fides, 1979, pp. 147-166. Jean DELUMEAU a cherché à faire le point sur la Contre-Réforme catholique dans Le christianisme va-t-il mourir?, Paris, Hachette, 1977, pp. 87-113; voir aussi pp. 190-207.
4. ARAGON, La Diane Française, Seghërs, p. 100.
5. BRETON, André, "Second Manifeste du surréalisme", dans Manifestes du surréalisme, Paris, NRF, p. 141.
6. BLONDEL, Maurice, Correspondance Philosophique, 3 mars 1920, Paris, Seuil, 1961, pp. 252-253.
7. BLONDEL, M., op. cit., 10 février 1920, p. 257.
8. Voir DE CERTEAU, Michel, DOMENACH, Jean-Marie, Le Christianisme éclaté, Paris, Seuil, 1974.
9. Cet effort de pensée peut s'appuyer sur l'admirable livre de Gregory BAUXI, Religion and Alienation, New York, Toronto, Paulist Press, 1975; voir en particulier pp. 252, 83. Baum note fort justement que l'analyse de la pathologie religieuse disponible dans les Ecritures, n'a guère joué de rôle central dans la prédication ecclésiastique, surtout pas dans le catholicisme, ajouterai-je.
10. MALRAUX André, La Métamorphose des Dieux, Paris, NRF, 1974, vol. 11, L'irréel, p. 115.
11. DELUMEAU, Jean, La Peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1978.
12. BELLET, Maurice, Le Dieu pervers, Desclée de Brouwer, 1979. Pour une autre étude fort éclairante elle aussi sur les outils psychanalytiques et l'interprétation du christianisme, voir ANSALDI, Jean, La Paternité de Dieu. Libération ou névrose?, Montpellier, Etudes théologiques et religieuses, 1980, hors série.
13. Ibid., pp. 23, 49, 1-80.
14. Ibid., p. 19.
15. BELLET, M., op. cit., p. 168.
16. MALRAUX, André, Le Musée imaginaire de la Sculpture mondiale, t. II, Des Bas-reliefs aux grottes sacrées, Paris, NRF, 1954, p. 12.
17. Voir, par exemple, BELLET, M., Le Dieu pervers, op. cit., p. 172.
18. BENJAMIN, Walter, "Philosophie de l'histoire", dans Poésie et Révolution, no 7, Paris, Denoel, 1971, pp. 280-281.
19. METZ, J.B., "Souvenir", dans La Foi dans l'histoire et dans la société, Paris, Cerf, 1979.
20. L'expression est de Barthelemy de Las Casas. Il écrit l'Historia de las Indias pour que cesse l'exploitation des Indiens. Voir DE LAS CASAS, Barthelemy, L'Evangile et la Force, Paris, Cerf, 1964, p. 67.
21. WEIL, Simone, "Dieu dans Platon", dans La Source grecque, Paris, Gallimard, 1953, p. 77.
22. MALRAUX, André, La Métamorphose des Dieux, op. cit., vol. 11, pp. 1, 115, 160.
23. MALRAUX, A,, op. cit., vol. 1, p. 379.
24. MALRAUX, A., op. cit., vol. I, p. 379.
25. BELLET, M., Le Dieu pervers, op. cit., p. 59.
26. Ibid., pp. 18, 24, 45.
27. VIEILLARD-BARON, J.C., L'Illusion historique et l'espérance céleste, Paris, Berg-International, 1981, p. 190. L'auteur ajoute que cette situation aboutit àdeux discours tout à fait hétérogènes: "ou bien un message de sagesse et de spiritualité qui ignore la vie sexuelle, ou bien un discours qui ne parle que de la sexualité". 2'
28. BELLET, M. Le Dieu pervers, op. cit., p. 29.
29. CARRIER, Roch, "Grand-Père n'avait peur de rien ni de personne", dans Les Enfants du bonhomme dans la lune, Montréal, Stanké, 1979.
30. RÉAU, Louis, Iconographie de l'art chrétien, p. 1330.
31.WEIL, Simone, "L'Iliade ou le poème de la force", dans La Source grecque, op. cit., p. 41.
32. Pour des aperçus théologiques tendant à revaloriser le corps, voir le no 112 de Communauté Chrétienne, "Le Corps réhabilité?", Montréal, juillet-août 1980.
33. Cette définition est reprise de Simone Weil qui, en fait, l'utilise pour la civilisation grecque. Voir "Dieu dans Platon", op. cit., p. 78.
34. Voir aussi WEIL, Simone, "L'Iliade ou le poème de la Force", op. cit., pp. 41-42.
35. BELLET, M., Le Dieu pervers, op. cit., pp. 7, 8.
36. BELLET, M. op. cit., pp. 7-8.
37. Voir les réflexions de Jacques ELLUL, Trahison de l'Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975.
38. Voir DE CERTEAU, Michel, " La Rupture instauratrice ou le christianisme dans la culture contemporaine", dans Esprit, 1971, pp. 1211-1212.
39. BRETON, André, "Du Surréalisme en ses oeuvres vives", dans Manifestes du surréalisme, Paris, NRF, p. 179.
