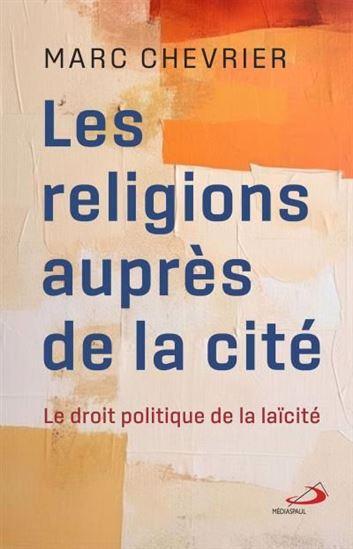La constitution d’un Québec infiniment petit
Projet de loi 96: beaucoup de bruit pour bien peu de musique
D’après Pascal, il y a deux infinis qui donnent à l’homme le vertige. Celui de l’infiniment grand, celui de l’infiniment petit. En lisant la proposition de changement constitutionnel contenue dans le projet de loi 96 déposé par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, qui doit rénover la Charte de la langue française[1], on est pris de vertige. Mais contrairement aux projets ambitieux de réforme constitutionnelle ou même d’accession à l’indépendance que les gouvernements québécois ont osé avancer pour atteindre à plus de grandeur, de liberté, de maîtrise du destin national, ce projet-ci se contente de peu, d’infiniment peu. Quelque vingt-cinq ans après le refus des Québécois d’embrasser l’indépendance en 1995, voilà qu'on propose de modifier une partie de la Loi constitutionnelle de 1867, l’ancien Acte de l’Amérique du Nord britannique à l’origine du Canada créé en 1867, pour y mentionner que le Québec forme une nation et que le français est sa langue officielle. Or, cette partie, soit la Partie V, ne concerne que les constitutions internes particulières à certains États provinciaux, dont le Québec et le l’Ontario. Le gouvernement du Québec plaide qu’il peut unilatéralement modifier cette partie V, puisque plusieurs des dispositions existantes et celles qu’il pourrait y ajouter ne regardent que la constitution propre au Québec, c’est-à-dire son ordre interne à lui. Le Québec a lui-même légiféré à l’égard de cette partie V en 1969, quand il s’est agi pour lui d’abolir son Conseil législatif, deuxième chambre devenue vétuste.
P ar cet expédient de l’amendement unilatéral, on évite de recourir à la procédure générale de modification, lourde et incertaine, qui mobilise le parlement fédéral et les législatures des États provinciaux. On contourne aussi la procédure dite « bilatérale » que le Québec a utilisée en 1999 pour abolir la confessionnalité de ses commissions scolaires et qui nécessite le concours du parlement fédéral. Cependant, les changements que le Québec voudrait apporter à la partie V n’auraient aucune portée canadienne, opposable ni au gouvernement fédéral, ni aux autres États provinciaux, ni aux Territoires. Ils ne prendraient donc pas place dans la constitution fédérale, celle dont la valeur prépondérante, de « loi suprême », domine tout l’échiquier politique canadien. En somme, après que le Québec eut tenté de se faire reconnaître comme « société distincte » dans la portion suprême et opposable à tout le Canada de la Loi de 1867 à l’occasion des accords du lac Meech et de Charlottetown (1987-1992), le Québec s’octroie à lui-même une reconnaissance de son caractère national, sans valeur effective à l’égard du pays en entier. C’est une autoreconnaissance dans un boudoir, une gratification sans écho, un petit cri d’affirmation nationale étouffé dans le silence froid et éternel des espaces infinis canadiens. Le journaliste Antoine Robitaille, à l’époque où il était éditorialiste au quotidien Le Devoir, avait évoqué en 2014 un « mini-Meech »[2], pour désigner des décisions de la Cour suprême qui accordaient au Québec des compensations partielles pour les garanties qu’il n’avait pas pu obtenir avec l’accord du lac Meech : l’assurance qu’on ne pourra nommer un juge de la Cour fédérale à l’un des trois postes réservés au Québec à la Cour suprême, et qu’on ne peut réformer le Sénat sans l’accord du Québec sur des points essentiels. Après le « mini-Meech » judiciaire, voici venir le « nano-Meech » d’une nation parlant français, mais pesant d’un poids infime dans la constitution canadienne. Cette minorisation extrême du Québec dans l’ordre constitutionnel va de pair avec celle qu’on observe sur le plan démographique et politique. Formant plus du tiers de la population du Canada en 1867, près de 29 % en 1961, les Québécois ne formaient plus que 22,6 % de cette population en 2019. Leur poids chuterait à près de 20 % en 2043, un seuil critique pour les minorités nationales enfermées dans un empire fédéral. Des pressions s’exercent d’ailleurs sur le gouvernement fédéral canadien pour qu’il hausse ses quotas annuels d’immigration, déjà parmi les plus élevés au monde, afin que la population du pays atteigne 100 millions en 2100, au lieu de 50 millions. Au reste, depuis les élections fédérales de mai 2011, qui ont porté au pouvoir les conservateurs de Stephen Harper, on sait que désormais un parti fédéral peut former un gouvernement majoritaire à Ottawa en se passant du Québec.
ar cet expédient de l’amendement unilatéral, on évite de recourir à la procédure générale de modification, lourde et incertaine, qui mobilise le parlement fédéral et les législatures des États provinciaux. On contourne aussi la procédure dite « bilatérale » que le Québec a utilisée en 1999 pour abolir la confessionnalité de ses commissions scolaires et qui nécessite le concours du parlement fédéral. Cependant, les changements que le Québec voudrait apporter à la partie V n’auraient aucune portée canadienne, opposable ni au gouvernement fédéral, ni aux autres États provinciaux, ni aux Territoires. Ils ne prendraient donc pas place dans la constitution fédérale, celle dont la valeur prépondérante, de « loi suprême », domine tout l’échiquier politique canadien. En somme, après que le Québec eut tenté de se faire reconnaître comme « société distincte » dans la portion suprême et opposable à tout le Canada de la Loi de 1867 à l’occasion des accords du lac Meech et de Charlottetown (1987-1992), le Québec s’octroie à lui-même une reconnaissance de son caractère national, sans valeur effective à l’égard du pays en entier. C’est une autoreconnaissance dans un boudoir, une gratification sans écho, un petit cri d’affirmation nationale étouffé dans le silence froid et éternel des espaces infinis canadiens. Le journaliste Antoine Robitaille, à l’époque où il était éditorialiste au quotidien Le Devoir, avait évoqué en 2014 un « mini-Meech »[2], pour désigner des décisions de la Cour suprême qui accordaient au Québec des compensations partielles pour les garanties qu’il n’avait pas pu obtenir avec l’accord du lac Meech : l’assurance qu’on ne pourra nommer un juge de la Cour fédérale à l’un des trois postes réservés au Québec à la Cour suprême, et qu’on ne peut réformer le Sénat sans l’accord du Québec sur des points essentiels. Après le « mini-Meech » judiciaire, voici venir le « nano-Meech » d’une nation parlant français, mais pesant d’un poids infime dans la constitution canadienne. Cette minorisation extrême du Québec dans l’ordre constitutionnel va de pair avec celle qu’on observe sur le plan démographique et politique. Formant plus du tiers de la population du Canada en 1867, près de 29 % en 1961, les Québécois ne formaient plus que 22,6 % de cette population en 2019. Leur poids chuterait à près de 20 % en 2043, un seuil critique pour les minorités nationales enfermées dans un empire fédéral. Des pressions s’exercent d’ailleurs sur le gouvernement fédéral canadien pour qu’il hausse ses quotas annuels d’immigration, déjà parmi les plus élevés au monde, afin que la population du pays atteigne 100 millions en 2100, au lieu de 50 millions. Au reste, depuis les élections fédérales de mai 2011, qui ont porté au pouvoir les conservateurs de Stephen Harper, on sait que désormais un parti fédéral peut former un gouvernement majoritaire à Ottawa en se passant du Québec.
Sans attendre, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il avaliserait la manœuvre québécoise d’autoreconnaissance, au vrai inoffensive. Il a flairé une bonne affaire, à ne pas laisser filer. De toute évidence, cette manœuvre ne changera rien, pas un iota, à l’ordre constitutionnel canadien, toujours aussi gelé depuis l’arrêt des grandes rondes de réforme constitutionnelle. Gel relatif toutefois, qui laisse aux tribunaux la liberté d’y ajouter ce qu’ils veulent, comme l’a fait dernièrement le juge Blanchard dans son jugement invalidant partiellement la Loi sur la laïcité de l’État, au nom entre autres du prétendu droit des commissions scolaires anglaises de choisir le régime de laïcité applicable à leurs écoles, comme si ces commissions formaient un gouvernement parallèle, soustrait à l’autorité de l’Assemblée nationale en matière de religion.
Si reconnaître le Québec comme nation dans la partie V de la Loi de 1867 est sans conséquence juridique véritable, elle comporte cependant des périls politiques qui méritent considération. Depuis le début des années 1960, le Canada anglais, confronté aux aspirations à l’autonomie du Québec, s’est posé la question : « What does Quebec want? ». Or, avec la proposition d’amender la constitution interne du Québec encore greffée à la Loi constitutionnelle de 1867, le Canada anglais risque de voir la chose comme une reddition. On comprendra, à Calgary, à Toronto et à Ottawa, qu’après des décennies de palabres constitutionnelles et de remous référendaires, le Québec ne réclame plus de changement substantiel à son statut politique, ni par le fédéralisme renouvelé ni par l’indépendance. Il règle au rabais, par la plus symbolique des mesures. D’où, sans doute, l’empressement avec lequel le gouvernement de Justin Trudeau, flanqué de ses stratèges et légistes, a donné sa bénédiction à cette trouvaille qui permet de faire oublier que le Québec n’a toujours pas adhéré à la réforme constitutionnelle qui lui a été imposée en 1982 et de repousser aux calendes grecques toute tentative de réparation, sur laquelle les gouvernements québécois, du reste, n’insistent plus.
Depuis le début des années 1960 également, il est question dans le débat public que le Québec adopte sa propre constitution écrite, même en tant qu’État fédéré, comme cela est la norme dans la plupart des fédérations. Au lieu de donner corps à ce projet latent, le gouvernement Legault laisse en état la constitution actuelle du Québec, qui compose un ramassis illisible de lois et de conventions dispersé dans une foule de textes, fouillis qu’il gratine d’un petit supplément.
Par ailleurs, en procédant à ce changement, le Québec introduit deux articles bilingues dans un texte demeuré officiellement anglais. Peu de gens savent que la Loi constitutionnelle de 1867 existe sans version officielle française : celle que l’on trouve dans les sites législatifs et qu’on l’on cite dans les décisions judiciaires n’est qu’une codification administrative du ministère fédéral de la Justice. L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que le ministre fédéral doit préparer sans délai une version française des textes constitutionnels canadiens édictés en anglais seulement. Un projet de traduction a été déposé auprès du parlement fédéral en 1990, mais est resté sans suite. Il n’a suscité ni discussion publique ni réelle réaction du gouvernement du Québec. Or, ce projet comporte des choix de traduction contestables[3], et le Québec pourrait faire valoir sa propre traduction, plus conforme à l’esprit de l’union canadienne de 1867 et au génie de la langue française. Si le Québec procède aux changements annoncés de la partie V de la loi 1867 sans pourvoir à sa traduction en totalité en français, on pourra même interpréter son geste comme une renonciation à la version française attendue de cette loi fondamentale. Pourtant, l’article 55 ne lui enlève guère la faculté de proposer, par une résolution de modification de la constitution, une version française de tout ou partie des textes constitutionnels demeurés unilingues anglais, plus d’une vingtaine en tout. Au surplus, ajouter deux petits articles bilingues à une loi dont presque toutes les dispositions, y compris les annexes, se présentent encore en version anglaise seulement, produirait un méli-mélo cocasse, un texte biscornu qui accréditerait l’idée que le bilinguisme ne vaut que pour le Québec dans son modeste ordre interne, la première loi fondamentale du pays s’énonçant en anglais uniquement.
Si le gouvernement est sérieux dans son entreprise de modifier la loi de 1867, il devra alors songer à accompagner son projet d’amendement d’une version française officielle de cette loi tout entière, préparée par ses meilleurs légistes, et la faire ratifier par un vote de l’Assemblée nationale, sous la forme d’une résolution de modification constitutionnelle. Ce serait une belle façon de contrer la version française préparée par Ottawa, devenue dormante, conformément à l’article 55 LC 1982. Celui-ci soumet l’adoption de la version française de la Loi de 1867 à la procédure de modification constitutionnelle, ce qui n’enlève donc pas au Québec l’initiative en la matière. De plus, le gouvernement pourrait faire adopter par l’Assemblée nationale une résolution affirmant que son adhésion officielle à la loi 1982 n’est toujours pas acquise. S’il était malin, il pourrait même inscrire cette non-reconnaissance dans la partie V de la loi de 1867. Qui sait, dans les petits détails se cachent parfois des étincelles de grandeur.
Marc Chevrier
[1] Projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, Assemblée nationale du Québec, 42e législature, 1ère session, mai 2021.
[2] Antoine Robitaille, « Mini-Meech », Le Devoir, 26 avril 2014, https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/406608/renvoisurles .
[3] Voir mon article, De la liberté du Québec à l’indépendance… de Terre-Neuve, Encyclopédie de l’Agora, 18 novembre 2013.