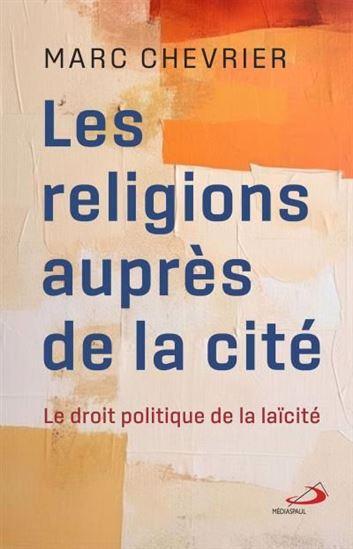Couper un ruban de soie de l’Empire
À propos du serment d’allégeance au roi d’Angleterre par les membres de l’Assemblée nationale du Québec
L’ancien Lord Chancellor britannique, Richard Haldane, qui donna une conférence à Montréal en 1913 et que les juristes connaissent par sa contribution à la jurisprudence du Conseil privé relative au Canada, disait que l’Empire britannique tenait grâce à des rubans de soie faisant peu de frictions. L’un des rubans qui ont enfermé des peuples divers dans ce vaste ensemble est le recours au serment d’allégeance. Depuis que l’humanité se gouverne par des princes ou des élus, elle a cherché, dans l’Occident christianisé du moins, à se garantir la fidélité des gouvernants et des gouvernés par le serment à une puissance ou une entité supérieure. Dans les îles britanniques, l’empire du roi s’est construit en exigeant de ses vassaux qu’ils lui prêtent allégeance ; avec la réforme protestante, le serment d’allégeance s’est doublé de tests religieux, qui ont longtemps exclu les catholiques et d’autres minorités de la jouissance des droits civiques.
Cependant, le Royaume-Uni a quand même maintenu le serment d’allégeance, toujours exigé de ses députés, et même des parlementaires écossais et gallois dans leurs assemblées nationales respectives. Ce serment sert de test de docilité, par lequel le pouvoir central certifie la bonne disposition à son égard des élites issues des nations conquises ou annexées à travers l’histoire. De plus, dans un pays où les élites ont toujours écarté l’idée de se conformer à une véritable constitution démocratique conçue sur le modèle américain ou français, le serment s’est avéré un moyen utile de donner une consistance à l’autorité publique, qui jaillirait des serments individuels à la personne du souverain qui sont renouvelés périodiquement, notamment aux élections.

Depuis ce mouvement de fronde, qui évoque celle des députés nord-irlandais du Sinn-Fein à Westminster, on s’interroge sur la nature du serment d’allégeance exigé par l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867. Certains opinent qu’on peut y passer outre, par un arrangement dont l’Assemblée nationale est la seule juge, d’autres persistent à y voir une obligation impérative, à laquelle nul aspirant député ne peut se soustraire, sous peine qu’on lui refuse ses privilèges parlementaires.
Dans ce débat, un point mérite d’être soulevé. Depuis 1867, on a accoutumé au Québec d’administrer le serment d’allégeance au souverain en français, alors que le texte ne connaît qu’une version anglaise officielle. De deux choses l’une. Ou bien, si l’on prend le parti que ce serment est impératif en vertu du droit constitutionnel, toutes ces prestations de serment en français sont invalides, par entorse à la lettre anglaise du serment. Ou bien on estime que cette traduction française imposée par la pratique forme une adaptation légitime et juridiquement recevable du serment en anglais. Si l’on choisit la deuxième option, qui semble la plus raisonnable, comment expliquer alors ce pouvoir d’adaptation que les officiers et les députés de l’Assemblée nationale se sont donné ?
Jusqu’ici, les avis exprimés sur le serment d’allégeance se cantonnent dans une perspective très légaliste. À leurs dires, ce serment ne peut être modifié que par un amendement constitutionnel ou une loi ordinaire. Mais ils oublient un point fondamental : le caractère coutumier du droit parlementaire, et même du droit politique qui, au Canada comme au Royaume-Uni, demeure largement gouverné par des conventions non écrites. Ils ignorent aussi l’Acte de Québec de 1774, par lequel le législateur impérial reconnut que la population canadienne possédait des coutumes assez fortes pour neutraliser les ordonnances des gouverneurs coloniaux et pour constituer un système de lois propres à fonder ses droits civils. En bref, une lecture trop formaliste des chemins à suivre pour modifier ou abolir le serment d’allégeance risque de nous faire perdre de vue que le « parlement de Québec » possède un pouvoir originaire de transformation des normes qui le regardent dans sa mission représentative, par voie de coutumes et de conventions parlementaires évolutives.
Enfin, le serment royal d’allégeance aura beau être aboli, son esprit pourra subsister encore. Dans la tradition britannique, il forme un substitut à l’adoption d’une constitution écrite ratifiée par le peuple. De plus, si l’on ne conserve que le serment prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale, qu’on en corrige le libellé, qui commence par un anglicisme : « je, X Y », alors que le français préfère « moi, X Y ».
Marc Chevrier
Professeur de science politique
au sein de l’Université du Québec
Auteur de L’Empire en marche (PUL, Hermann, 2019)