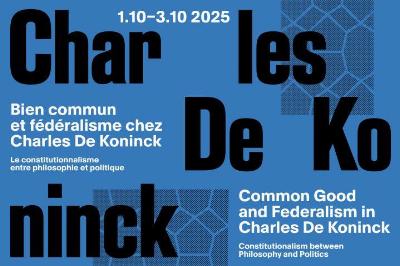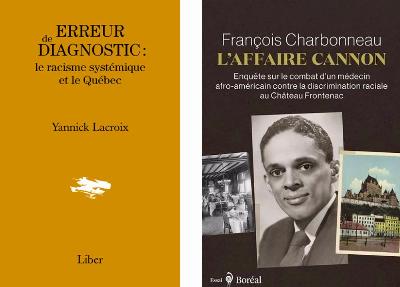Les communautés électives
Un penseur politique anglais, Harold J. Laski, écrivait au début de ce siècle que l'homme est un animal bâtisseur de communautés. Il formulait autrement la célèbre idée d'Aristote, qui définit l'homme comme animal politique. Si l'on en juge par le nombre de communautés nouvelles qui se multiplient aujourd'hui et par les circonstances où le mot "communauté" est employé, cette capacité créatrice semble bien se porter.
Mais qu'entendons-nous justement par "communauté"? Ce mot enregistre, du moins dans la langue française, plus d'une centaine de définitions, qui recoupent en fait des réalités fort différentes. Dans le sens premier du terme, la communauté désigne habituellement un regroupement de personnes qui habitent un même lieu et partagent une langue, une religion et des valeurs communes. On pense spontanément à la paroisse, à un village ou à une bourgade. Dans de telles communautés, les gens se connaissent, ont des rapports fréquent et étroits, qui définissent leur statut et leur identité. Elles se composent d'hommes et de femmes, d'enfants et de vieillards, de riches et de pauvres, d'honnêtes gens et de mécréants qui tous ensemble forment un petit monde.
À un homme comme moi, citadin d'une grande ville, ce genre de communauté inspire tout à la fois la nostalgie et la méfiance. Il évoque d'un côté des rapports fraternels et chaleureux, tissés de liens de solidarité et de bon voisinage, qui sont des plus rassurants. De l'autre, la communauté étroite peut devenir oppressive et étouffante, quand justement la proximité des relations ne permet guère la divergence d'opinions et de moeurs. Alors la communauté peut devenir une prison. L'écrivain français François Mauriac disait de Paris et de la province (c'est ainsi qu'on appelle le reste de la France) que la première était une solitude habitée et la deuxième, un désert surpeuplé. C'est une manière de dire que l'anonymat des grandes villes crée pour le citadin un espace protecteur de libertés, alors que la vie dans la campagne et les villes de provinces, qui offrent moins de loisirs et d'occasions de rencontres nouvelles, se plie à un certain conformisme.
Aujourd'hui, comme plus de la majorité de la population, au Québec, au Canada et presque partout ailleurs, réside dans des zones urbaines, seule une minorité de gens vivent dans les communautés étroites des campagnes et des régions éloignées. La ville, moyenne ou grande, se présente plutôt comme une société, c'est-à-dire un groupement de personnes dont les rapports, hors la famille et les cercles d'amis, suivent plutôt des règles formelles, comme celles du contrat et de la loi. La ville attire souvent des immigrants sortis de leur communauté d'origine, tantôt à regret, quand le chômage pousse les jeunes à partir, tantôt avec impatience, quand la ville semble promettre une vie plus excitante et meilleure. Vivre en société, cela implique côtoyer quotidiennement beaucoup d'inconnus, croisés dans le métro, dans les magasins, sur la rue. Cependant, la société urbaine est aussi un tissu de communautés diverses, qui coexistent avec plus ou moins de bonheur. On y trouve les communautés d'intérêts, associations en tous genres, clubs de sport et de loisirs, groupes bénévoles, comités de citoyens, partis politiques, ensembles musicaux, sociétés savantes et littéraires qui unissent des personnes de toutes origines autour d'une cause ou d'une passion commune. Bien sûr, ces communautés s'étendent au-delà de la ville et peuvent fédérer, sur un grand territoire, des individus de tous les milieux. Pendant longtemps, la religion divisait la population en des communautés qui ne se mélangeaient guère. On peut observer les vestiges de cette division à Montréal, où se dressent à l'Est de la ville des clochers catholiques et à l'Ouest, des chapelles protestantes, auxquels s'ajoutent aujourd'hui des églises orthodoxes et des temples bouddhistes.
Les grandes villes nord-américaines comme Montréal, Toronto et San Francisco comptent également d'autres types de communautés, qui investissent un quartier, voire plusieurs, de la cité. Ce sont les "communautés culturelles", immigrants de première et de seconde génération qui se regroupent pour recréer, autour d'une école, d'un lieu de culte, de commerces communs, la culture de leur pays natal. Les communautés ne se fixent pas toujours sur un intérêt, comme les communautés d'identité, dans lesquelles se reconnaissent des personnes qui partagent une caractéristique sociale, sexuelle ou raciale. Les Noirs américains se désignent souvent comme formant une communauté. Certaines féministes prétendent que les femmes constituent une communauté à part des hommes. Des militants homosexuels clament l'existence d'une culture et d'une communauté gaies, qui auraient vocation à s'affranchir de la majorité hétérosexuelle. On voit maintenant apparaître d'autres communautés encore, abusivement appelées virtuelles, qui se forment spontanément à la faveur des possibilités inépuisables d'échanges que le médium Internet et d'autres technologies semblent permettre. Ces technologies ayant apparemment aboli les frontières du temps et de l'espace, des individus de villes, de pays et de continents différents peuvent entrer en communication simultanément, poursuivre des activités communes et nouer des liens, et ce, même s'ils ne se rencontrent jamais.
Bref, nous vivons dans un monde de communautés croisées, qui se côtoient, se superposent et s'ignorent aussi. Pour certains, la communauté évoque un univers familier, stable, tissée de relations nouées patiemment, situé dans un lieu, des bâtiments, des rites chargés d'histoire. Pour d'autres, elle signifie l'appartenance à un corps social qui n'a pas de territoire physique propre, où entrent des personnes de tous horizons qui se rallient autour d'un intérêt ou d'une identité sociale particuliers. Dans d'autres circonstances, la communauté n'est point un corps social auquel on adhère toute sa vie; c'est une association, où l'on entre et d'où l'on sort à loisir. Les communautés nous choisissent autant que nous les choisissons. Croisées, elles sont aussi électives.
Ce qui rassemble toutefois ces communautés, est le fait qu'elles évoluent dans un cadre civique commun, la communauté nationale, sur le sens de laquelle se disputent d'ailleurs Québécois et Canadiens. Tout le débat qui a fait rage aux États-Unis sur le multiculturalisme, qui se transporte maintenant au Québec et au Canada, a été l'occasion de s'interroger sur les rivalités et les conflits que la multiplication des communautés ethniques ou sociales peut engendrer. C'est au fond la communauté nationale, qui est une grande fédération de communautés unies par une histoire, des institutions et une culture communes, qui a le plus à perdre avec la multiplication des communautés électives. Les critiques du multiculturalisme font valoir que les appartenances particulières qu'il préconise risquent de faire s'évanouir le sens même de la citoyenneté. Quelle appartenance compte le plus? Appartenir à une communauté politique qui, au-delà des différences de sexe, de race et du culture assure aux citoyens leurs droits civils et politiques et attend d'eux en retour qu'ils remplissent leurs responsabilités sociales? Ou jurer fidélité à ces nouvelles tribus qui parlent moins à l'universel qu'au particulier en nous?