Le Capital de Piketty ou quand l’impôt servait la démocratie
Dans le numéro du 4 octobre 2014 du cahier livres de la Stampa (Tutto Libri), l’économiste Thomas Piketty a donné une entrevue pour souligner la traduction en italien de son maître ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, qui connaît un succès mondial phénoménal. Le titre de cette brique de près de mille pages, sans compter de nombreuses annexes disponibles en ligne, fait bien sûr écho au Capital de Karl Marx. Dans son entrevue, Piketty avoue l'avoir lu non sans éprouver quelque ennui, le trouvant abstrait et limité dans son exploitation des données disponibles du vivant de Marx. Il estime que son Capital à lui est plus facile et « brillant ». On croit sans peine que Piketty ait de la fierté pour son oeuvre. Comme l’écrivait jadis le Duc de Lévis : « De tous les sentiments, le plus difficile à feindre c’est la fierté. […]; dans la prospérité, elle rend affable et contraste avec l’insolence de la bassesse parvenue. » L’essai de l’économiste, jeune quadragénaire devenu directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, est une oeuvre magistrale, agréable à lire, qui réussit à refaire de l'économie une science historique capable de dialoguer avec la littérature – Piketty aime à citer Balzac et Jane Austen – et les autres sciences sociales. Le simple fait d’avoir réussi à rendre simple, accessible aux non économistes, une matière réputée ardue et complexe est en soi un exploit qui honore l’auteur.
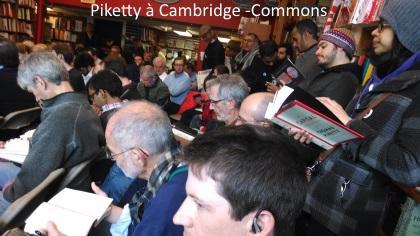 Cela dit, Piketty l’a écrit dans son livre et le redit en entrevue, son analyse emprunte bien peu au marxisme. Du capitalisme, il ne conteste ni les bases ni sa vocation à régir la production économique des sociétés. En ce sens, il n’est guère un radical mais plutôt un social-libéral qui cherche à corriger la propension du capitalisme à engendrer des inégalités en faveur des détenteurs de capitaux, notamment les rentiers, au détriment des producteurs de l'économie. La doctrine de Piketty, qu’on pourrait nommer le redistributisme fiscal, assigne à l’État la mission de réduire les écarts de revenus et l’accumulation du capital par la voie de l’arme fiscale, à la faveur d’une panoplie d’impôts et de prélèvements. Mais il laisse intacts les fondements juridiques et anthropologiques du capitalisme, à la différence de doctrines comme le marxisme ou le distributisme de Chesterton, par exemple, qui préconise la diffusion la plus étendue possible de la petite propriété1 pour libérer l’Homme de la machine et du capital concentré. L’analyse de Piketty a toutefois le mérite de rappeler que le principal instrument de la redistribution, l’impôt, est une question fondamentale en démocratie. Il écrit : « L’impôt n’est pas une question technique. Il s’agit d’une question éminemment politique et philosophique, sans doute la première d’entre toutes. Sans impôts, il ne peut exister de destin commun et de capacité collective à agir2. »
Cela dit, Piketty l’a écrit dans son livre et le redit en entrevue, son analyse emprunte bien peu au marxisme. Du capitalisme, il ne conteste ni les bases ni sa vocation à régir la production économique des sociétés. En ce sens, il n’est guère un radical mais plutôt un social-libéral qui cherche à corriger la propension du capitalisme à engendrer des inégalités en faveur des détenteurs de capitaux, notamment les rentiers, au détriment des producteurs de l'économie. La doctrine de Piketty, qu’on pourrait nommer le redistributisme fiscal, assigne à l’État la mission de réduire les écarts de revenus et l’accumulation du capital par la voie de l’arme fiscale, à la faveur d’une panoplie d’impôts et de prélèvements. Mais il laisse intacts les fondements juridiques et anthropologiques du capitalisme, à la différence de doctrines comme le marxisme ou le distributisme de Chesterton, par exemple, qui préconise la diffusion la plus étendue possible de la petite propriété1 pour libérer l’Homme de la machine et du capital concentré. L’analyse de Piketty a toutefois le mérite de rappeler que le principal instrument de la redistribution, l’impôt, est une question fondamentale en démocratie. Il écrit : « L’impôt n’est pas une question technique. Il s’agit d’une question éminemment politique et philosophique, sans doute la première d’entre toutes. Sans impôts, il ne peut exister de destin commun et de capacité collective à agir2. »
Piketty donne à la compréhension de l’économie une profondeur historique bienvenue. Les taux de croissance atteints par l'Occident sont un phénomène inédit dans l'histoire de l’humanité, qui date de la révolution industrielle. Les taux connus pendant les Trente Glorieuses, de 4 à 5% par année, sont une exception explicable par le boom démographique et la reconstruction des économies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, alors que les taux moyens réalistes que l’on peut espérer pour l’avenir n’excéderont guère 1,5% par année, dans un contexte de dépérissement du capital naturel. Piketty insiste sur une autre limite, à savoir que l'accumulation indéfinie du capital dans quelques mains n'est pas une fin en soi dans une économie libérale. Celle-ci peut tendre ou bien à l’accumulation du capital, qui peut approcher des niveaux record, comme à l’aube de la Première Guerre mondiale, – l’équivalent de sept fois le revenu annuel de pays tels que la France et la Grande-Bretagne–, ou bien à la réduction de cette proportion en faveur de la production et du travail. La reproduction du capital obéit à certaines lois qui mettent en jeu une multitude de facteurs sur lesquels l'État peut néanmoins agir en taxant le revenu, la consommation, les biens fonciers et l’héritage. Piketty ne croit pas du tout aux vertus autorégulatrices du marché qui pourrait, par la libre concurrence et l’innovation seules, éliminer de lui-même les inégalités de richesse les plus extrêmes. Il écrit : « L’idée selon laquelle la libre concurrence permet de mettre fin à la société de l’héritage et de conduire à un monde toujours plus méritocratique est une dangereuse illusion3. » Piketty souligne que c'est aux États-Unis, après la Première Guerre mondiale, que l'imposition frappa de taux confiscatoires les tranches supérieures du revenu et des héritages, taux allant de 70 à 94%. Ainsi, note l’économiste, entre 1932 et 1980, le taux moyen supérieur de l’impôt fédéral sur le revenu a été d’environ 81% chez les Américains4. Piketty explique cet engouement des Américains pour l’impôt progressif confiscatoire par le souci d’une répartition plus démocratique de la richesse et « [l]a peur de ressembler à la vieille Europe », qui avait fourni au Nouveau Monde l’image d’une économie patrimoniale inégalitaire, où on accède à l’aisance grâce à l’héritage et les bons mariages plutôt que par le travail. Il fallait un Français pour raconter aux Américains leur propre histoire économique, qu'ils avaient vite fait d'oublier, reconvertis depuis les années 1970 aux sirènes du néo-libéralisme.
En lisant le livre de Piketty, on voit mieux les ravages de la mentalité post-historique de l’homme obnubilé par le présent qui a aboli en lui « tout souvenir d’un passé plus riche » ou inspirant, déjà décrite par Lewis Mumford dès 19565 : quand une société démocratique n'a plus de mémoire, quand son horizon temporel ne dépasse pas celui d'une génération, elle oublie ce qu'elle a elle-même fait, et se voit condamnée à croire n'importe quoi sur elle-même. Voilà les États-Unis, voilà le Québec, voilà peut-être la France. Dans un autre livre brillantissime, celui-là du philosophe Rémi Brague, cette conscience temporelle étriquée de nos sociétés démocratiques immodérément modernes reçoit un nom, le « parontocentrisme », une mémoire qui tourne autour du présent6. Peinant à se projeter dans un avenir à long terme et à remonter dans un passé qui aille au-delà d’une génération, les sociétés démocratiques, estime Brague, font face à un véritable problème chronologique7. Mais paradoxalement, selon une formule superbe de Piketty, quand le capital accumulé s’accroît plus vite que la production née du travail selon sa formule R > G, « [l]e passé dévore l’avenir8», le capital étant en quelque sorte du travail passé reconverti en unités monétaires indéfiniment reproductibles et transmissibles. Au fond, nous vivons à l’ère du passéisme patrimonial.
Autre vérité martelée par Piketty : les États aujourd'hui semblent pauvres et endettés, mais en fait, ces dettes enrichissent les détenteurs de capitaux, qui eux sont très prospères. Nos sociétés sont en train d'atteindre des niveaux d'accumulation du capital proches des sommets qui ont existé à la fin de la Belle Époque. Les dettes publiques cachent en fait une surabondance de capitaux qui s’accroissent grâce à des rendements d’autant plus élevés sur les placements que l’inflation est faible. Et plus on est très riche, plus le rendement est élevé. Au XIXe siècle, les grands rentiers faisaient du 5% par année, aujourd'hui, les Gates ou les Bettencourt (Liliane Bettencourt est l’héritière de l’empire cosmétique L’Oréal – ont pu tirer 13% par année sur leurs milliards entre 1990 et 2010, soit de 10 à 11% hors inflation9. Aux fins de comparaison, le patrimoine moyen mondial s’accroissait de 2,1% par adulte entre 1987-201310. Les hauts rendements sont indifférents à la nature des fortunes accumulées, par héritage ou par l’édification d’un empire informatique. Piketty croit posséder une solution pour contrer l’emballement des inégalités de source patrimoniale : instaurer un impôt mondial sur le capital, calculé au moyen d’un système de déclarations obligatoires et exhaustives des actifs financiers et réels détenus par les contribuables. L’économiste reconnaît qu’il s’agit là d’une utopie, néanmoins utile, qui nous oblige à réfléchir sur les moyens d’accroître la transparence financière des institutions bancaires et économiques. « Au lieu de consulter les magazines de type Forbes ou les rapports sur papier glacé publiés par les gestionnaires de fortunes, […] les citoyens pourraient avoir accès à une information publique établie à partir de méthodes et d’obligations déclaratives précisément définies11. » Pour l’instant, l’opacité règne sur la connaissance des fortunes et des patrimoines. La production d’informations fiables en cette matière est l’un des grands enjeux démocratiques de notre temps.
Marc Chevrier
1 Sur les idées économiques de G.K. Chesterton, voir Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, Éditions de l’Homme nouveau, Paris, 2009.
2 Le Capital au XXe siècle, Seuil, Paris, 2013, p. 794.
3 Ibid., p. 675.
4 Ibid., p. 818.
5 Voir Lewis Mumford, Les transformations de l’homme, Payot, Paris, 1974, p. 168
6 Voir Rémi Brague, Modérément moderne, Flammarion, Paris, 2014, p. 15.
7 Ibid, p. 270.
8 Le Capital au XXIe siècle, p. 942.
9 Ibid., p. 702.
10 Ibid., p. 693.
11 Ibid, p. 841.








