Entre Paris et la « Province ». Les impasses de la quasi-légitimité, de Louis-Philippe d’Orléans à Emmanuel Macron
Les « provinciaux » en gilets jaunes se sont rappelés bruyamment au pouvoir français insensible à leurs réalités. La « province », c’est ainsi encore qu’on désigne en France le reste d’un pays sur lequel une ville-Soleil orgueilleuse de sa puissance et de son prestige exerce son autorité. Le centralisme jacobin, comme l’ont vu les écrivains Benjamin Constant et François Mauriac, s’est nourri d’une dynamique sociale qui engendre depuis une grande capitale anonyme des individus déliés et homogènes pour imposer son empire sur une « province » enracinée, diverse et réfractaire. Par ailleurs, on a fait des parallèles nombreux entre Emmanuel Macron et Louis-Philippe 1er, ce roi bourgeois chassé du pouvoir en 1848. Or, s’appuyant sur les écrits de l’historien italien Guglielmo Ferrero, l’auteur soutient qu’il existe, par-delà les similitudes entre les deux hommes, d’étranges parentés de structure entre le régime de la monarchie de Juillet et celui de la Ve république, qui tentent chacun de faire vivre ensemble deux principes de légitimité très différents, mais sans parvenir à répondre entièrement ni à l’un, ni à l’autre. Et l’intégration européenne, loin de mitiger les impasses de la quasi-légitimité, les exacerbe. À moins de redonner sens à sa souveraineté nationale, la France devra adopter un régime ou bien purement présidentiel ou bien strictement parlementaire.
 Les saisissantes « jacqueries » venues de la France « périphérique » au cours de novembre et décembre 2018 ont mis en scène le gouffre qui s’était creusé entre les élites françaises confortablement installées aux commandes de leur État et une bonne partie de la population française qui survit tant bien que mal hors des métropoles embourgeoisées et des banlieues immédiates qui les desservent. Ces vagues de protestation qui ont vu des milliers de Français endosser le fameux gilet jaune fluorescent que tout automobiliste français range dans la boîte à gants de sa voiture ou sous le siège du conducteur ont aussi illustré combien tendues sont les relations entre une capitale qui domine toujours aujourd’hui l’ensemble du pays et un « reste », un hinterland, un arrière-pays qu’on appelle encore communément la « province » dans les cercles médiatique et politique. C’est d’ailleurs sous le vocable de « provinciaux » qu’on a dans plusieurs tribunes désigné ces Français en colère aux ronds-points et aux Champs-Élysées. À la fin de l’été 2018, inconscient encore des doléances qui animeraient quelques mois plus tard la révolte de ces « provinciaux », le président Emmanuel Macron avait imprudemment taxé, devant la reine du Danemark, Margrethe II, les Français de « Gaulois réfractaires au changement[1] ».
Les saisissantes « jacqueries » venues de la France « périphérique » au cours de novembre et décembre 2018 ont mis en scène le gouffre qui s’était creusé entre les élites françaises confortablement installées aux commandes de leur État et une bonne partie de la population française qui survit tant bien que mal hors des métropoles embourgeoisées et des banlieues immédiates qui les desservent. Ces vagues de protestation qui ont vu des milliers de Français endosser le fameux gilet jaune fluorescent que tout automobiliste français range dans la boîte à gants de sa voiture ou sous le siège du conducteur ont aussi illustré combien tendues sont les relations entre une capitale qui domine toujours aujourd’hui l’ensemble du pays et un « reste », un hinterland, un arrière-pays qu’on appelle encore communément la « province » dans les cercles médiatique et politique. C’est d’ailleurs sous le vocable de « provinciaux » qu’on a dans plusieurs tribunes désigné ces Français en colère aux ronds-points et aux Champs-Élysées. À la fin de l’été 2018, inconscient encore des doléances qui animeraient quelques mois plus tard la révolte de ces « provinciaux », le président Emmanuel Macron avait imprudemment taxé, devant la reine du Danemark, Margrethe II, les Français de « Gaulois réfractaires au changement[1] ».
Qu’un président de la République compare ses citoyens et électeurs à des Gaulois indociles est un fait de langage curieux, mais combien révélateur ! Les Gaulois formaient un peuple conquis qui subit la longue domination des Romains, au point d’en absorber la civilisation et la langue. Le terme même de « province » vient d’ailleurs du droit de conquête romain. Étymologiquement, le mot province dérive de l’ancien verbe, provincere, lui-même décomposable en « pro » et « vincere », signifiant « vaincre »[2]. Le mot provincia en latin finit par signifier « un commandement à exercer sur un théâtre déterminé de la guerre[3] ». Autrement dit, la « provincia » consistait en un pouvoir de commandement absolu dont était investi un magistrat nommé par Rome pour gouverner les sujets et les biens soumis par l’armée romaine[4]. Connaître le sort de « province » sous le joug romain n’était donc pas ni un cadeau ni une consécration ; les peuples subjugués par la puissance romaine étaient ainsi « réduits en province » ; in proviciam redigo, disait-on selon la formule consacrée. Comme le rappelle le grand historien allemand du droit romain, Théodore Mommsen, « le droit public romain désigne du nom de réduction en provinces » les « conquêtes de territoires étrangers indépendants » et les « confiscations d’États dépendants » qui ont grossi l’Empire romain[5]. Butin de guerre, la province était partagée, fixée, tirée par le sort. Être réduit en province, c’était une punition, une fatalité, un désespoir, un pis-aller, et non une dignité à laquelle on accédait. Tout compte fait, un président de la République qui traite ses concitoyens de « Gaulois réfractaires » les toise donc de haut, à la manière d’un proconsul ou d’un général romain arrivé sur le champ de bataille des vaincus.
La France de l’ancien régime se divisait en provinces gouvernées par des représentants du roi, les intendants. Bien que la Révolution française ait aboli ces antiques divisions pour les remplacer par des départements, qui forment encore aujourd’hui le premier palier d’administration qui s’interpose entre l’État et les communes, la notion de « province » a continué de façonner les mentalités françaises. Alors que la Belgique, l’Espagne et l’Italie modernes ont découpé leur territoire en provinces, c’est pourtant en France où les élites persistent à considérer le territoire national comme une vaste « province » à discipliner, depuis une capitale parisienne où siège le pouvoir et d’où se répandent ses lumières. Dans un texte publié dans le site Médiapart où l’auteur évoque « Paris provincialisée par les gilets jaunes ? », Bertrand Rouzies résume bien le statut de la « province » française auprès de l’intelligentsia du pays :
La province, étymologiquement la « terre des vaincus », est cet arrière-pays qui commence au-delà des fortifs, un terroir forcément sous-développé, ravagé par la consanguinité, médiocre et morne, qui regarde passer l’Histoire au large de son pré carré. Elle a été moquée par quasiment tous les illustres de notre littérature classique, y compris et surtout par ceux qui en étaient issus et étaient montés à la capitale pour y faire oublier leur accent et s’y tailler, à force de « coups », une gloire immortelle. La province a été racisée au point que l’Auvergnat était raillé par Balzac pour son « charabia » (de l’arabe al-‛arabiya) et que certains beaux esprits se plaisaient à parler de « Charabie Pétrée » à propos du Cantal et de « Charabie heureuse » à propos du Puy-de-Dôme[6].

François Mauriac
Dans un recueil de pensées et d’apophtegmes publié en 1926, l’académicien François Mauriac, lui-même un provincial, a résumé par quelques brillantes formules tout ce que la « province » et son type humain, le « provincial », peuvent inspirer à un écrivain émancipé de son Bordelais natal[7]. On peut y lire notamment :
Paris est une solitude peuplée ; une ville de province est un désert sans solitude. […]
Les provinciaux qui reçoivent ne se fournissent presque jamais d’invités hors de leur milieu, de leur monde. L’intelligence, ni l’esprit, ni le talent n’entrent en ligne de compte, mais seulement la position. […]
La conversation est un plaisir que la Province ignore. On se réunit pour manger ou pour jouer, non pour causer. […] On a tout dit sur la congestion cérébrale dont souffre la France. Quelle tristesse que les formes désintéressées du labeur humain (je pense à l’art, mais non à la science) ne se puissent développer hors de Paris ! […]
Paris écrème la Province : c’est vrai pour le talent, non pour la vertu.
Et enfin, un autre mot de Mauriac, particulièrement fin :
Paris détruit les types que la Province accuse.
La Province cultive les différences : nul n’y songe à rougir de son accent, de ses manies.
Paris nous impose un uniforme ; il nous met, comme ses maisons, à l’alignement ; il estompe les caractères, nous réduit tous à un type commun.
Ces vues sur la puissance niveleuse de la capitale parisienne font penser aux enseignements perspicaces que l’écrivain romantique Benjamin Constant a tirés des funestes conquêtes napoléoniennes. Dans son essai L’Esprit de conquête, il y dénonce le nouvel esprit des guerres qu’avaient entreprises les révolutionnaires français et Napoléon, qui répandaient uniformité et despotisme sur toutes les contrées foulées par la soldatesque française, au contraire d’anciennes conquêtes du temps jadis qui préservaient les mœurs et les particularités des peuples conquis. Il écrit :
Les conquérants de nos jours, peuples ou princes, veulent que leur empire ne présente qu’une surface unie, sur laquelle l’œil superbe du pouvoir se promène, sans rencontrer aucune inégalité qui le blesse ou borne sa vue. Le même code, les mêmes mesures, les mêmes règlements et, si l’on peut y parvenir, graduellement la même langue, voilà ce qu’on proclame la perfection de toute organisation sociale[8].
Cependant, en lisant attentivement le texte, on s’aperçoit que Constant ne proteste pas seulement contre les campagnes extérieures des armées françaises en Europe ; il suggère à demi-mot que la Révolution a enclenché un processus comparable à une conquête intérieure, qui a vu Paris, la capitale où se fondent et s’excitent les ambitions et les passions révolutionnaires, astreindre à la morne uniformité dont elle occupe le centre, tous les pays, toutes les petites patries dissemblables et diverses dont la province était issue. Ainsi, selon Constant :
L’attachement aux coutumes locales tient à tous les sentiments désintéressés, nobles et pieux. Quelle politique déplorable que celle qui en fait de la rébellion ! Qu’arrive-t-il ? que dans tous les États où l’on détruit ainsi toute vie partielle, un petit État se forme au centre : dans la capitale s’agglomèrent tous les intérêts ; là vont s’agiter toutes les ambitions ; le reste est immobile. Les individus, perdus dans un isolement contre nature, étrangers au lieu de leur naissance, sans contact avec le passé, ne vivant que dans un présent rapide, et jetés comme des atomes sur une plaine immense et nivelée, se détachent d’une patrie qu’ils n’aperçoivent nulle part, et dont l’ensemble leur devient indifférent, parce que leur affection ne peut se reposer sur aucune de ses parties. La variété, c’est de l’organisation, l’uniformité, c’est du mécanisme. La variété, c’est la vie ; l’uniformité, c’est la mort. La conquête a donc de nos jours un désavantage additionnel, et qu’elle n’avait pas dans l’antiquité. Elle poursuit les vaincus dans l’intérieur de leur existence ; elle les mutile, pour les réduire à une proportion uniforme[9].
Constant dit ici exactement l’inverse de la doxa dominante d’aujourd’hui, qui associe la diversité aux grandes villes, et l’uniformité à l’arrière-pays. C’est que selon lui, la perte de diversité observée dans la « province » et dont se désolent ou que raillent les beaux esprits résulte de l’action anesthésiante, mécanique et raboteuse d’une capitale où priment l’individualisme, l’anonymat et le déracinement propices à l’émergence de citadins hors sol et sans attaches, indifférents à la cause des petites patries à leurs yeux retardataires et même nuisibles. Dans ce tableau général dépeint par Constant on voit clairement apparaître Paris qui, après avoir tenté vainement d’étendre son empire jusqu’à Moscou et jusqu’à Rome sous Napoléon, s’est rabattue sur la maîtrise implacable de la province française, éternellement réfractaire, capricieuse et fautrice de révoltes ; c’est un cheval mal harnaché qu’on n’a de cesse de vouloir dresser. Le pouvoir qui s’était centralisé sous les rois français aux Tuileries ou à Versailles continuerait de l’être pendant la Révolution et par la suite, comme l’a superbement noté Alexis de Tocqueville[10], si bien que Paris, où ont alterné républiques, monarchies et dictatures césaristes de 1789 à 1958, est devenue le lieu unique et décisif de toutes les prises de pouvoir, par la force des armes ou par les urnes. Les Français ont remplacé le Roi-Soleil par la Ville-Soleil, qui règne en impératrice jalouse de son prestige, de son ascendant moral et intellectuel et de ses prérogatives régaliennes, sur une province subjuguée par une administration minutieuse et pesante, sur ce bas-pays qu’on appelle aujourd’hui par pudeur ou par paternalisme « les régions » ou les « territoires ». Rien n’est plus triste et saisissant que de voir un Parisien jeter, avec condescendance ou une morgue à peine retenue, son dédain ou son indifférence outrée sur un « provincial » sorti inopportunément de sa banlieue mal famée, de sa ville glauque et désindustrialisée ou de son village fantôme. Dans telle remontrance, telle algarade ou tel rappel à l’ordre intimé d’un ton comminatoire, s’exprime parfois plus de méchanceté entre un membre de l’élite parisienne et un provincial qu’entre un Français et un Anglais ou un Allemand. Comment, au sein d’un même peuple, peut-on s’entre-détester à ce point ? Dans une capitale qui arbrite des fortunes, des réputations, des élégances, du goût et des carrières, les bonnes places et les gloires n’abondent pas ; il faut dès lors y apprendre à repousser, à éliminer, à recaler, à trier, à recaser, voire à humilier les multiples prétendants qui se pressent aux portes. D’où une certaine âpreté dans les rapports entre la haute société à Paris et la « province », qu’on oublie certes pendant les jours de réjouissance et de retrouvailles nationales sous la fanfare de la pompe républicaine, mais qui refait surface sitôt que le champagne est bu. On ne s’étonnera donc pas que pour beaucoup de gilets jaunes montés à Paris, et certains pour la première fois de leur vie, afin de porter des doléances devenues inaudibles, l’expérience s’est avérée une délivrance, un choc ou une source de vertige. Du reste, un intellectuel très médiatique, Michel Onfray, a publié à l’hiver 2018 un ouvrage au titre suggestif, Décoloniser les provinces, dans lequel il préconise le « communalisme libertaire » et l’autogestion contre le centralisme jacobin[11].
On pourra rétorquer que l’emprise de Paris s’est beaucoup desserrée sur la « Province » depuis la décentralisation de l’État engagée dans les années 1980, qui a ajouté des régions au millefeuille administratif français, dont chacune possède son assemblée élue, son président et sa bureaucratie. La France longtemps invisible qui a défilé au cours des dernières semaines dans les rues de Paris et en régions révèle en fait une coupure, comme l’a montré le géographe Christophe Guilluy[12], entre d’une part une France métropolitaine riche de ses métropoles régionales et de sa capitale où se concentrent les classes instruites qui profitent de la mondialisation libérale, et une France périphérique où vivent le gros des classes moyennes et précarisées dans les zones rurales et semi-urbaines dévitalisées. Plusieurs villes françaises de taille moyenne ont tiré parti de la décentralisation et de l’intégration européenne pour se dynamiser, connectées à Paris à la faveur de lignes de train à grande vitesse et d’autoroutes confiées à des consortiums privés. Or, le processus même de cette décentralisation est demeuré, pour l’essentiel, conforme au tropisme jacobin du pouvoir français. Il suffit de constater qu’un président de la République — François Hollande en l’occurrence — a pu de son propre chef décider de réduire de 22 à 13 le nombre des régions en France métropolitaine, par le seul désir semble-t-il de rationaliser le territoire français en unités comparables aux Länder allemands[13].
Le régime semi-présidentiel français, ou les aléas de la quasi-légitimité
Tout conduit à Paris, les autoroutes, les voies ferroviaires, les manifestations, les ambitions et le pouvoir. Et, à Paris, tout remonte à une seule personne, le président de la République. Or, par-delà les doléances, les souffrances et les mécontentements portés par les gilets jaunes et que le gouvernement Macron aurait mésestimés, les événements de novembre et de décembre 2018 trouvent également leurs explications dans certains défauts structurels du régime politique français, assez unique au monde, qui s’est exporté dans certains pays de l’Europe centrale et de l’Est, ainsi qu’en Afrique. Si Emmanuel Macron s’est présomptueusement pris pour un président jupitérien, plusieurs analystes politiques l’ont aussi assimilé à un nouveau Louis-Philippe 1er, en référence au duc issu de la famille d’Orléans à qui les auteurs de la révolution de juillet 1830 confièrent le trône français en voulant écarter la dynastie des Bourbons qui avait réintégré ses droits à la restauration de 1814 et régné jusqu’à la chute du téméraire Charles X[14]. La similitude entre Macron et Louis-Philippe d’Orléans s’est imposée par la comparaison de leurs politiques ; ce sont deux « souverains » qui ont réconcilié les bourgeoisies de gauche et de droite, tous commis à la poursuite d’une politique libérale de centre au sein d’un pays engagé dans sa reconversion économique. On a même cru apercevoir entre les deux dirigeants des parentés de personnalité. « Un certain narcissisme les apparente, qui les fait chacun se rêver en un improbable Bonaparte pacifique », soutient Jean-François Colosimo[15]. Cependant, il y a plus que des politiques et des rêveries à rapprocher ; une étonnante parenté de structure se révèle aussi entre le régime de la monarchie de Juillet et celui de la Ve République française.
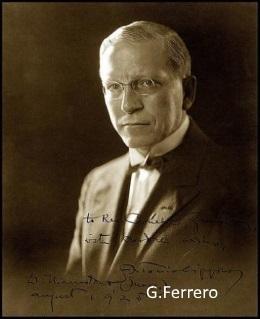 Pour saisir cette parenté, un détour s’impose par l’un des plus brillants analystes des régimes politiques depuis la Révolution française, à savoir Guglielmo Ferrero, un grand historien italien de l’histoire romaine, et, au surplus, un antifasciste résolu soucieux de comprendre les fondements de la légitimité politique. Il a publié à New York durant la Deuxième Guerre mondiale le dernier ouvrage de son vivant, en français, sous le titre Pouvoir. Les génies invisibles de la cité[16]. On y apprend que les régimes politiques en Europe vivent sous l’emprise de puissants principes de légitimité, qui sont les « maîtres » ou « génies invisibles » des destinées collectives ; un régime est fort et stable pourvu que le principe de légitimité qui le fonde soit en accord avec la pratique du pouvoir et la réalité sociale ; il suffit que cet accord s’effrite, ou qu’un nouveau principe de légitimité le dispute à celui qui est en place pour que la paix sociale cède à la révolte et aux révolutions. Les principes de légitimité existent en nombre limité selon Ferrero ; il distingue les principes électif, démocratique, aristo-monarchique et héréditaire. Ceux-ci, qui « sont des justifications du Pouvoir, c’est-à-dire du pouvoir de commander » et donc de l’obéissance, se sont entremêlés et combattus dans l’Histoire. Aucun de ces principes n’a de valeur absolue. Ainsi, « [c]e qui les caractérise, selon Ferrero, c’est d’être dépourvus de toute transcendance, d’être justes et rationnels, jusqu’à un certain point, c’est-à-dire, sous certaines conditions, et de devenir absurdes si ces conditions manquent, et de ne pouvoir jamais s’imposer immédiatement et irrésistiblement à l’esprit humain[17]. » Ferrero a en quelque sorte une vision aristotélicienne de l’excellence en politique ; il conçoit qu’il puisse exister plusieurs formes d’excellence politique. Dans certaines circonstances, la monarchie peut s’avérer excellente, de même que la démocratie et le principe électif, qui ont tendance à fusionner sous la forme de la démocratie représentative. Cependant, chacune des excellences en politique, incarnée dans un régime particulier, existe à titre précaire. Chaque régime qui cultive sa légitimité propre doit donc s’appuyer sur un substrat humain possédant des vertus effectives ; en démocratie, sur un peuple clairvoyant et instruit, éclairée par l’action des partis et de la presse ; en royauté héréditaire, sur une famille dynastique intelligemment formée à l’exercice du pouvoir ; en aristocratie, sur une élite de « magistrats, de guerriers, de législateurs, de diplomates, d’administrateurs » dévoués et désintéressés. Ainsi, « si tous les principes de légitimité sont, à l’origine, partiellement rationnels, tous peuvent devenir absurdes » et dès lors s’exposer aux attaques de la raison et précipiter l’action révolutionnaire.
Pour saisir cette parenté, un détour s’impose par l’un des plus brillants analystes des régimes politiques depuis la Révolution française, à savoir Guglielmo Ferrero, un grand historien italien de l’histoire romaine, et, au surplus, un antifasciste résolu soucieux de comprendre les fondements de la légitimité politique. Il a publié à New York durant la Deuxième Guerre mondiale le dernier ouvrage de son vivant, en français, sous le titre Pouvoir. Les génies invisibles de la cité[16]. On y apprend que les régimes politiques en Europe vivent sous l’emprise de puissants principes de légitimité, qui sont les « maîtres » ou « génies invisibles » des destinées collectives ; un régime est fort et stable pourvu que le principe de légitimité qui le fonde soit en accord avec la pratique du pouvoir et la réalité sociale ; il suffit que cet accord s’effrite, ou qu’un nouveau principe de légitimité le dispute à celui qui est en place pour que la paix sociale cède à la révolte et aux révolutions. Les principes de légitimité existent en nombre limité selon Ferrero ; il distingue les principes électif, démocratique, aristo-monarchique et héréditaire. Ceux-ci, qui « sont des justifications du Pouvoir, c’est-à-dire du pouvoir de commander » et donc de l’obéissance, se sont entremêlés et combattus dans l’Histoire. Aucun de ces principes n’a de valeur absolue. Ainsi, « [c]e qui les caractérise, selon Ferrero, c’est d’être dépourvus de toute transcendance, d’être justes et rationnels, jusqu’à un certain point, c’est-à-dire, sous certaines conditions, et de devenir absurdes si ces conditions manquent, et de ne pouvoir jamais s’imposer immédiatement et irrésistiblement à l’esprit humain[17]. » Ferrero a en quelque sorte une vision aristotélicienne de l’excellence en politique ; il conçoit qu’il puisse exister plusieurs formes d’excellence politique. Dans certaines circonstances, la monarchie peut s’avérer excellente, de même que la démocratie et le principe électif, qui ont tendance à fusionner sous la forme de la démocratie représentative. Cependant, chacune des excellences en politique, incarnée dans un régime particulier, existe à titre précaire. Chaque régime qui cultive sa légitimité propre doit donc s’appuyer sur un substrat humain possédant des vertus effectives ; en démocratie, sur un peuple clairvoyant et instruit, éclairée par l’action des partis et de la presse ; en royauté héréditaire, sur une famille dynastique intelligemment formée à l’exercice du pouvoir ; en aristocratie, sur une élite de « magistrats, de guerriers, de législateurs, de diplomates, d’administrateurs » dévoués et désintéressés. Ainsi, « si tous les principes de légitimité sont, à l’origine, partiellement rationnels, tous peuvent devenir absurdes » et dès lors s’exposer aux attaques de la raison et précipiter l’action révolutionnaire.
Il est toutefois arrivé dans l’histoire qu’un régime tente de satisfaire simultanément à deux principes de légitimité incompatibles, par exemple la monarchie héréditaire et la démocratie. Or, estime Ferrero, ces régimes sont voués souvent à la faillite, car en tentant de réconcilier des principes de légitimité si divers, ils ne parviennent à remplir aux exigences ni de l’un, ni de l’autre. Ferrero classe dans les régimes quasi légitimes ceux qui, comme la monarchie de Juillet de Louis-Philippe 1er, font collaborer « deux Génies invisibles de la Cité » qui sont en lutte en vue de triompher de l’autre. De ces régimes bancals, Ferrero dit ceci :
Parmi tous les gouvernements, les quasi légitimes sont les plus difficiles à comprendre. Comme ils se justifient par deux principes de légitimité opposés, ils vivent d’une contradiction inavouable, et cherchant à la cacher, pour ne pas trop irriter la raison et le sens moral de leurs sujets, ils ne jouissent des avantages de la quasi-légitimité que dans la mesure où ils réussissent à se camoufler[18].
Au regard du principe dynastique, l’accession au trône de Louis-Philippe d’Orléans constitua une usurpation maquillée par des manœuvres peu honorables. La révolution parisienne de juillet 1830 laissa vacant le trône, jusque-là occupé par un Bourbon. Comme le raconte Ferrero, on doit à l’action d’un banquier, M. Jacques Lafitte, le comblement irrégulier du trône. Réunis chez l’argentier en privé, en dehors des enceintes parlementaires normales, une trentaine de députés, tremblant à l’idée que les insurgés ne proclamassent la république, se laissèrent convaincre par Adolphe Thiers et Jacques Lafitte de remettre la lieutenance générale du royaume au duc d’Orléans, l’aîné de la branche cadette, plutôt que d’appeler au trône le successeur direct de Charles X[19]. Le duc d’Orléans, retiré dans son château, tarda à répondre à l’offre ; il l’aurait acceptée par la bouche de sa sœur, sous la pression d’une simple commission municipale de députés, précise un biographe de Louis-Philippe, Arnaud Tessier[20]. Décidé à sauver la monarchie qu’il ne pouvait plus incarner aux yeux des révolutionnaires, Charles X couvrit la manœuvre en nommant le duc d’Orléans à la lieutenance générale avant d’abdiquer en sa faveur, explique Ferrero. Peu de jours après, les députés et les pairs se réunirent illégalement pour ratifier officiellement cette substitution au trône qu’ils avaient ourdie en cachette, sans respecter les lois de succession à la couronne.

Louis-Philippe 1er. Peint par Franz Xaver Winterhalter (1805–1873)
Faisant entorse à la monarchie dynastique, le régime de Louis-Philippe 1er ne réussit pas mieux à honorer le principe démocratique. Les élections et les assemblées législatives sous la monarchie orléaniste « n’étaient que des farces, écrit Ferrero ; leurs opérations, réglées d’avance pour le pouvoir qu’elles devaient légitimer, n’étaient vivifiées par aucune spontanéité ni sincérité[21]. » Cependant, le droit d’opposition, aux assemblées et dans la société, s’y exerçait réellement, assez pour donner au régime une apparence de liberté. La monarchie quasi légitime de Louis-Philippe put dès lors compter sur des consentements assez étendus, du moins dans ses premières années, pour ne pas « s’imposer uniquement par la force, la corruption et la mystification[22]. » Mais le roi Louis-Philippe se trouva ainsi dans une position intenable : ne pouvant revendiquer pour lui-même ni l’autorité d’un vrai roi légitimement établi, ni la gloire militaire d’un Napoléon, ni l’appui démocratique de la nation, il subsistait, ainsi que le souligna le prince Metternich, comme « roi de facto[23] ». Condamné à négocier incessamment son maintien au pouvoir avec les autres forces d’un régime où s’agrandissait le fossé entre les promesses de la démocratie et la réalité d’un corps électoral réservé à une petite élite fortunée, il fut chassé du trône en 1848 comme son prédécesseur.
Ce que Ferrero dit des imperfections d’un régime quasi légitime peut se transposer au régime de la Ve République française. Sur papier, sa constitution établit certes une république démocratique. En réalité, toutefois, le régime dessiné sur mesure pour le général de Gaulle en 1958 compose une constitution mixte, qui combine un principe aristo-monarchique et un principe démocratique. Or, le principe monarchique à la base de la Ve république n’est pas de nature dynastique ; il repose sur l’idée de l’homme exceptionnel ou providentiel, sacré par les épreuves de l’Histoire, dont les aptitudes le désignent spontanément au gouvernail de l’État. Par son caractère et ses vertus, cet homme — peut-être un jour une femme — gagne la confiance de la nation tout entière, qui s’en remet à lui pour la guider vers son bien, sa grandeur et sa fin. Ainsi que le souligne le publiciste Jean-Marie Denquin, l’ambition du général de Gaulle était « l’instauration d’une magistrature suprême confiée à un homme exceptionnel, capable de voir loin, haut, profond, pour le salut du pays[24]. » Le sacre d’un tel magistrat suprême se fait au suffrage universel, qui porte sur le pavois électoral celui qui a reçu l’onction populaire. Pour l’assister dans sa tâche colossale, le président peut se fier à l’expertise et au dévouement d’une élite méritocratique formée dans les grandes écoles de la République, et qui forme autour de lui des corps de diplomates, d’administrateurs, de jurisconsultes, de directeurs de cabinet et d’inspecteurs généraux qui répercutent dans toutes les strates de l’État et de la société française les orientations du président, décidées sans devoir ne rien céder aux petites combines des partis.
Le problème avec un tel principe de légitimité, c’est sa rareté et sa contingence. Tout l’édifice de la Ve République repose sur une clé de voûte fragile : la reconnaissance d’un individu d’exception, qui agit à la fois comme un guide et un législateur, mais dont l’existence est livrée au caprice du hasard et des circonstances. Les qualités d’un homme royal tel que se l’imaginaient Platon ou Aristote sont intransmissibles, et il y a risque que la monarchie élective voulue par de Gaulle fasse succéder au monarque fondateur des roitelets qui n’aient pas l’étoffe de la fonction et qui remplacent l’autorité et le discernement qui leur font défaut par la gesticulation et la simulation. Ainsi, la monarchie élective se transforme vite en monarchie aléatoire, selon les mots heureux de Denquin, qui peut connaître des intermittences et des éclipses, quand le président n’est pas à la hauteur de sa fonction, cesse de jouir de l’appui de la population et doit céder, comme en période de cohabitation, l’essentiel de ses prérogatives au premier ministre qui lui a ravi le soutien majoritaire des députés à la suite d’élections législatives qui sanctionnent la politique du président. Maurice Duverger a bien qualifié la présidence française sous la Ve République de monarchie républicaine[25]. Cependant, cette qualification, que Duverger applique indifféremment au président des États-Unis et aux premiers ministres britanniques et suédois, n’arrive pas à cerner l’exceptionnalité du dirigeant-guide appelé à la fonction présidentielle en France.
Dans toute l’histoire de la Ve république, le général de Gaulle a probablement été le seul président à pouvoir incarner sérieusement cette royauté rare. Tous les autres présidents qui lui ont succédé, de Pompidou à Macron, qui ont pu déployer à des degrés divers des aptitudes à gouverner, ont tous eu un certain mal à remplir de toute leur personne la fonction de président-monarque, tels des apprentis chevaliers se glissant dans une armure démesurément trop grande pour leur frêle corps. Hommes ambitieux, aguerris et rusés certes, mais profondément ordinaires, ils ont prétendu, à chaque élection présidentielle qui solennisait leur intronisation par le peuple, se hisser aux hauteurs d’un destin qui leur a vite échappé, sitôt mise en marche la machine du pouvoir dont il recevait les lourdes manettes. Ils se sont contentés, au mieux, de singer la fonction monarcho-présidentielle. L’hyperprésident — Nicolas Sarkozy — ou le président normal — François Hollande — ont offert au peuple français, par le théâtre plutôt que par la substance, un ersatz de monarque républicain. Parmi ceux qui ont suivi de Gaulle, François Mitterrand a sans doute le mieux approché la dimension monarchique inhérente à la fonction présidentielle. Il a cependant mis son génie florentin dans sa propre survie politique ; il s’est grandi, en pharaon, au lieu de grandir la France.
Un élément fondamental qui rend supportable la monarchie élective gaullienne est le sens de l’honneur qui sous-tend l’action du président. De Gaulle a survécu à la censure du gouvernement Pompidou en 1962 et à la fronde de mai 1968, mais il a eu l’élégance de démissionner en 1969 quand il a vu que le peuple ne le suivait plus dans la réforme des institutions. Tous les autres présidents à la suite de Gaulle se sont accrochés au pouvoir après une rebuffade aux élections législatives ou à un référendum, à commencer par Mitterrand. Sarkozy poussa la crânerie jusqu’à faire réadopter l’essentiel du projet de constitution européenne rejeté par le peuple français en mai 2005 par un Congrès de parlementaires à ses ordres. À part Mitterrand, qui obtint sa réélection après une cohabitation dont il tira habilement parti, et Jacques Chirac, qui dut sa réélection à un duel favorable en 2002 contre Jean-Marie Le Pen, les présidents encore vivants après leur premier mandat n’ont pas réussi à se faire réélire : Valéry Giscard d’Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui eut l’intelligence de ne pas se représenter, mais ouvrit la voie à son jeune ministre de l’Économie, Emmanuel Macron. Depuis Chirac, on assiste à peu près à la même dynamique politique après le sacre du vainqueur aux présidentielles. Élu sur la foi de promesses magnifiques, l’élu aux pouvoirs de démiurge déçoit, par ses dédits, ses hésitations et les bénéfices virtuels d’une action qui tardent à se concrétiser, les divers segments du peuple auxquels il a promis monts et merveilles. Il plonge ainsi, en quelques mois, du zénith de la consécration populaire aux bas-fonds de la défaveur publique.
On ne s’étonnera donc pas que plusieurs gilets jaunes aient comparé le président Macron à Louis XIV ou à Louis XVI, ou même sa femme Brigitte à Marie-Antoinette. Dans cette comparaison, on décèle certes la critique démocratique des excès monarchiques de la fonction présidentielle ; mais c’est aussi une manière de dire que le peuple en France attend encore de son président qu’il le protège, comme un bon roi. « Gouvernez votre peuple comme un berger fait son troupeau, ou comme un père de famille fait ses enfants ; pourvoyez lui de magistrats craignant Dieu, non violents, timides, ennemis d’avarice », écrivait le chancelier Michel de l’Hospital au XVIe siècle aux rois de France, dans un traité qu’il ne fut pas publié de son vivant mais sortit des presses pendant la Restauration. Un roi pasteur doit ainsi, selon de l’Hospital, suivre cette maxime :
[G]ardez le [le peuple] de toute oppression et violence ; faites distribuer à chacun ce qui lui appartient, soit pour le loyer (prix, récompense), soit pour la peine, sans aucune acception, vous aurez en ce faisant un peuple obéissant, voire si affectionné, qu’il ne vous faudra point d’autre garde que l’amour de vos sujets […]
Et quand le peuple français se sent lâché par son président-roi indifférent au loyer et à la peine supportées par ses plus humbles citoyens, il sort de ses champs et va dans la rue ; s’il se sent trahi par lui, il dresse des barricades à Paris, siège altier de sa rancœur[26].
Le chancelier ajoute :
Que si le berger, au lieu de pourvoir aux nécessités de son troupeau, le tondre doucement et en saison convenable, le servir et accommoder de sa laine qui lui est superflue et qui ne lui est qu’à charge, il l’écorche et lui ôte la peau, ce n’est plus un berger, c’est un tigre, c’est un loup ravissant.
Par ailleurs, le principe de la monarchie élective, qui peine à reproduire une excellence humaine dans les présidents qui se succèdent au gré des élections et des humeurs de l’électorat, voit inévitablement se dégrader l’aristocratie méritocratique sur laquelle elle s’adosse. Le précepte que Michel de l’Hospital recommandait aux conseillers d’État de son temps : « [f]aut aussi que le conseiller d’État soit sans faveur pour les uns, sans haine envers les autres, et sans ambition pour soi, n’ayant autre but que le bien public[27] », perd insensiblement de sa force. Les corps de techniciens qui animent l’État finissent par saisir le président pour ce qu’il est : un homme quelconque dévoré par l’ambition, mais à peine différent des leurs, dont il provient souvent, habituellement un diplômé de l’École nationale d’administration, devenue depuis sa création en 1945 une pépinière à présidents et à premiers ministres. La présidence perdant de sa hauteur et de sa puissance, absorbé dans les opérations de communication et dans la gestion quotidienne des intérêts, les techniciens censés servir la grandeur française apprennent à se servir d’abord. La présomption et l’orgueil qui accompagnent leur rang leur donnent des manières qui rappellent l’aristocratie de l’ancien régime ; d’aucuns même, après avoir sacrifié quelques années à l’État, passent sans vergogne du public au privé pour y poursuivre de très lucratives carrières, en seigneurs du capital. Une étude publiée en 2011 montre que sur les 35 dirigeants des grandes entreprises cotées à la bourse de Paris (l’indice CAC 40), 10 sont des énarques, et 13 proviennent des grandes écoles d’ingénieurs comme la Polytechnique et l’École centrale, toutes deux de Paris[28].
De la même manière que le principe aristo-monarchique est voué à se réaliser imparfaitement au cours de la Ve république, le principe démocratique, sous sa forme parlementaire, n’est pas parvenu non plus à s’actualiser pleinement. La monarchie élective gaullienne n’a pas instauré un véritable régime présidentiel ; il s’appuie sur un parlement dont est censé émaner un gouvernement assujetti au principe de la responsabilité devant la chambre des députés. Aussi trouve-t-on aux côtés du président un premier ministre à la tête du gouvernement, à qui il incombe, selon la constitution, de déterminer et de conduire « la politique de la nation ». Mais le premier ministre a beau nommer les ministres de son cabinet avec le président et répondre de sa gestion à l’Assemblée nationale, il n’a ni l’autorité ni les pouvoirs réels d’un véritable premier ministre en régime parlementaire. Quand le président dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale pour l’appuyer, le premier ministre est relégué au rôle d’exécutant des volontés présidentielles, qui s’impriment sur les nominations les plus importantes, le programme législatif et les orientations stratégiques du pays. Partageant avec le président le pouvoir exécutif dans une relation dont il est le second, le premier ministre est cependant le seul à s’exposer au parlement. C’est sur lui que tombe le poids souvent écrasant des politiques présidentielles, ainsi que l’avalanche des critiques sans nombre que lui inflige l’opposition.
Or, placé au-dessus de la mêlée, le président est irresponsable politiquement. Il n’entre pas au Parlement — sauf quand il convoque les deux chambres à Versailles pour leur administrer un grand discours —, et le Parlement ne peut l’atteindre, ni par la censure ni par une convocation à une commission d’enquête. Ce qui confère aux débats parlementaires en France quelque chose d’irréel, de lancinant et parfois de comique. Le principal intéressé des politiques dont on discute ferme aux deux chambres du Parlement ne se montre jamais à la barre, et c’est son paravent, sa doublure, son simulacre, en la personne du premier ministre qui répond de lui, que l’on doit atteindre. Les débats parlementaires ressemblent ainsi à une forme de procès par contumace — on juge un absent inatteignable — ou à une comédie de boulevard où l’on voit fulminer un mari soupçonneux contre l’amant caché qui l’a cocufié et qui rigole de ses exploits dans une garde-robe remplie des fourrures de Madame.
La responsabilité politique du gouvernement français est ainsi toujours imparfaitement mise à l’épreuve ; le vrai responsable de l’exécutif échappe à l’heure de vérité du face-à-face parlementaire, et l’opposition qui frappe un ministre ou le premier ministre de ses remontrances cherche toujours éperdument une autre cible. Les seuls moments où le premier ministre en France s’est comporté en véritable chef de gouvernement pleinement responsable ont correspondu aux périodes de cohabitation, quand le président a perdu sa majorité à l’Assemblée nationale et se voit contraint de nommer un premier ministre issu d’une autre famille politique que la sienne. Cependant, les élites françaises ont tout fait pour empêcher que les cohabitations ne se reproduisent, comme si elles formaient d’encombrantes anomalies. Pour ce faire, on a raccourci le mandat présidentiel de sept à cinq ans et inversé le calendrier électoral, de telle sorte que les élections législatives suivent de peu les élections présidentielles et en répercutent ainsi les résultats.
Selon Ferrero, la démocratie ne peut s’approfondir que par l’exercice réel et libre les droits de l’opposition. Or, sous la Ve république, le parlement a perdu de sa superbe, au profit de l’exécutif auquel la constitution a remis de nombreux outils pour museler et abréger le débat parlementaire et l’examen des lois. La réforme constitutionnelle conclue en 2008 à l’instigation du président Sarkozy a certes relevé quelque peu les droits de l’opposition au parlement, mais en normalisant la prééminence du président dans l’équilibre des institutions. Cette réforme a échoué également dans sa tentative de transformer le référendum, dont la tenue appartient à la décision du président, en véhicule de contre-démocratie populaire. Depuis en 2008, un cinquième des parlementaires français peuvent déclencher la tenue d’un référendum si leur initiative est appuyée d’un dixième des électeurs inscrits, soit plus de quatre millions et demi de personnes… En fait, la colère et les mécontentements où mènent l’impuissance et la surdité du président aux doléances populaires ne trouvent aucun exutoire institutionnel immédiat où se canaliser. En Italie, une pétition de 500 000 électeurs suffit pour mettre en branle un référendum en vue d’abroger une loi qui indispose une partie de la population. Ce qui explique que depuis l’entrée en vigueur de la constitution de la République italienne en 1947, le pays de Dante a tenu 67 référendums abrogatifs sur initiative du peuple ou des régions. Très pratiquée en Suisse, l’initiative populaire existe aussi en Lettonie, en Lituanie et en Pologne[29]. Or, les neuf référendums tenus en France depuis le début de la Ve république ont résulté tous du fiat présidentiel. En France, le référendum apparaît comme une grâce que le président-roi concède à son peuple. Du reste, l’idée de réformer le droit de l’initiative référendaire en France a refait surface parmi les gilets jaunes ; on voudrait accorder à une pétition de 700 000 signatures l’initiative du référendum[30].
Le principe électif sort également affaibli de la concurrence incessante entre l’élection d’un président et celle d’une assemblée nationale. Les partis politiques n’existent que pour la conquête du pouvoir présidentiel ; ils se font et se défont, changent de nom et d’enveloppe, multiplient les alliances électorales tactiques au prix d’étonnants revirements et de bris de fidélité. Les effets éliminatoires du mode de scrutin majoritaire à deux tours achèvent de réduire à l’insignifiance électorale ou à la marginalité les partis trop peu disciplinés pour faire accéder leur candidat vedette au deuxième tour des élections présidentielles. Les partis en France recrutent proportionnellement moins d’adhérents que les partis équivalents en Allemagne et au Royaume-Uni, et connaissent moins de longévité. Déçus par les partis, beaucoup des Français ne votent plus ou par intermittence ; d’autres donnent leurs suffrages à des partis protestataires, qu’on qualifie commodément de populistes de droite ou de gauche, dont la radicalité inquiète ou envoûte, selon qu’ils promettent le redressement national ou la démocratie immédiate, sans intermédiaires, comme ont commencé de le croire plusieurs gilets jaunes.
Les impasses de la quasi-légitimité dans l’Empire européen
En somme, la constitution de la Ve République tente une synthèse audacieuse, encore que fragile et ardue à réaliser, entre deux principes de légitimité : une monarchie de l’homme rare, mais souvent introuvable, secondée par des corps méritocratiques dévoués ; une démocratie parlementaire réglée sur les exigences de la responsabilité politique et du débat contradictoire en chambre. On ne peut toutefois saisir toutes les embûches auxquelles s’expose le régime semi-présidentiel français sans avoir à l’esprit les répercussions de l’intégration européenne sur la gouverne politique en France. Depuis que la France s’est engagée dans la construction européenne en 1957, on observe une disproportion grandissante entre les capacités des gouvernants et les attentes des Français à leur égard. Au fil des traités qu’elle a ratifiés pour s’intégrer dans une union économique et politique sans fin avec ses partenaires européens, la France a cédé aux instances supranationales sises à Bruxelles et à Strasbourg des pans entiers de sa souveraineté. Dans des domaines névralgiques, comme la monnaie, la concurrence, la conservation des ressources halieutiques, le commerce extérieur, Bruxelles s’est substitué à Paris ; dans plusieurs autres matières, la politique agricole, les pêcheries, l’environnement, les transports, l’énergie, la protection du consommateur, les institutions européennes administrent des politiques communes ou imposent des directives que les États membres doivent transposer dans leur législation. Ceux-ci doivent même suivre scrupuleusement les règles budgétaires européennes, qui réduisent leur capacité d’accumuler des déficits. À certains égards, la France a moins de marge de manœuvre pour gouverner qu’un état fédéré, et doit se borner à appliquer sur son territoire les normes européennes, quitte à les moduler quelque peu. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces normes n’émanent pas d’un directoire entièrement étranger à la France. Dans bien des cas, elles procèdent de l’intense activité diplomatique de la France avec ses partenaires, autour de la Commission européenne et du parlement de Strasbourg et au sein des instances intergouvernementales de l’Union européenne, qui ont généralement le dernier mot sur les normes européens.
Cependant, ce transfert progressif des compétences étatiques vers l’Union n’a pas entraîné un déplacement concomitant du forum démocratique et de la responsabilité politique. Les Français ont continué de considérer les dirigeants, président, premiers ministres, ministres, députés et sénateurs, comme les premiers responsables de tout ce qui leur arrive. Le fait qu’ils élisent depuis 1979 des députés européens à la proportionnelle n’a pas changé grand-chose à cela ; la députation française à Strasbourg, élue avec une participation électorale anémique, paraît un débouché supplémentaire dans une assemblée sans réel pouvoir, pour des partis mal servis par le système électoral français. La conséquence de cette disparité est que les gouvernants français sont condamnés à décevoir leurs électeurs, qui se persuadent toujours de leur grande capacité à gouverner, comme s’ils exerçaient une souveraineté encore inentamée. Pour faire face simultanément au chômage, à l’inflation, au déficit, au terrorisme et au défi climatique, les dirigeants ne peuvent plus compter sur la dévaluation de la monnaie ou l’emballement de la dépense publique. La déréglementation et l’ouverture des marchés qu’on associe souvent vaguement à la mondialisation et aux traités de libre-échange découlent surtout des traités régissant l’Union européenne et de l’affolant corpus de normes techniques qui en découlent. En ce sens, l’action d’un président français est essentiellement contrainte ; il promet beaucoup, il nourrit de grandes espérances auprès d’un peuple pour se faire élire, mais assis sur un socle toujours plus réduit de moyens pour gouverner. Alors que l’action du président bute à des contraintes externes croissantes, les attentes des électeurs, sans cesse alimentées par les angoisses du déclassement dans un marché intérieur européen qui pousse à la baisse les salaires et à la fermeture les usines trop peu performantes, se maintiennent, voire redoublent d’ampleur et d’intensité. Ce qui contribue à affaiblir d’autant la monarchie élective française. De même, la démocratie parlementaire française n’en sort pas non plus renforcée. En plus de se fatiguer à poursuivre un président qui se terre hors les murs du palais Bourbon, l’Assemblée nationale s'acharne sur un gouvernement ligoté en bien des domaines, dont la principale mission consiste à exécuter les volontés européennes et à les expliquer à des parlementaires et à des électeurs qui s’y rallient et les comprennent à demi.
Le destin de la quasi-légitimité présidentielle en France
Il est difficile de s’avancer sur l'avenir du régime de la Ve République, qui accumule les signes d’épuisement et d’impuissance; les manifestations et les rondes des gilets jaunes, 18 mois après l’élection d’un président jupitérien, en attestent sans doute les symptômes éloquents. La France ne constitue pas le seul pays en Europe qui combine un président élu au suffrage universel et un régime parlementaire. Seulement, dans certains de ces pays, le Portugal, l’Autriche, la Finlande et l’Irlande, la fonction présidentielle a fini par céder à la primauté du premier ministre, par la suite d’arrangements entre les partis ou d’une réforme constitutionnelle[31]. Pour sortir des impasses de la quasi-légitimité qu’aggrave l’insertion de la France dans l’Empire européen, les Français voudront peut-être se donner une VIe république. Qui sait quelle forme elle prendra ? Si c’est le destin de la France de devenir un gros canton voué à l’exécution des décisions d’un Euroland souverain, le maintien d’une monarchie aléatoire aussi compliquée s’avérera un luxe inopportun. Pour sortir des impasses de la quasi-légitimité, les Français devront alors opter ou bien pour un vrai régime présidentiel – et ainsi abolir le premier ministre pour concentrer le pouvoir exécutif dans les mains du président – ou bien ériger un vrai régime parlementaire sans bicéphalisme de l’exécutif, sous l’autorité d’un premier ministre qui répond entièrement de la politique du gouvernement. Le président, même élu au suffrage universel, se retirerait alors dans l’exercice d’une magistrature morale et distante, laissant au premier ministre du jour les grands arbitrages du pouvoir. Pour parvenir à cette fin, il n’est pas absolument nécessaire de procéder à de vastes réformes constitutionnelles. Dès lors que les partis politiques en France cesseront de vénérer la fonction présidentielle pour destiner plutôt leurs chefs respectifs à la conquête prioritaire de l’Assemblée nationale, cette fonction pourrait vite être neutralisée. Un petit changement constitutionnel hâterait aussi les choses : prévoir que le président de la République ne préside plus les réunions du Conseil des ministres, ou que, comme au Portugal, il préside le Conseil à la demande du premier ministre.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes qu’un président de la République française propose, avec toute la majesté et la prestance encore rattachées à sa fonction, l’édification d’une véritable « souveraineté européenne[32] », ainsi que s’en est enhardi le président Macron devant le Parlement européen en avril 2018. La réalisation d’une telle ambition, si la France entend la mener jusqu’au bout, implique en réalité la substitution à sa monarchie aléatoire d’un régime politique simplifié, allégé, qui a liquidé les angoisses existentielles qui viennent avec le maintien d’une souveraineté d’État au profit d’un peuple habitant un territoire tapissé d’histoire. Les régimes fédéraux abondent en exemples de systèmes simplifiés : les états fédérés aux États-Unis et au Mexique connaissent tous un régime présidentiel ; les premiers ministres des états fédérés au Canada ou les ministres-présidents des Länder allemands, pour leur part, sont comptables de leur gestion devant un parlement monocaméral. Bien évidemment, si, par extraordinaire, à la suite d’une crise encore indéfinie, les Français devaient dire halte à l’intégration européenne ou redonner à leur souveraineté nationale plus de vigueur, il n’est pas interdit qu’un individu improbable se pointe à l’horizon, sorti même du fin fond de la province, pour remettre en selle un régime affaibli…
Marc Chevrier
Notes
[1] AFP, « En les comparant aux Danois, Macron qualifie les François de “Gaulois réfractaires au changement” », Libération, 29 août 2018. En ligne : https://www.liberation.fr/france/2018/08/29/en-les-comparant-aux-danois-macron-qualifie-les-francais-de-gaulois-refractaires-au-changement_1675290 .
[2] Dictionnaire de la langue française, Littré, tome 3, p. 1370, Paris, Hachette, 1873-74, « province », en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5460034d/f1378.image .
[3] P. Willems, Le Droit public romain, Louvain, Imprimerie-Librairie Charles Peeters, 7e édition, 1910, p. 187, note 8.
[4] Jean-Michel David, La Romanisation de l’Italie, Paris, Flammarion, 1997, p. 52-53.
[5] Théodore Mommsen, Manuel des antiquités, tome III : le droit public romain, Paris, Thorine et Fils, éditeur, 1893, réimpression Diffusion de Boccard, Paris, 1984, p. 275.
[6] Bertrand Rouzies, « Paris provincialisée par les gilets jaunes ? », Mediapart, 10 décembre 2018.
[7] François Mauriac, La province, Paris, Hachette, 1926.
[8] Benjamin Constant, Benjamin Constant et la paix, réédition de L’Esprit de conquête, Paris, Gustave Ficker, 1904-1914, p. 51. Disponible dans le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France.
[9] Ibid., p. 58-59.
[10] Alexis de Tocqueville, L’ancien régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967.
[11] Décoloniser les provinces, Paris, éditions J’ai lu, 2018.
[12] Christophe Guilluy, La France périphérique, Paris, Flammarion, 2014.
[13] Guillaume Perrault, « Régions, départements : Hollande s’attaque au “millefeuille” », Le Figaro, 16 janvier 2014, http://www.lefigaro.fr/politique/2014/01/15/01002-20140115artfig00663-regions-departements-hollande-s-attaque-au-millefeuille.php . Voir aussi César Armand, « Nouvelles régions : une réforme territoriale inachevée », La tribune, 27 septembre 2018, https://www.latribune.fr/regions/nouvelles-regions-une-reforme-territoriale-inachevee-791790.html .
[14] Alexandre Devecchio, « Macron est une copie du Roi Louis-Philippe », Le Figaro, 20 novembre 2017. En ligne :
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2017/11/17/31005-20171117artfig00302-macron-est-une-copie-du-roi-louis-philippe.php . Grégoire Franconie, « Emmanuel Macron, le président de Juillet », Le Monde, 4 juillet 2017. En ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/04/emmanuel-macron-le-president-de-juillet_5155237_3232.html ; Daniel Fortin, « Relire Balzac pour comprendre le « moment Macron » », Les Échos, 29 mars 2018. En ligne : https://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0301485013674-relire-balzac-pour-comprendre-le-moment-macron-2165271.php .
[15] Jean-François Colosimo, « Les gilets jaunes s’adressent à l’aristocratie étatique et au clergé médiatique », Le Figaro Magazine, 14 décembre 2018, p. 42.
[16] Guglielmo Ferrero, Pouvoir : les génies invisibles de la cité, New York, Brentano, 1942. J’utiliserai l’édition suivante, coll. Le livre de Poche, Paris, Librairie générale française, 1988.
[17] Ibid., p. 25.
[18] Ibid., p. 234.
[19] Voir aussi Arnaud Teyssier, Louis-Philippe, Paris, Perrin 2010, p. 131-32, qui propose un récit légèrement différence de celui Ferrero.
[20] Guglielmo Ferrero, Pouvoir, déjà cité, p. 133.
[21] Ibid., p. 214.
[22] Ibid., p. 215.
[23] Ibid., p. 232.
[24] Jean-Marie Denquin, La monarchie aléatoire, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 142.
[25] Maurice Duverger, La monarchie républicaine, Paris, Robert Laffont, 1974.
[26] Les citations sont adaptées en français contemporain. Voir Michel de l’Hospital, Œuvres inédites de Michel de l’Hospital, chancelier de France, Tome 1, Paris, Boulland et cie, 1825, p. 6-7. Texte disponible dans le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France.
[27] Michel de l’Hospital, Harangue du chancelier Michel de l’Hospital sur un budget du XVIe siècle dans l’assemblée des États-généraux, Paris, Imprimerie Frimin-Didot, 1829, p. 14. Disponible dans le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France.
[28] Hervé Joly, « HEC-ENA un couple qui marche », Les analyses de l’OpesC no 15, novembre 2011. En ligne : http://www.opesc.org/analyses/doc/hec-ena.pdf .
[29] Emiliano Grossman et Nicolas Sauger, Introduction aux systèmes politiques nationaux de l’UE, Bruxelles, De Boeck université, 2007, p. 88-89.
[30] Alexis Feertchark, « Le référendum d’initiative citoyenne, une solution à la crise des “gilets jaunes »? », Le Figaro, 11 décembre 2018.En ligne : http://www.lefigaro.fr/politique/2018/12/11/01002-20181211artfig00284-le-referendum-d-initiative-citoyenne-une-solution-a-la-crise-des-gilets-jaunes.php .
[31] Sur cette question, voir notamment Philippe Lauvaux, Destins du présidentialisme, Paris, Presses universitaires de France. 2002.
[32] Voir notamment le discours du Président de la République au Parlement européen à Strasbourg, 17 avril 2018, Présidence de la République française, en ligne : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/04/17/discours-du-president-de-la-republique-au-parlement-europeen-a-strasbourg .






