L'expérience du CEGEP: urgence d'un bilan
Dans L’expérience des cégeps, urgence d’un bilan, article paru dans la revue Critère en 1973, Guy Rocher et Fernand Dumont s’élèvent d’abord contre une spécialisation prématurée contraignant les étudiants à s’engager dans une carrière dès le secondaire. À la concentration liée à cette spécialisation avant l’heure, ils opposent un choix de cours, une polyvalence semblable à celle du secondaire. Tournant le dos à ce qu’ils appellent la « défunte culture générale » réduite, à leurs yeux, à une compilation encyclopédique, ils proposent une culture fondamentale, axée sur la critique de même que sur le transfert des connaissances et fondée sur quatre dimensions : l’histoire, l’expression, l’Entendement (et son langage, les mathématiques) , la transcendance ( et son lieu, la philosophie).
Faut-il voir là un effet de l'excessive centralisation du ministère de l'Education ? Pour dialoguer avec la technocratie du ministère, les syndicats d'enseignants ont mis en place leur technocratie, de sorte que nous assistons sans émotion aux savants plaidoyers de bureaucrates, armés chacun de lourds dossiers, de statistiques et de formules apparemment toutes magiques.
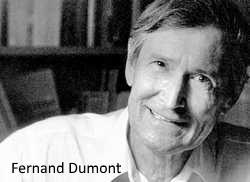 Les négociations qui s'éternisent entre le Gouvernement du Québec et la C.E.Q. sont devenues depuis longtemps inintelligibles à la très grande majorité du public. Le même phénomène risque de se produire dans la discussion qui oppose présentement la Fédération Nationale des Enseignants du Québec (FNEQ) et le ministère de l'Education au sujet du nouveau régime pédagogique dans les CEGEP. A force de traiter d'une série de points d'inégale importance et dont les liens n'apparaissent pas clairement, les problèmes de fond finissent par nous échapper, les options fondamentales s'estompent et l'on perd de vue les perspectives d'ensemble.
Les négociations qui s'éternisent entre le Gouvernement du Québec et la C.E.Q. sont devenues depuis longtemps inintelligibles à la très grande majorité du public. Le même phénomène risque de se produire dans la discussion qui oppose présentement la Fédération Nationale des Enseignants du Québec (FNEQ) et le ministère de l'Education au sujet du nouveau régime pédagogique dans les CEGEP. A force de traiter d'une série de points d'inégale importance et dont les liens n'apparaissent pas clairement, les problèmes de fond finissent par nous échapper, les options fondamentales s'estompent et l'on perd de vue les perspectives d'ensemble.
Il serait regrettable que le débat suscité par le projet de régime pédagogique au sujet des CEGEP s'enlise dans les mêmes ornières. Il pourrait en effet être l'occasion d'une réflexion élargie sur l'orientation actuelle de ce nouveau type d'institution d'enseignement post-secondaire que le Québec s'est donné depuis cinq ans. Le temps est arrivé où l'expérience accumulée et les lignes de force déjà inscrites permettent de dresser un premier bilan et de poser certaines questions en même temps que certains jugements.
Pour notre part, nous n'avons la prétention ni de faire une évaluation globale de l'expérience du CEGEP, ni de nous poser en arbitre dans le débat qui oppose la DIGEC à la FNEQ. Nous avons plutôt voulu, à l'occasion de ce débat, exprimer nos inquiétudes au sujet de certaines orientations actuelles des CEGEP et dire nos espoirs en même temps que nos attentes.
La sur-spécialisation des études au niveau des CEGEP
De toutes les questions que l'on peut soulever au sujet des CEGEP, une des plus importantes concerne le degré de spécialisation des études à ce niveau de scolarité. On a peu fait référence à ce problème dans le débat engagé autour du nouveau régime pédagogique. Nous croyons pourtant qu'il s'agit d'une question centrale dans l'évolution actuelle des CEGEP et que c'est là un des facteurs du malaise qu'on peut observer chez les étudiants.
La Commission Parent, à qui l'on doit l'idée du CEGEP et les premières indications sur ce qu'il pouvait être, s'était appliquée à décrire une sorte d'équilibre entre spécialisation et formation générale. Par la suite, le Comité Roquet a accordé beaucoup d'attention à cette question, même si ce n'était pas l'objet premier du mandat qu'on lui avait confié.
A notre avis, l'intention originelle qu'avait la Commission Parent, lorsqu'elle a recommandé la création des CEGEP, a été en partie trahie par la manière dont on l'a réalisée, notamment par l'excès de spécialisation qu'on leur a fait subir. Tel que proposé par la Commission Parent, le CEGEP devait être une institution essentiellement polyvalente et extrêmement souple. On espérait ouvrir la porte des études générales et professionnelles au plus grand nombre d'étudiants possible; on voulait que les étudiants puissent se réorienter tardivement sans avoir à revenir en arrière et sans perdre trop de temps. C'est à ces fins que la Commission Parent recommandait que le CEGEP ne soit pas conçu comme un ensemble de sections ou de divisions, mais plutôt comme un système d'options, susceptible de laisser chaque étudiant libre d'élaborer un programme souple correspondant à ses intérêts et à ses aptitudes.
Cependant, probablement par réaction contre le mythe d'une fausse formation générale, la Commission Parent a émis l'opinion que l'étudiant de ce niveau était en mesure de se choisir une spécialité à laquelle il devait normalement consacrer le tiers de ses cours. C'est par cette porte entrouverte que l'on a fait entrer dans le CEGEP les idées de concentration, de départementalisation, de profils de cours pour l'admission à l'université, de pré-requis aux pré-requis des pré-requis, entraînant ainsi le CEGEP loin de l'idée de l'institution polyvalente qu'il devait être et loin du système d'options. Le CEGEP s'est construit par la mise en place d'une série de canaux parmi lesquels l'étudiant doit obligatoirement choisir celui qui lui semble le plus apte à le mener là où il veut aller; ou plus souvent encore choisit-il celui qui lui paraît le moins mal approprié à ce qu'il se propose de faire. Dès son entrée au CEGEP, l'étudiant est tenu de choisir sa concentration, il doit savoir quels cours celle-ci l'oblige à prendre et ce qu'elle lui permet ou lui interdit de faire en dehors d'elle.
Ce régime s'allie bien à la spécialisation professionnelle que viennent chercher au CEGEP une proportion croissante d'étudiants. Mais il risque d'avoir des effets néfastes dans le cas de ceux qui sont inscrits dans ce que l'on appelle encore malgré tout les études générales. Il en résulte en effet que beaucoup d'étudiants se voient obligés de s'orienter d'une manière définitive dès le milieu du cours secondaire, c'est-à-dire dès l'âge de quinze ans. Au secondaire, ils doivent déjà faire des choix de cours en fonction de leur orientation future au CEGEP, compte tenu de la faculté à laquelle ils veulent finalement parvenir.
Il est évident que ce régime de sections spécialisées à l'excès et requérant déjà à l'entrée du CEGEP un certain bagage de cours entraîne des inconvénients majeurs pour un bon nombre d'étudiants. Ainsi, celui qui veux changer d'orientation en cours de route, par exemple à la fin de la première année du CEGEP, risque d'avoir à faire une année complète supplémentaire, parfois plus, pour suivre des cours qu'il n'avait pas choisis, afin de compléter soit le programme obligatoire de sa concentration, soit le programme de cours complémentaires à la concentration.
Autre inconvénient: il arrive que des étudiants ne sont pas admis dans un CEGEP parce qu'ils désirent s'inscrire dans une concentration déjà saturée. Par le système de sections qu'il a créé, le CEGEP devient un goulot d'étranglement dans le système scolaire, ce qui va à l'encontre de l'intention qui a présidé à sa création. Des étudiants astucieux connaissent maintenant le truc : ils s'inscrivent dans une concentration moins populaire et, une fois sur place, demandent un transfert dans la concentration à laquelle ils voulaient d'abord s'inscrire.
Il se trouve en plus que la concentration majeure à laquelle s'inscrit l'étudiant se double de ce que l'on pourrait appeler des concentrations secondes. En dehors de sa concentration, l'étudiant n'est autorisé à choisir qu'un nombre limité de disciplines complémentaires. Un étudiant qui aurait pris un éventail de cours trop étendu et qui aurait poussé la curiosité jusqu'à vouloir explorer plusieurs univers de pensée risque de se voir refuser le D.E.C. au terme de ses études et de se faire imposer de revenir en arrière pour concentrer son programme autour de certaines disciplines. La spécialisation n'atteint donc pas seulement la concentration que l'étudiant a choisie, mais aussi les disciplines connexes qu'il est invité à fréquenter.
La responsabilité des universités et des universitaires
A l'occasion de la crise suscitée par le nouveau régime pédagogique, presque tous ceux qui sont intervenus ont attaqué le ministère de l'Education et plus particulièrement la DIGEC. On leur a reproché le secret qui a entouré la préparation du projet pédagogique, l'absence de consultation auprès des professeurs et des étudiants, les mécanismes de répression qu'on met en place, les contraintes que professeurs et étudiants vont devoir subir, la diminution des effectifs étudiants et du nombre des professeurs qui risque d'en résulter, etc. Si la DIGEC doit effectivement porter sa part de responsabilité, nous croyons qu'il faut aussi souligner rôle qu'ont joué les universitaires dans l'orientation qu'ont prise les CEGEP.
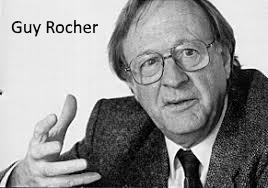 Dès le départ des CEGEP, les autorités du ministère de l'Education et la DIGEC ont voulu faire le point entre les études collégiales et le niveau universitaire. On voulait s'assurer que les étudiants terminant au CEGEP pourraient entrer directement dans le département, l'école ou la faculté de leur choix. Trop heureux, les universitaires ont saisi cette occasion pour dresser toute une série d'exigences à l'entrée de chacune de leurs facultés ou de leurs départements.
Dès le départ des CEGEP, les autorités du ministère de l'Education et la DIGEC ont voulu faire le point entre les études collégiales et le niveau universitaire. On voulait s'assurer que les étudiants terminant au CEGEP pourraient entrer directement dans le département, l'école ou la faculté de leur choix. Trop heureux, les universitaires ont saisi cette occasion pour dresser toute une série d'exigences à l'entrée de chacune de leurs facultés ou de leurs départements.
L'université s'est facilité la tâche en imposant au reste du système scolaire ses normes et ses critères pour l'admission des étudiants. Mais ce faisant, l'université a pesé de tout son poids sur le CEGEP et même par-delà le CEGEP sur l'école secondaire.
Par formation et peut-être par déformation, les universitaires ont une vue très spécialisée du monde et du monde du travail, et finalement aussi du monde de l'enseignement. Ils ont tendance à croire que la formation la plus parfaite est nécessairement celle de spécialiste, et que celui qui trouve le mieux à s'employer sur le marché du travail est l'expert qui a concentré toute sa formation dans une discipline précise donnée.
Cette mentalité de spécialisation a une certaine légitimité dans le cadre de l'université, bien qu'elle risque aussi d'y être passablement dangereuse. Elle devient une vue abstraite de la société et de l'homme lorsqu'on la projette au-delà de l'université. C'est ce qui s'est produit dans la formation des CEGEP, qui en portent encore les conséquences.
Il faut libérer les CEGEP des exigences des universités. Il faut que celles-ci en viennent à accepter d'être librement et largement ouvertes à tous les étudiants, quelle que soit leur formation antérieure. Il y a une large part de mythologie dans la croyance à la préparation nécessaire à tel ou tel département ou telle ou telle faculté universitaire. Cette mythologie a d'ailleurs eu une fonction sociale importante : elle a protégé le système de caste qui s'est organisé autour des professions traditionnelles aussi bien qu'autour des nouvelles professions issues de l'université. Il importe aujourd'hui de briser cette mythologie et de ramener le débat à ses véritables proportions. Il y a en vérité très peu de disciplines universitaires qui requièrent une aussi longue préparation antérieure que celle que l'on impose en ce moment. Aussi longtemps qu'on n'aura pas accepté ce fait, on continuera à faire peser sur les élèves de l'école secondaire et des CEGEP d'inutiles contraintes dans le choix de leurs options, aux dépens non pas de la «culture générale» mais de la formation générale que l'on a souhaitée à l'origine des CEGEP.
La défunte culture générale
Pour tout dire, et de la manière la plus abrupte, c'est l'appellation même de « culture générale » qu'il faudrait définitivement abolir. On s'étonne que les documents officiels, pourtant récents, l'aient conservée. Héritage sans doute d'une culture plus ancienne qui, ayant oublié aujourd'hui ses inspirations cachées, en garde néanmoins les notions et les mots. Il s'agit peut-être d'un héritage dégradé du « collège classique »: un corpus des «bonnes notions» que tout homme devrait posséder. On nous disait, en notre jeunesse, que c'était la base de nos savoirs à venir. La «culture générale» conçue comme base avait alors un sens parce que, par les autorités ou les idéologies, notre société se concevait comme cohérente. La culture moderne, bien avant que les hommes de notre âge aient accédé au «cours classique», n'était déjà plus un édifice dont on puisse discerner concrètement les fondations. Ce serait une enquête édifiante à mener que de demander à un échantillon de « professionnels », d'ouvriers, de cultivateurs... et de fonctionnaires, ce qu'ils entendent par « culture générale ». On ajouterait surtout des hésitations à des silences. Pourquoi alors l'inscrire dans des structures et des textes officiels ?
L'appellation n'a d'intérêt que par les ambiguïtés qu'elle révèle quant à l'ensemble de l'entreprise scolaire.
Elle laisse d'abord à entendre que la « culture générale » est l'affaire de l'école. Celle-ci a toujours plus ou moins postulé que l'enfant entre à l'école dépourvu de toute vision cohérente du monde, donc de toute « culture générale ». C'est pourquoi, sans doute, les enfants de milieux dits « populaires » ne retrouvent plus à l'école le moindre écho de ce qui est pourtant leur culture quotidienne ; que s'instruire, pour eux, c'est apprendre les bonnes règles d'une société de nulle part ou d'une société où ils seront chez eux s'ils travaillent bien... à se déraciner. On s'étonnera ensuite que les indices de scolarisation, répartis selon les classes sociales, n'aient guère marqué de changements décisifs malgré notre supposée «révolution scolaire».
Mais essayons, s'il se peut, de cerner les intentions qui se cachent sous cette vague notion de « culture générale ». Serait-ce une sorte d'écrémage des connaissances disponibles au XXe siècle, un compendium de littérature, de physique, de minéralogie, d'écologie, de linguistique, et de quoi encore ? Ce savoir-là n'en est pas un parce qu'il est sans pointe. Dans le monde qui est le nôtre, où les messages sont nombreux et hétéroclites, où loin de fortifier la pensée l'information l'écrase, comme est dérisoire la prétention de l'école à fournir sa petite encyclopédie préalable!
Quittons donc résolument le terrain marécageux de la « culture générale », pour nous demander, plus carrément et plus ouvertement, si entre les options qui bientôt vont s'imposer dès la maternelle, et la défunte culture générale, il n'y aurait pas quelque problème et quelque aménagement qui vaudraient d'être examinés.
Il faudrait alors revenir plus avant. A des questions toutes simples qu'un enfant d'aujourd'hui se pose et qui, comme par hasard, se trouvèrent à l'origine de notre civilisation. « Connais-toi toi-même », «Qui suis-je?»: à des siècles de distance, voilà un vieil impératif et une vieille interrogation que nous portons par la vertu de l'Occident. Ils se sont exacerbés : où sont maintenant les coordonnées un peu concrètes qui permettraient de les circonscrire ? Se «trouver soi-même» chez les Grecs, c'était contempler l'univers immuable du cosmos. Depuis la Renaissance, il n'y a plus d'image du cosmos. Se « trouver soi-même », c'était hier encore au Québec se référer par adhésion ou opposition à l'Eglise. L'Eglise ne provoque plus de pareilles circonscriptions des débats. Pour un adulte comme pour un enfant d'aujourd'hui, dominer la foule et l'incohérence des messages qui pèsent sur lui, ce n'est point les résumer. C'est retrouver un fondement dans les logiques et les valeurs, dans le sens du monde fragmenté et dans les éparpillements de nos intentions. Faut-il souligner, à cet égard, que les parents d'aujourd'hui, et de quelque milieu qu'ils soient, sont complices de leurs enfants dans la même angoisse ?
Ce n'est point une culture générale qui peut y pourvoir, mais ce que nous appellerons plutôt une culture fondamentale.
Une culture fondamentale, ce serait un savoir qui critique tous les autres. Par définition, la moindre connaissance est une critique. A moins d'être une pure compilation. Et encore, ce que nous sommes portés à considérer comme compilations, comme des amas de données dans les civilisations plus anciennes, relevait toujours de valeurs bien déterminées. Ce n'est pas par un vain amour des faits bruts que les chroniqueurs de l'antiquité chinoise, judaïque ou grecque inscrivaient dans leurs écritures des faits qui pour nous sont insignifiants : ils marquaient, à chaque fois, la continuité et le sens de la culture à laquelle ils appartenaient.
Nous n'avons plus cette faculté de retrouver l'unité au niveau des événements et des messages concrets. Même pas dans nos énormes savoirs officiels que l'on distribue par tranches dans les écoles, les facultés universitaires ou les congrès scientifiques. Un savoir critique doit maintenant consentir à ramener aux situations fondamentales : en-dessous de l'information informe ou des idéologies réconciliatrices, en-dessous aussi des parti-pris superficiels qui inspirent nos sentimentalismes et ceux de nos enfants.
Un savoir fondamental, un savoir critique : ces expressions sont encore trop courtes. Pour certains, le fondement et la critique procèdent de principes éternels ; pour d'autres, ils viendraient de la conjoncture politique. Les enquêtes du ministère, fussent-elles dirigées par M. l'abbé Dion, ne trancheront pas ce dilemme qui ne tient pas au monde des écoles.
Aussi faut-il, en définitive, trouver un critère de la culture fondamentale qui ne relève ni de la police, ni d'un ministre, ni du sentiment variable des parents et des enfants. Ce critère existe. Un savoir fondamental, un savoir critique se reconnaît à ce signe qu'il est transférable. Nous utilisons le mot transfert selon le sens le plus obvie consacré par la psychologie de l'apprentissage. Nous l'illustrerons par une anecdote. En 1939, lorsqu'il fallut que la France consente à produire rapidement les armes qu'elle n'avait pas fabriquées auparavant, le problème se posa de convertir des ouvriers aux exigences de la métallurgie. Aucun n'y réussit mieux, à ce qu'on dit, que les élèves finissants de l'Ecole d'ébénisterie. Pourtant, entre le travail artisanal du bois et le tournage de pièces d'acier en usine, quelle distance concrète. Mais, quand on a appris à travailler, selon certaines exigences, on déplace vite sa faculté de le faire sur d'autres objets ?
Une culture fondamentale, ce serait celle qui pourrait se déplacer rapidement. Parce qu'elle est remontée à la source dont l'encyclopédisme n'est que la vaine nostalgie.
On ne s'est pas assuré que les concentrations permettraient le transfert. Devant l'énorme accumulation du savoir, on semble avoir accepté un postulat: comme il n'est plus possible de survoler la dispersion de la culture, fabriquons des infirmes de la culture.
Mais on nous demandera justement comment traduire en termes de programmes ces exigences d'une culture fondamentale. Pour être tout à fait pratiques, il faudrait à la fois déterminer les axes de cette culture et les matières qui seraient privilégiées. Risquons là-dessus des hypothèses qui puissent au moins prêter à des discussions un peu circonscrites.
Pour partager la matière très grossièrement, il nous semble qu'un homme d'aujourd'hui aurait besoin de se situer selon quatre grandes dimensions. Elles se rejoignent d'ailleurs, comme il est naturel quand on parle de fondement, de critique et de transfert.
1. L'histoire, le devenir collectif est devenu si incertain et si fluent, les mass média et les partis nous encombrent de tant de nouvelles et d'opinions, que n'importe qui éprouve le besoin de prendre distance. De comprendre un peu d'où viennent ces débats de surface; de retrouver des débats plus anciens qui font de sa société une collectivité déchirée. En ce sens, l'histoire — à la condition qu'elle ne soit pas le catéchisme de M. Léandre Bergeron — est un savoir fondamental.
2. L'expression en est un autre. Au Québec, nous sommes bien placés pour le savoir. La langue que nous parlons sur ce continent semble sans avenir, sans portée sur l'appréhension et le devenir des choses. Pourquoi le français est-il obligatoire dans les CEGEP et ne l'est pas dans le monde du travail? Passons rapidement sur cette contradiction pourtant évidente. Il restera toujours que ce monde-ci ne peut être dominé que par le langage: jusqu'à nouvel ordre, cela nous distingue des animaux. Savoir une langue est donc, par définition, un savoir fondamental, critique, transférable. Mais, au XXe siècle, et au Québec, il vaudrait mieux connaître plusieurs langues. On porterait alors plus loin le transfert. Aussi, à notre avis, l'anglais (langue du continent) et une autre langue étrangère devraient être obligatoires au CEGEP. Le Québec n'aura d'avenir qu'à deux conditions: si le français y devient la langue du travail aussi bien que du loisir, si nous pouvons nous ouvrir sur un destin des sociétés et des langues qui dépasse infiniment les législations locales ou canadiennes sur le bilinguisme.
3. En deçà des langages ainsi entendus, la civilisation occidentale en a inventé un autre. Il relève, celui-là, de la structure de l'esprit; pour mieux dire, de l'Entendement que Kant distinguait fort justement de la Raison. Le langage de l'Entendement, dans le monde où nous sommes, c'est celui des mathématiques. Ce langage-là n'est lié, par principe, ni à la physique, ni à la chimie, ni à la sociologie, ni aux structuralismes dont on parle dans les Facultés de Lettres. Nous réclamons donc, pour notre part, des mathématiques pour tout le monde au CEGEP.
4. Se situer dans l'histoire, se situer dans les langages, se situer dans les logiques de l'Entendement appelle un achèvement qui est aussi un recommencement.
Chacun de ces modes du savoir constitue un des axes d'un dépassement du savoir lui-même. L'histoire ne se comprend, dans le fond, qu'à partir de ce qui prétend la surmonter pour la mettre en forme. Le langage ne rassemble qu'en disant ce qui serait autrement dispersé. La mathématique n'incarne la polyvalence de l'Entendement en effaçant provisoirement les situations de ceux qui l'épousent et le lien mystérieux d'où elle réunit les esprits.
Aussi faut-il qu'une éducation qui se prétend fondamentale, critique et transférable fasse appel à la transcendance.
La transcendance, ce n'est pas nécessairement Dieu. Il suffit d'avoir la moindre connaissance de la pensée moderne pour éviter cette méprise. La transcendance, c'est plus simplement ce lieu éminent où l'on se tient quand on fait de l'histoire, quand on parle, quand on trace des théorèmes. Ce lieu hypothétique vaut d'être exploré pour lui-même: c'est pourquoi nous croyons, mais dans ces limites, que l'enseignement de la philosophie devrait faire partie d'une culture fondamentale.
Sortir du carcan des concentrations
Reste ensuite à déterminer le programme des autres cours que les étudiants peuvent prendre suivant leur orientation. Mais au fait, faut-il vraiment fixer des programmes ? En dehors de ce qui relève de la culture fondamentale pour tous, faut-il maintenir des sections ou des concentrations et faut-il prévoir à l'avance le contenu de chacune de ces grandes divisions?
N'a-t-on pas mal interprété la notion de polyvalence? Celle-ci n'est pas institutionnelle mais doit être individuelle. L'étudiant doit pouvoir choisir son plan de cours selon son propre dessein, suivant le degré de spécialisation qu'il veut lui-même donner à ses études et l'étendue des autres domaines auxquels il s'intéresse. L'étudiant qui veut se spécialiser déjà à ce niveau devrait être autorisé à le faire, pourvu qu'il inscrive dans son programme d'études une suffisante proportion de cours extérieurs à la discipline qu'il a choisie. Par ailleurs, l'étudiant qui veut continuer à prendre contact avec les différentes sciences et les différentes disciplines et élargir la portée de son regard devrait lui aussi avoir la liberté de faire son programme dans cette perspective. Nous dirions même qu'on devrait encourager les étudiants à opter de préférence pour un programme de cours étendu et varié, plutôt que pour un programme concentré dans une discipline principale. Il faudrait, en d'autres termes, renverser complètement la vapeur par rapport à ce qui se fait présentement. En ce moment, c'est du côté de la spécialisation que penche le préjugé favorable et c'est dans ce sens que va tout le poids de l'organisation actuelle du CEGEP et de ses programmes d'études.
Le changement que nous proposons en est un d'optique en même temps que de structure. Il faut rendre à la notion de polyvalence son intention réelle et première: offrir à chaque étudiant une structure scolaire souple dans laquelle il puisse s'orienter selon ses intérêts et ses aptitudes, revenir à l'occasion sur ses options sans avoir à subir de pénalités graves et respecter les décisions qu'il prend dans la mesure où on l'a suffisamment éclairé sur les avantages et les inconvénients qui en résultent pour sa culture personnelle. Pour l'heure, on a figé la polyvalence dans des programmes d'études préétablis entre lesquels l'étudiant peut choisir mais à l'intérieur desquels il a peu de choix.
Un tel régime n'aura cependant de sens que dans la mesure où les étudiants pourront compter sur des conseillers qui les aideront à prendre des décisions raisonnées. L'erreur qu'on a commise au Québec a été d'instituer ce qu'on a cru être la polyvalence au niveau secondaire et au CEGEP, sans un corps solide de conseillers qui soient à la disposition des étudiants et qui sachent leurs donner des avis susceptibles de les aider dans leurs décisions.
A l'occasion du débat autour du projet de régime pédagogique, on a parlé des mécanismes de répression disciplinaire qui sont mis en place dans les CEGEP. Le projet de régime pédagogique a eu de toute évidence comme intention de mettre entre les mains des administrateurs des CEGEP une arme grossière pour lutter contre «les éléments indésirables»: le droit d'instituer arbitrairement une réinscription, comme on a voulu le faire au CEGEP du Vieux Montréal en pleine crise, de manière à pouvoir éliminer les étudiants contestataires. Mais il est une autre forme de répression dont souffrent les étudiants de CEGEP et que le décret ne fait que confirmer: c'est la répression de la liberté à choisir son orientation et son programme d'études. Il faut dénoncer ce type de répression, tout autant que la répression disciplinaire. Elle atteint d'ailleurs beaucoup plus d'étudiants, elle les touche dans leurs droits les plus fondamentaux et elle a des conséquences incalculables sur le niveau culturel de la population étudiante québécoise.
La nécessaire réforme de l'université
Mais tout cela ne sera qu'illusion aussi longtemps que l'université continuera à exiger que l'étudiant qui s'inscrit dans une discipline des sciences, ou des sciences sociales, ou en médecine, ait suivi telle ou telle séquence de cours et ait déjà accumulé un bagage mesurable de connaissances. Il serait urgent que les universitaires se livrent à un examen de conscience sévère sur les motifs pour lesquels ils ont établi le barrage des pré-requis à l'entrée de leurs départements. Il serait urgent que les universitaires se demandent s'il faut préfabriquer si longtemps à l'avance le futur mathématicien, le futur biologiste, le futur médecin, le futur économiste.
Contrairement à ce que l'on croit parfois, contrairement surtout à ce que les universitaires croient d'eux-mêmes, l'université est un lieu où les préjugés peuvent traîner très longtemps sans être remis en cause. Comment expliquer autrement que les universitaires estiment encore que la mathématique appartient nécessairement au monde des «sciences» et que le futur mathématicien doive nécessairement poursuivre d'abord des études de physique et de chimie? Comment expliquer autrement aussi que des universitaires imposent aux étudiants de suivre à l'université des cours qu'ils ont déjà reçus au CEGEP, sous prétexte que l'enseignement de ce dernier niveau n'a pas pu être de qualité égale à celui de l'université ? Ce faisant, les universitaires condamnent d'ailleurs eux-mêmes les prérequis qu'ils ont imposés à leurs étudiants.
L'enseignement sera évidemment plus difficile pour les professeurs d'université lorsque les étudiants leur arriveront après avoir parcouru des trajectoires variées et ayant des connaissances inégales dans la discipline ou les disciplines qu'ils choisissent à l'université. Mais il faut reconnaître que jusqu'ici les universitaires se sont donné la tâche facile en obligeant l'enseignement secondaire et le CEGEP à leur fournir des étudiants ayant tous atteint le même niveau de connaissance. Les universitaires se constituent ainsi des classes homogènes aux dépens de la polyvalence des niveaux d'études antérieures.
Changement d'optique ici encore et changement d'attitude: voilà ce qu'il faut attendre des universitaires. Ils doivent accepter que l'école secondaire et le CEGEP n'ont pas comme fonction principale de préparer à l'université.
Il faudra aussi convaincre les universitaires d'abandonner la notion de formation linéaire à laquelle ils se réfèrent depuis trop longtemps. Est-ce catastrophe si un biologiste ou un mathématicien s'est attardé quelque temps à la poésie? Aujourd'hui, ceux qui appliquent les connaissances scientifiques d'une manière professionnelle ont des responsabilités morales, sociales et humaines qui s'étendent bien au-delà de leur formation spécialisée. Comment le médecin peut-il réfléchir sur le problème difficile de l'avortement ou de l'euthanasie s'il n'a pas été sensibilisé aux dimensions individuelles et collectives des pratiques médicales? L'hôpital est un monde social extrêmement complexe, dont le fonctionnement conditionne l'ensemble des gestes médicaux et la réaction des patients. Continuera-ton longtemps à manipuler le patient hospitalisé et à le traiter comme un objet aliéné de lui-même? Tels sont quelques-uns des problèmes auxquels la médecine contemporaine va devoir réfléchir et au sujet desquels il faudra probablement réviser l'attitude du personnel médical. Est-ce y préparer convenablement que d'imposer aux jeunes qui veulent devenir médecins une formation sur-spécialisée en mathématiques, en physique et en chimie ?
L'ingénieur ne peut plus être un expert étroit. Il est un chef d'équipe, un leader, un administrateur. Il lui faut constamment être attentif à la vie du groupe qu'il dirige, au réseau complexe des interactions et des relations humaines, à la mécanique et à la dynamique des groupes et des institutions. Un ingénieur, qui n'aurait pas une connaissance suffisante des sciences et qui n'aurait pas été confronté aux profondeurs de la conscience humaine par la voie du roman ou de la poésie, serait privé d'une capacité d'intuition et d'analyse qui risque de faire échec à son travail professionnel. Sans compter qu'il est coupé d'un univers culturel auquel il devrait normalement accéder au terme de tant d'années de scolarité.
C'est en définitive le droit de l'homme de se réaliser pleinement à travers le système d'éducation, au lieu de s'aliéner et de se diminuer, que nous réclamons pour la jeunesse actuelle et future.
Urgence d’un bilan
Dans ces prises de position nous souhaitons seulement contribuer quelque peu à ce bilan dont nous disions l'urgente nécessité au début de cet article. Il est temps de s'interroger sur ce que le système d'enseignement à tous ses niveaux pourrait apporter au grandissement de l'homme et en quoi il menace présentement l'homme et la culture. Les enseignants devront accepter l'examen approfondi que requiert actuellement le système d'enseignement et ne pas se sentir menacés par l'effort de révision qui est devenu nécessaire.
Peut-être y aurait-il lieu de songer à mettre au travail une commission d'enquête sur l'enseignement post-secondaire au Québec. La Commission Parent n'a pas suffisamment approfondi l'évolution nécessaire des universités ; par ailleurs, le temps est venu d'évaluer l'expérience des CEGEP et l'orientation qu'on leur a donnée jusqu'à présent.
La valeur d'une commission d'enquête ne réside pas nécessairement, et peut-être surtout pas dans le rapport qu'elle remet et les recommandations qu'elle soumet. Il faut y voir avant tout l'occasion d'un vaste débat public sur des problèmes urgents et complexes. Ce serait probablement la meilleure façon de sortir le débat qui vient de s'engager autour des CEGEP de l'ornière dans laquelle il risque de s'enliser s'il ne demeure qu'un dialogue — et encore s'agira-t-il d'un dialogue de sourds — entre le ministère de l'Education et le syndicat des professeurs (Fédération nationale des enseignants du Québec). C'est toute la société québécoise qui se trouve intéressée, en particulier les parents et les étudiants. C'est elle qui doit avoir droit de regard et de parole sur la manière dont au Québec on décide de l'éducation.
Fernand Dumont,
Directeur de l'Institut des Sciences humaines,
Université Laval,
et Guy Rocher,
Membre de la Commission Parent, Co-directeur du projet ASOPE (les aspirations scolaires et les orientations professionnelles des étudiants du Québec).
Montréal-Québec, décembre 1972.
25