Serge Gagnon, un destin clandestin
À propos de son dernier livre : Destin clandestin. PUL, 2016. Les chiffres suivant les citations renvoient aux pages du livre.
Ouvrant ce livre au hasard, je tombe sur une page portant sur une demande de subvention. Mauvais présage! De leur propre aveu, les professeurs d’université passent la moitié de leur temps à remplir des formulaires de subvention et l’autre moitié à évaluer les formulaires de leurs collègues. Comment peut-t-il leur venir à l’esprit de raconter leur vie professionnelle sans craindre de plonger leurs lecteurs dans l’ennui le plus profond?
Même si Serge Gagnon a présenté son livre comme une autobiographie intellectuelle, les subventions y occupent une place importante. Je l’ai pourtant lu d’un trait comme on boit de l’eau fraîche en été après avoir beaucoup sué. Serge Gagnon est non seulement un historien rigoureux mais aussi un écrivain c’est-à-dire un savant qui a de la compassion pour ses lecteurs : il ressuscite leur intérêt au moment où il va fléchir. Il est même parvenu à donner un sens aux demandes de subvention en les présentant comme une illustration à la fois de la méthode et de la vertu universitaires.
Méthode et vertu universitaires
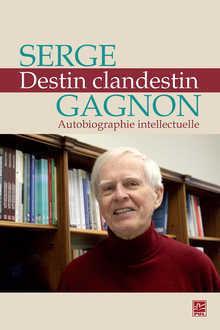 Quelle étrange dialectique que la démarche universitaire! Par dialectique, j’entends ici la méthode socratique où la contradiction fait progresser la pensée. Dans la démarche universitaire, le contradicteur est souvent anonyme, il est l’évaluateur A, B ou C, qu’il s’agisse d’une demande de fonds de recherche ou de subventions pour la publication d’un livre. Vu sous cet angle, le jeu est vicieux et pas très honorable. Gagnon cite lui-même Corneille à ce propos : «À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.» Mais il faut du jugement, de la prudence, de la ruse, de la pugnacité, du fair play pour gagner; or ce sont là des qualités bien utiles dans toute société. Serge Gagnon possède au plus haut degré cette vertu universitaire.
Quelle étrange dialectique que la démarche universitaire! Par dialectique, j’entends ici la méthode socratique où la contradiction fait progresser la pensée. Dans la démarche universitaire, le contradicteur est souvent anonyme, il est l’évaluateur A, B ou C, qu’il s’agisse d’une demande de fonds de recherche ou de subventions pour la publication d’un livre. Vu sous cet angle, le jeu est vicieux et pas très honorable. Gagnon cite lui-même Corneille à ce propos : «À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.» Mais il faut du jugement, de la prudence, de la ruse, de la pugnacité, du fair play pour gagner; or ce sont là des qualités bien utiles dans toute société. Serge Gagnon possède au plus haut degré cette vertu universitaire.
Quelle est la part de l’esprit de vengeance et de l’amour courageux et persévérant de la vérité dans cette vertu? La proportion varie selon les chercheurs et selon les moments de leur carrière. L’essentiel c’est que cette démarche assure le progrès de la connaissance. Or, et c’est là l’une des qualités de son livre, Serge Gagnon démontre la chose à maintes reprises. Saviez-vous que «de 1921 et 1934 entre 18 % et 23% des revenus de la province de Québec provenaient de la Commission des liqueurs?» Serge Gagnon invoque ce fait dans le cadre d’un débat avec des historiens canadiens anglais, dont Richard Yen au sujet de la« Priest Ridden Province.» (170) Au même moment, rappelle-t-il à Yen, «l’Amérique puritaine était mise au régime par voie législative». Et il ajoute : «au hasard de nos découvertes, la conviction que le clergé n’exerçait pas l’hégémonie qu’on lui prêtait sur les manières de vivre s’est consolidée»,
À maintes reprises Serge Gagnon remercie l’auteur A, B ou C d’une évaluation négative. Un tel, écrit-il, «a souligné les erreurs que j’ai répétées concernant la population du Bas-Canada vers 1790. Je le remercie de m’avoir corrigé.»(113)
C’est ainsi que la connaissance progresse. Serge Gagnon dirait plutôt : c’est ainsi qu’on se rapproche de la vérité. Car l’amour de la vérité occupe une place centrale dans sa vertu universitaire. Ses collègues de l’ensemble du secteur des sciences humaines devraient lui être reconnaissant d’avoir si bien montré que dans toutes ces disciplines molles, au statut épistémologique incertain, la vertu universitaire peut s’exercer au point que le mot science, accolé auxdites disciplines paraît justifié. Jamais l’expression communauté de savants n’a eu autant de sens à mes yeux.
Réconciliation d’un homme et d’un pays avec eux-mêmes
L’intérêt du livre tient aussi au fait qu’en racontant l’histoire de sa vie intellectuelle, Gagnon joint l’universel au particulier. Il est en effet l’un des rares universitaires de sa génération qui est demeuré fidèle aux lumières qu’il avait aperçues dans la grande noirceur de sa jeunesse (il est né en 1938). En évoquant son destin clandestin, il met en lumière bien des aspects de la révolution tranquille auxquels on n’aurait jamais prêté attention autrement.
C’est, précise-t-il dans l’introduction, pour relever un défi que lui avait lancé l’historien Éric Bédard en 2003 qu’il a écrit son autobiographie : «Vos œuvres, écrivait Éric Bédard, nous permettent de mieux comprendre notre passé, mais elles sont aussi des témoignages... J'espère que vous expliquerez un jour ce qui vous a mené à écrire le livre Mourir ... En historien sérieux, vous pourriez facilement nous convaincre qu'il s'agit d'un nouvel intérêt pour « l'histoire des mentalités », mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup plus que cela... Vous rompez avec le paradigme dominant d'une certaine époque, d'une génération... Pourquoi? Que s'est-il passé? Life begins at 40, avez-vous écrit quelque part... Peut-être... Mais avouez que c'est un raccourci ! La vie ne semble pas avoir commencé à 40 ans pour Gérard Bouchard, Paul-André Linteau, Brian Young ou René Hardy dont les travaux montrent une certaine continuité sur le plan paradigmatique... Pourquoi est-ce différent chez vous? Ces questions, je me les pose depuis longtemps... »(2)
Dans ses premiers ouvrages, dont sa thèse de doctorat, Le Québec et ses historiens, Serge Gagnon se présente d’abord comme un définisseur de la méthode en histoire, plutôt que comme un défenseur d’un passé religieux auquel la grande majorité des universitaires de sa génération ont tourné le dos résolument. Mais on voit déjà, notamment dans sa querelle historique avec son collègue Fernand Ouellet, poindre les causes au service desquelles il mettra sa rigueur. Il résume ainsi la thèse de Ouellet :
«La bourgeoisie d'affaires anglo-britannique avait réussi à dominer l'espace laurentien sans l'aide de l'État, colonial ou métropolitain. Les entrepreneurs qui ont bâti l'empire commercial du Saint-Laurent avaient la bosse des affaires. L'incapacité des Canadiens à rivaliser d'adresse avec les Britanniques était imputable à leurs propres lacunes, alimentées par leur formation dans les «collèges classiques où l'argent était méprisé». (80)
À quoi Serge Gagnon répliqua que le passage de l'empire français à l'empire britannique avait lourdement handicapé la participation des Canadiens dans les échanges avec la nouvelle métropole. Le refuge dans le religieux, observé dans d'autres nations sous domination étrangère, m'apparaissait comme une conséquence de ce changement politico-militaire.
Selon Ouellet, ajoute Gagnon, « j'aurais commis l'erreur d'accréditer la thèse néo-nationaliste. Le passéisme des historiens du XIXe siècle serait, selon son point de vue, le simple reflet de la puissance du clergé depuis l'époque coloniale française. Fidèle à ses réflexes quantophréniques, cette manie de tout traduire en chiffres, Ouellet invoque une statistique dont on reconnaît aujourd'hui le faible apport heuristique: le recul des effectifs cléricaux après la conquête n'a pas vraiment affaibli la puissance de l'Église. Un prêtre pour 1800 fidèles vers 1830, c'est encore beaucoup, selon lui, puisque ce chiffre équivaut à la population moyenne d'une paroisse. Il ne dit pas que les prêtres diocésains.» (81) Autre réplique de Gagnon : «on sait aujourd’hui qu’au début du XIXe siècle environ le tiers des lieux de culte était privé de résidents.»
Après 1980, Serge Gagnon se tourna vers l’histoire des mentalités, ce qui l’amènera à publier Mourir hier et aujourd’hui, en 1987, celui de ses livres qui eut le plus de succès auprès du grand public. Pour ma part je vois plus de continuité que de discontinuité entre ces deux étapes dans la carrière de Gagnon. Il n’a jamais cessé de naviguer à contre-courant dans cette révolution tranquille du refus global. C’est le choix des sujets qui marque la plus grande différence entre les deux étapes : d’un côté le Québec et ses historiens, de l’autre : Mourir hier et aujourd’hui, Plaisir d’amour et crainte de Dieu, Mariage et famille au temps de Papineau. Certes, sa liberté s’accroît à mesure qu’il se rapproche de la retraite, mais elle ne change pas de nature.
On est toujours en retard d’une ou deux libertés. Être libre en 1950 c’était, comme Jean-Paul Desbiens avait commencé à le faire, s’opposer à la toute-puissance du clergé. Encore aujourd’hui bien des intellectuels se contentent de faire du sur place dans cette liberté conformiste, ne comportant désormais aucun risque. En 1980, ils étaient encore plus nombreux à se glorifier de livrer ce combat déjà gagné. À cette époque, le plus grand risque et donc la plus grande liberté, consistait à défendre l’indéfendable, à rappeler par exemple que l’hédonisme de la génération lyrique n’est pas à tous égards préférable au renoncement des anciens, ce qu’a fait Gagnon.
Comme son ami et son modèle en cette matière, Fernand Dumont, Gagnon n’est pas moralisateur. Il ne cherche en aucune manière à convaincre ses lecteurs ou ses collèges de revenir à la morale conjugale de l’époque où, au Saguenay, la moyenne d’enfants par famille était de dix. Mais en historien honnête il ne méprise pas a priori ces anciens plus féconds que jouisseurs selon toute probabilité. Il constate les faits :
«En admettant que le Dieu des chrétiens est une invention des hommes, on n'en devrait pas moins reconnaître que l'hyper-fécondité, fortement encouragée par les prêtres, a fait émerger l’une des nations les plus jeunes et les plus dynamiques de l'Occident. C'est cette jeunesse fonceuse et frondeuse qui a fait la Révolution tranquille. À l'écoute des cadets de famille qui déplorent les vestiges de religiosité, on se demande s'il s'en trouve qui soient malheureux d'avoir été conçus. L'historien Michel Brunet a maintes fois souligné l'impor¬tance décisive du nombre au sein des entités politiques composées de plusieurs nations. Au cours des années 1960, l'historien rappelait la crainte du Canada anglais au lendemain du recensement de 1941. Le décompte décennal suivant allait-il révéler que les Canadiens de langue française formaient désormais une majorité au sein de la fédération canadienne.» (210)
Dans le même esprit, mais dans un tout autre domaine, celui de l’enseignement de la langue, Gagnon fait de nouveau preuve de la plus grande liberté d’esprit : «Quelques intellectuels dénoncent, à l'occasion, l'état lamentable du français québécois. Au temps des prêtres, des religieux et des religieuses, une faute de grammaire, comme une faute contre les normes sexuelles catholiques, engendrait presque naturellement honte et remords. Depuis que la honte est devenue un sentiment honteux, on peine à cultiver cette fierté à l'endroit d'un héritage.»(213)
«Le mariage de la religion et de la culture ne va pas revenir, ajoute Gagnon. Comment faire renaître la fierté à l'égard d'une langue vouée à l'indifférence, voire au mépris?» (213)
Gagnon n’est pas passéiste. Il n’a pas le désir de renouer avec «la religion de la peur» dont il s’est libéré très tôt, ni l’illusion de pouvoir le faire et s’il a persévéré dans sa pratique religieuse s’est moins par souci de l’orthodoxie que par une fidélité indulgente : «Comme chrétien, j'ai toujours eu de la difficulté à croire aux prodiges rapportés dans les récits évangéliques. Je crois que le Christ était fils de Dieu, qu'il est venu sur terre pour faire connaître son père, mais je ressens un certain malaise à le voir exercer des pouvoirs qui suspendent l'ordre naturel des événements. Je souscris par ailleurs aux exigences de partage, reproduites en annexe de L'argent du curé de campagne. Suis-je un peu beaucoup rationaliste ? Scientiste ? Probablement.» (61-62)
Du renoncement à l’hédonisme
Dans Destin clandestin, tout gravite autour de l’opposition entre le renoncement des anciens, leur adhésion spontanée au principe de réalité et l’hédonisme des contemporains, leur fixation au principe de plaisir. Sur cette question cruciale Serge Gagnon a malheureusement privé ses lecteurs de développements subtils. Son diagnostic est un peu court. Si incontestable qu’il soit à première vue, il laisse sans même l’ébauche d’une réponse une foule de questions aussi importantes qu’intéressantes. Les nuances attendues, on les trouve en fait dans les ouvrages antérieurs de Gagnon, Plaisirs d’amour et crainte de Dieu en particulier. Ce livre a reçu un bon accueil en France, la revue Annales, par exemple, lui a consacré un compte-rendu dont l’auteur, Marcel Bernos, après avoir parodié le titre, le transformant en Amour de Dieu et crainte du plaisir, formule ce jugement d’ensemble : «En quelques cas, néanmoins, un réalisme pastoral amène les responsables de l'autorité à freiner le zèle intempestif d'un prêtre trop scrupuleux dans sa chasse au péché, ou à accorder une dispense autorisant un mariage dans un cas d'empêchement pourtant grave, afin de régler, par exemple, l'avenir d'une jeune femme enceinte hors mariage. Ce véritable dialogue avec les desservants, compte tenu de la profondeur psychologique de certains conseils donnés, ou — au contraire — de certaines rigidités, n'est pas l'un des moindres intérêts de cette étude.»
Dans Quand le Québec manquait de prêtres (2006), Gagnon évoque un personnage vraiment original, le curé Charles-François Painchaud, grand admirateur de Chateaubriand, fondateur du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Michel Lapierre note à son sujet, dans Le Devoir du 9 décembre 2006 : «Prêtre plus moderne, l'abbé Painchaud, peut-être séduit par la lecture d'Atala, de Chateaubriand, prend le temps d'écrire une longue dissertation latine sur les bienfaits de la masturbation occasionnelle pratiquée par les époux légitimes. Mais le curé au romantisme audacieux se voit rabroué par Mgr Plessis.»
___________________________________________________________
 De pollutione
De pollutione
(Texte d’un curé de campagne du Bas-Canada – Charles-François Painchaud)
L’argumentation est présentée sous forme de questions et objections
Question : EST-CE TOUJOURS UN PÉCHÉ?
Saint Thomas dit OUI parce qu’il y a perte de semence destinée à la procréation.
Objection : Des circonstances font en sorte que ce ne peut être péché mortel : en faisant l’amour avec son épouse enceinte, la semence du mari est perdue, mais celui-ci ne pèche pas.
Saint Paul ne dit-il pas qu’on ne doit pas s’abstenir trop longtemps, sinon risque de pollution.
ONAN, le fils de Juda, ne s’est pas masturbé mais a jeté sa semence par terre (coït interrompu). Il fut puni de mort parce qu’il a refusé de faire un enfant à sa belle-sœur pour assurer la descendance de son frère, comme le lui avait commandé son père.
C’est sur ce seul passage des écritures qu’est fondé l’interdit de se masturber.
Q. S’agit-il d’un acte CONTRE NATURE?
O. Boire par le nez ou marcher sur la tête est contre nature, mais n’est pas un péché (sic).
Q. Serait-ce péché parce que C’EST AGRÉABLE?
O. Des personnes peuvent prendre plus de plaisir à prendre une boisson agréable qu’à se masturber.
Q. Serait-ce péché parce que c’est une SUBSTANCE PRÉCIEUSE?
O. On ampute un pied ou on se fait saigner, sans pécher, parce qu’il en va de l’amélioration de la santé.
La rétention peut être nocive : anxiété, céphalée…
«Des maladies très graves et parfois mortelles viennent d’un trop long séjour de la substance séminale demeurant dans les voies naturelles avec des démangeaisons qui en proviennent et qui peuvent pousser jusqu’à la fureur, ce qui arrive chez les animaux […] Il est [donc] permis de répandre la semence pour sauver la vie et principalement le célibataire dont la semence ne peut procréer, sans péché mortel».
Q. Le prêtre auquel est interdite la procréation pourrait-il éjaculer volontairement parce que sa semence est surabondante et nuisible?
O. Si la perte volontaire de semence était un péché parce qu’inutile à la procréation, le célibat des prêtres serait remis en question.
_________________________________________________________________________
Une dernière question
Il me reste une dernière question à Serge Gagnon. Elle porte sur ce qui peut sembler n’être qu’un détail, mais elle est importante à mes yeux. Je lis à la page 101 :«Le désir du dépassement et le souci de l’excellence, instillés dans les sociétés prémodernes, semblent aujourd’hui réservés à une minorité d’athlètes.» La même idée est reprise à la page deux cent dix-huit.
Cette réduction de la vertu des anciens à la performance des athlètes contemporains est-elle appropriée? L’athlète contemporain est victime du dualisme le plus radical : d’un côté, une volonté inflexible, de l’autre, un corps instrumentalisé, un corps outil, par rapport à un corps signe. Il en résulte un culte du record hystérique selon de nombreux psychologues, dont Ludwig Klages. Peut-on réduire la fécondité des anciens à un comportement de ce type? Les danses populaires n’étaient-elles pas des préliminaires raffinés montrant que le corps était vécu comme signe de l’âme plutôt que comme instrument de la volonté?
Annexe
Jugement de l’auteur sur le soi-disant racisme de Lionel Groulx
«Au fil des ans, j'ai cessé de croire que Groulx était raciste, comme on le répétait dans les cercles intellectuels ontariens. Dans une lettre étoffée, Pierre Trépanier, spécialiste de la pensée de Groulx, m'avait convaincu que le préjugé racial reproché au prêtre historien était sans fondement. Après avoir consulté des dictionnaires sur les concepts de nation et de race, j'ai conclu que Trépanier avait raison. Au début du XXe siècle, la race désignait une réalité très différente de celle qu'on lui donne aujourd'hui. Publié peu après La naissance d'une race, dernier ouvrage analysé dans mon livre, Le Canada, les deux races (Paris, A. Colin, 1906) d'André Siegfried n'était pas plus raciste que l'histoire du Canada de Garneau ou celle des historiens français, allemands, espagnols ou autres. Peuplée d'immigrants venus d'Europe, l'Amérique du Nord ferait évoluer, il est vrai, le concept de nation. Or, au temps de Garneau, l'immense majorité des Canadiens était de souche française, les colons venus de Grande-Bretagne formant une minorité d'étrangers.»






