La pierre de Satan, par Mario Pelletier
Ce grand livre, aussi français et américain que québécois, et même un peu cubain, est l’arbre d’une vie et d’une époque ayant commencé ensemble en 1945, après Hiroshima. (Éditions Les heures bleues, Montréal, septembre 2021.)
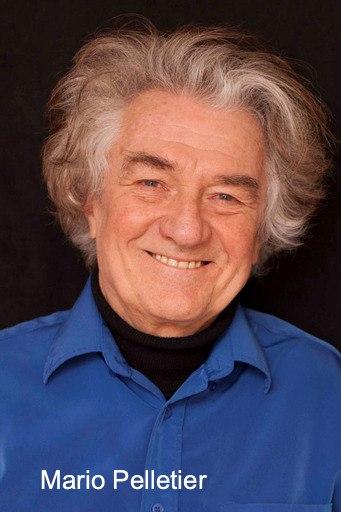 Le récit s’inspire en bonne partie de la vie de l’auteur, Mario Pelletier, Loïc dans le roman, une autofiction plutôt qu’une autobiographie. Il est né et a grandi à Squatec, village forestier du Bas-du-Fleuve qui ne sera électrifié qu’en 1950, grâce à un certain Maurice Duplessis dont il est longuement question, dans les pages colorées et pittoresques consacrées à la mentalité du lieu au cours de la période charnière de 1945 à 1957, année de l’entrée de Loïc au collège de Rimouski. Le lecteur y a droit, à un tableau macluhanien des effets de la télévision sur des enfants qui couraient encore dans les bois dont ils connaissaient bien la faune et la flore. Ce lieu, particulier s’il en fut, sera pour la jeune « truite » Loïc l’occasion d’un bond étonnant vers les hauteurs de l’universel. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il l’appelle Touladi. Touladi est l’autre nom de la truite grise, familière des grands lacs comme celui de Squatec.
Le récit s’inspire en bonne partie de la vie de l’auteur, Mario Pelletier, Loïc dans le roman, une autofiction plutôt qu’une autobiographie. Il est né et a grandi à Squatec, village forestier du Bas-du-Fleuve qui ne sera électrifié qu’en 1950, grâce à un certain Maurice Duplessis dont il est longuement question, dans les pages colorées et pittoresques consacrées à la mentalité du lieu au cours de la période charnière de 1945 à 1957, année de l’entrée de Loïc au collège de Rimouski. Le lecteur y a droit, à un tableau macluhanien des effets de la télévision sur des enfants qui couraient encore dans les bois dont ils connaissaient bien la faune et la flore. Ce lieu, particulier s’il en fut, sera pour la jeune « truite » Loïc l’occasion d’un bond étonnant vers les hauteurs de l’universel. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il l’appelle Touladi. Touladi est l’autre nom de la truite grise, familière des grands lacs comme celui de Squatec.
L’époque est celle de la révolution tranquille au Québec et de cette américanisation de la planète appelée mondialisation, deux séries d’événements mêlées l’une à l’autre dans le roman jusque dans leurs origines lointaines dans le temps et l’espace. Il n’est guère question de la révolution tranquille dans les 470 pages du livre, sauf indirectement par ses effets. (Il faut dire que l’auteur en avait déjà amplement parlé dans son essai autobiographique La traversée des illusions, paru en 1994.) S’il décrit très bien le changement de mentalité entre le Touladi de son enfance et les villes de Montréal, Ottawa et Québec où il vivra par la suite, il garde ses distances par rapport aux idées reçues concernant la rupture et les progrès dont elle aurait été le point de départ. Cette rupture, il l’a vécue en compagnie de son ami et mentor l’essayiste Jean Le Moyne, qui a inspiré en partie le personnage de Régis. Les nombreuses évocations de cette amitié justifient à elles seules la lecture du livre.
Pour ce qui est de l’américanisation du monde, qu’il suffise de rappeler que le livre commence par les images de l’effondrement symbolique de l’Amérique un certain 11 septembre 2001. Un homme d’affaires véreux de Québec se trouvait dans l’une des tours pour y vendre une pierre précieuse, un camée, dérobé à la famille du Fondateur de Touladi, Élie d’Anjou.
Dans cet arbre d’une vie et d’une époque intitulé La pierre de Satan, il faut bien distinguer trois choses : le tronc, les branches et les fruits.
Le tronc, la trame du livre est un conte policier fantastique, digne d’Edgar Allan Poe, gravitant autour d’un bijou, le camée, présumé d’origine aristocratique et objet pour cette raison de toutes les convoitises et de toutes les nostalgies. À son arrivée à Touladi, venant des États-Unis où il avait participé à la guerre de Sécession, le Fondateur portait ce trésor qu’il emporta dans sa tombe enfoui dans un scapulaire. Qui était-il ? Le légitime héritier du camée ? L’avait-il volé dans la maison d’un riche sudiste vaincu ? Ce Fondateur, la majuscule est importante, est à la fois celui de Touladi et celui du Québec, mais aussi celui de la France, des États-Unis, de l’Occident en un mot. Quant au camée, il est le symbole des forces mystérieuses liées à ce pseudo hasard qui préside aux rencontres entre humains. Ce conte policier, en attente d’un grand film est une épopée eschatologique qu’on associe spontanément à ces vers de Hugo dans Booz endormi :
Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,
Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée;
Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.
Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu;
Une race y montait comme une longue chaîne;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu
À cette différence près que, dans le roman de Mario Pelletier, c’est un diable qui meurt en haut. Le roman se termine en effet par une explosion dans un château du Bordelais, explosion causée par le malin camée, devenu justicier et survivant ainsi à celui qui n’avait reculé devant aucune magouille pour faire main basse sur lui.
Dans cet arbre de rêve, les branches ce sont les angles sous lesquels l’auteur observe la tragi-comédie humaine. Écrivain avant tout et toujours, il est en plus, tour à tour, historien, sociologue, psychologue, politologue, naturaliste, métaphysicien, à l’image d’une carrière aussi remplie d’imprévus que ses jeux dans le village forestier natal, chaque nouvelle occupation devenant une occasion de satisfaire une curiosité vitale et intellectuelle illimitée. Dans cette carrière qui ressemble à celle du Fondateur, son ancêtre, une constante : servir la langue française et s’en servir de mieux en mieux pour célébrer une création et une rédemption qui sont plus que des mots pour lui.
Pour savourer cette langue qui oscille allègrement entre le franc-parler des Touladiens et l’imparfait du subjonctif de grands aristocrates français devenus beaux-parents de Loïc, rien de mieux que de déguster un à un les fruits perchés sur l’arbre ; d’où cette anthologie que je vous invite à découvrir de branche en branche.
L’écrivain
Que savez-vous de l’amour ? C’est à la réponse d’un auteur à cette question qu’on peut le mieux apprécier la qualité de son style : est-il encore possible de dire des choses originales et vraies sur un sujet si usé ? Voici deux des amours évoqués dans le roman, le premier près de la terre, le second au sommet de l’arbre :
Près de la terre…
Il revoit encore les grandes fenêtres enténébrées qui les réfléchissaient tous les deux, verre à la main, le regard tourné momentanément vers les gratte-ciel illuminés du centre-ville. Il était loin de se douter que cette image préfigurait le couple miroir qu’ils allaient former, et que ce miroir – ce double miroir, en fait – où chacun aurait besoin de l’autre pour se donner une image avantageuse, allait essuyer bien des orages et, à la fin, des cassures qui les blesseraient profondément. Car leur commun besoin de reflet allait devenir de plus en plus exigeant, tyrannique.
Longtemps après, tentant encore de se l’expliquer, Loïc s’était dit qu’il avait été entraîné inconsciemment, par une sorte d’hypnose – ou hallucination spéculaire –, dans la gravitation d’un astre aussi magnifique que maléfique, dont le côté obscur n’était pas moins attirant que le lumineux. C’était cela, sans doute, cette ambiguïté troublante, qui avait suscité dès le départ un irrépressible et violent érotisme faisant sauter toute inhibition, soulevant des flambées d’instinct sauvage qui poussent à s’étreindre furieusement, à s’accoupler à bout de souffle, avec la sensation de plonger dans un fleuve fougueux, un fleuve aux eaux enveloppantes et tumultueuses où l’on cherche à s’anéantir, et cet anéantissement dans l’autre était la jouissance suprême, la coque des ego volant en éclats dans l’explosion d’un même orgasme. (p. 226)
Au sommet…
C’était l’un de ces soirs de juin où la lumière s’attarde longtemps dans le ciel avant de verser dans la nuit. (...) Et là, déjà, elle… juste devant, au milieu d’un petit groupe ; debout près du bar devant lequel on circulait ou s’attroupait ; échangeant un mot avec l’une ou l’autre. De cette brune svelte, assez grande, il ne vit d’abord que le regard, le ciel sans nuages d’un regard clair, sans ombre.
Il fut frappé tout de suite par une sorte de familiarité, comme s’il connaissait cette femme depuis longtemps, comme s’il l’avait toujours connue. Il était attiré vers elle par quelque chose de si naturel, de si évident : une évidence éblouissante, hypnotique. L’ovale parfait du visage, les traits fins, encadrés par une souple chevelure d’un marron foncé. Et surtout ses yeux : ses yeux lumineux, dès qu’ils s’étaient tournés vers lui, l’avaient ensoleillé d’un coup jusqu’au fond de l’être. (...)
Le fond de ce regard féminin – la féminité dans sa plus fine et profonde expression – était d’une telle beauté, d’une telle quintessence de beauté et de bonté, qu’il ne pouvait douter. Non, il ne pouvait en douter. Cette femme était apparue comme une pure bénédiction, pour le mener au meilleur achèvement de lui-même. Il le sentait, il le savait au fond, mais c’était aussi une telle transformation qu’elle lui faisait peur, comme lorsque déjà engourdi dans la mort on revient à grande douleur à la vie. Il y avait aussi une crainte vaguement superstitieuse d’un changement trop violent, trop radical, parce qu’il s’était attaché, avec quelque plaisir morose, à sa vieille défroque de vie qui ne lui ménageait plus de surprises, qui lui fermait insensiblement, une à une, depuis des années, toutes les fenêtres d’un devenir autre, pour mieux l’enfermer dans l’étouffement de soi, prélude d’une mort déjà rampante en lui, ou peut-être déjà accomplie, à son insu. (...)
Pour la première fois de sa vie, Loïc ne se sentit plus seul. L’expression âme sœur prenait un sens tel qu’il en fut troublé, se demandant si Laurence n’était pas la réincarnation de cette jumelle restée dans le ventre de sa mère. Car il était avec elle en vraie communion d’être et de pensée. Souvent, comme s’ils n’étaient plus qu’un, ils se surprenaient à penser même chose en même temps, jusqu’à avoir la même phrase, la même expression en tête. Tout leur était échange, partage, correspondance. L’éclat d’un sourire, l’éclair d’un regard étaient silex enflammant le cœur, mettant l’âme en incandescence de lumière. (pp. 310-314
Après l’amour l’amitié, dans ces extraits sur le lien entre Loïc et Régis :
Leur amitié n’était sans doute pas comparable à celle qui liait Montaigne et La Boétie, mais une même servitude acceptée les avait réunis et avait fini par créer entre eux un attachement indéfectible, comme celui qui soude ceux qui ont vécu ensemble le goulag. Oui, c’était bien de cet ordre : ils avaient connu le même camp de concentration de l’esprit, même si leurs raisons de le souffrir étaient aux antipodes. (p. 139)
[…]
Remonté dans sa voiture après être sorti de chez Régis, Loïc se tourna vers son grand-cousin resté sur le seuil de la porte pour le saluer. Il le vit lui adresser un dernier salut de sa main tremblante, déformée par l’arthrite. L’émotion étreignit Loïc en l’apercevant ainsi, l’air digne, presque solennel, comme en cérémonial d’adieu. Il gardait en tête ce que l’ancien dominicain venait de lui dire : Je prie avec mes poissons. En descendant la rue, il le regarda encore dans le rétroviseur. Régis pressentait-il que c’était la dernière fois qu’ils se voyaient ? Loïc pensa un moment à cette éventualité. Un être de cette trempe, allait-il jamais en rencontrer un autre ? (p. 266)
L’historien
S’il fait une large place à l’histoire événementielle, c’est dans l’histoire des mentalités qu’il est le plus à l’aise. Sous son regard, le village de Touladi ressemble à ceux de Philippe Ariès et de Le Roy Ladurie :
Au tournant des années cinquante, le petit Loïc avait été fasciné en apercevant cette grande perche de femme dans sa robe noire, fermée au cou, usée et rapiécée par endroits, la même qu'on lui voyait sur le dos à longueur d'année quand elle se rendait au village. Sa longue taille un peu voûtée (à l’instar des D’Anjou) soulignait encore davantage la sévérité puritaine, ou plutôt victorienne, du vêtement. Mais ici, de même que l'habit ne fait pas le moine, la robe ne faisait pas la nonne, car elle contrastait avec la verdeur et la gaillardise des propos de la vieille. Sa verve rabelaisienne s'accordait davantage avec son surnom. Nonne d'habit, mais paillarde de cœur. (...)
Sa réputation de sorcière s'était répandue et amplifiée avec les années. Elle disait la bonne aventure par les cartes, les feuilles de thé et d'autres moyens de son invention. Elle connaissait les secrets des herbes et des plantes, la vieille sorcellerie française et les sortilèges amérindiens. On lui attribuait des pouvoirs maléfiques. On avait répété qu’un jour elle avait délivré Baptiste Boileau d'un mauvais sort qu'un quêteux lui aurait jeté, en brûlant le cœur d’une poule noire dont elle avait tordu le cou à la brunante.
Certaines femmes de Touladi n'hésitaient pas à se servir d'elle comme d’un épouvantail : une sorte de bonne femme sept-heures pour apeurer leurs enfants et les rendre plus dociles. D’autres la consultaient en secret pour des affaires personnelles, de sorte qu'elle avait fini par connaître les tréfonds des consciences du village au moins autant que le curé, sinon davantage. (pp. 202-203)
En fort contraste avec ceux du village traditionnel, voici un tableau des mœurs d’une grande ville en voie de modernisation, Québec :
Dernière née des enfants et restée plus longtemps que les autres sous le toit familial, Isabelle avait été particulièrement choyée par sa mère qui avait reporté sur elle ses besoins frustrés d’affection. Plutôt repliée sur elle-même, elle s’était souvent sentie peu de chose entre ses trois grands frères et sa sœur Juliette qui avaient tous des personnalités très affirmées.
D’ailleurs, elle ne ressemblait pas aux autres. Dans les salons cossus de la Haute Ville, la rumeur avait couru qu’elle était le fruit d’un adultère. On n’ignorait pas qu’à une certaine époque Lucille avait eu la cuisse légère et avait noué des idylles dans le fameux train « Le Rapido », entre Québec et Montréal, où l’on en voyait de toutes les couleurs dans les années cinquante, quand la bourgeoisie de Québec s’épivardait le temps d’un week-end. Lucille s’était acoquinée alors avec sa belle-sœur Victoria devenue une riche veuve qui se payait des amants à foison. Elle s’était aussi rapprochée d’une autre sœur de Georges, Georgia – que tout le monde appelait Georgie –, l’artiste émancipée et sulfureuse de la famille, qui menait une vie de bohème à Montréal, entre l’École des beaux-arts et les bistrots beatniks de la rue Sainte-Catherine, à l’ouest de la ville. C’était pour Lucille, à l’époque, une bouffée d’oxygène essentielle pour échapper à l’étouffement de sa vie bourgeoise, entre maternité répétitive et représentation vertueuse, et aussi pour panser une vieille blessure en elle qui n’avait jamais guéri. (p. 76)
Le sociologue
On découvre le sociologue notamment dans sa description et son analyse de l’irruption de la télévision à Touladi : une refondation du village sur de nouvelles bases américaines :
L’héritier du Fondateur avait voulu être le premier à posséder la « boîte » magique, le petit écran qui permettait de voir loin. Et tous les Touladiens, hommes, femmes et enfants réunis là, ce 21 novembre 1954, restèrent longtemps à fixer la tête d'Indien affiché à l'écran, beau symbole de la longue suite de siècles sans mémoire ni représentation vécus par les premiers habitants du pays. Puis des oh! et des ah! fusèrent, jaillirent de toutes les bouches quand commença à s’animer l’œil lumineux, étincelant, rempli d’éclairs, qui leur livraient tout à coup des images mouvantes de Montréal et d’ailleurs : des visages, des voix, des gestes, des scènes de vies transportés instantanément sur des centaines, des milliers de kilomètres, par delà les montagnes, les fleuves et les forêts, comme si la grande ville débarquait de but en blanc dans leur patelin au fond de l'arrière-pays du Bas-Saint-Laurent ! (...)
De fait, en cet automne 1954, les Touladiens se trouvaient pleinement introduits, précipités dans le « village global » ; cernés pour le meilleur ou le pire par la cavalerie éclair des ondes électromagnétiques qui allait les happer, les emporter sans retour, surtout leurs enfants, et de plus en plus en accéléré à partir des années soixante. (...)
Et ainsi, au fil de cette décennie, le prêche du curé tomba dans des oreilles de plus en plus distraites, attirées et séduites par les enseignements « démocratiques » de la télévision, nouvelle chaire des temps modernes. L’œil clignotant de la grande déesse Télé supplantait l’œil de Dieu, ravalé au rang des croyances archaïques, indignes du progrès moderne. (pp. 191-192)
L’anthropologue
C’est dans les pages sur Cuba consacrées au vaudou que Mario Pelletier se révèle anthropologue.
À leur arrivée dans la ruelle où une foule était déjà rassemblée, résonnaient haut et fort les batas, ces grands tambours en forme de sabliers qu’on tenait pour sacrés parce qu’on leur attribuait le pouvoir de communiquer avec les divinités. Sur une scène improvisée au milieu du pavé autour de laquelle l’assistance faisait cercle, une jeune femme se déhanchait et trémoussait pour épouser le rythme des tambours. Elle était vêtue d’une robe bleue à jupe large qu’elle soulevait, battait, rabattait et faisait tourner et onduler comme les vagues de la mer. (…) Des chants accompagnaient la danse, dans une atmosphère à la fois recueillie et joviale. Yemaya continuait de tournoyer d’un bout à l’autre de la scène, faisant voler autour d’elle les vagues bleues et blanches de ses jupes et, parfois, elle s’inclinait comme si elle faisait la révérence, ou bien, les mains sur les hanches, elle battait des bras comme pour s’envoler. (...)
D’autres orishas entrèrent en scène. Oya, l’air, le vent, en robe à falbalas multicolores à dominantes jaunes et bleues ; Chango, le feu, la foudre, la guerre, en grande tunique rouge et or falbalassée, exécutant une danse énergique, avec des gestes tranchants, foudroyants comme le tonnerre et le feu de la guerre ; Osun ou Oshun, la terre, la sexualité féminine, la fertilité, en robe jaune à jupon blanc, hilare, remplie d’allégresse comme le sex-appeal, la jouissance sexuelle, mais elle était aussi assimilée à la Vierge chrétienne : la Virgen de la Caridad del Cobre, la patronne de Cuba, dont la statue se trouvait placée en évidence dans la cathédrale de Cardenas. (…) Il y avait dans ce spectacle de rue beaucoup de bonne humeur et de spontanéité bon enfant. Beaucoup de couleur, de rythme, de mouvement sous les percussions des tambours. Quelque chose de théâtral, d’hiératique, en même temps que de très énergisant ; quelque chose qui, malgré son côté rituel, s’offrait à tous, à tout venant, parce que le sens en était universel. (pp. 333-335)
Le psychologue
De toutes les science humaines c‘est avec la psychologie que Mario Pelletier a le plus d’affinités. On le voit dans l’impact sur Loïc de la querelle entre son père biologique et son père adoptif, querelle rare de village traditionnel, mais préfigurant bien les nombreux traumatismes du même genre dans le contexte actuel. Vu sous cet angle, La pierre de satan est le roman de l’effondrement du père, du Fondateur :
Loïc gardait le s yeux baissés pour ne plus voir les regards aux fenêtres qui étaient la réverbération de sa honte, de sa tragédie.
Et les cris de haine continuaient d’entrer en lui comme des couteaux. Qui pouvait savoir alors, qui pouvait deviner à quelle profondeur cette querelle le déchirait ? Et quel cratère elle creusait dans sa vie ? Mais de tous les esprits aux aguets, ce soir-là, et dont les os, pour la plupart, sont réduits en cendres ou pourrissent quelque part, qui donc, au siècle suivant, pourrait s'en souvenir ? Oui, qui donc pourrait se rappeler ces temps révolus, ce village oublié, rayé des cartes de la mémoire, sinon lui ?
Loïc n’allait surtout jamais oublier le ciel de ce soir d’octobre 1951. En levant les yeux, il avait été saisi à la vue des nuages empourprés qui découpaient des palais somptueux dans les profondeurs du couchant. Saisi et apaisé momentanément. Comme s’il y avait en haut une exacerbation de splendeur pour couvrir la fureur exacerbée au milieu de laquelle il se trouvait pris, en bas. Il n’aurait pu dire alors, trouver les mots pour exprimer ce qu’il ressentait, qui aurait été, à peu près : comment se fait-il, sous tant de beauté, tant de malheur ?
Le petit Loïc avait été ramené vite à la querelle. Une dernière insulte, vociférée de loin par Alcide, piqua au vif Guillaume : une allusion à la débauche des D'Anjou et à leur bâtardise depuis le Fondateur. Guillaume se retourna sec, comme fouetté par une cravache, et lança une réplique, enfin quelques mots seulement, car le reste s'étouffa dans sa gorge. Le souffle même semblait avoir du mal à passer la barrière des dents. Il porta la main à sa poitrine et, d’un pas chancelant, se dirigea le plus vite qu’il put vers la porte de sa maison...
Autour du canapé où Guillaume râlait entre la vie et la mort, tout le monde s'arrêta soudain pour réciter le chapelet avec l'archevêque de Rimouski, à la radio. Dans ce salon en prière, Loïc comprit, pour la première fois, que les choses n'étaient pas immuables, que tout pouvait changer d’un moment à l’autre. Guillaume ne récitait pas le chapelet avec eux, ce soir-là. Et peut-être, un jour, ces cadres, ces murs et ces gens ne l'entoureraient plus. Il ne serait pas toujours là avec les mêmes êtres autour des mêmes objets, dans les mêmes lieux. Et il eut peur soudain de tous les changements qui l'attendaient.
Guillaume resta de longues heures entre la vie et la mort. À défaut du médecin qui était allé aux malades dans une localité voisine, le curé, Clovis, les femmes de la maison et les cousines faisaient de leur mieux pour garder le malade en vie.
Loïc n’osait regarder le visage livide de son père adoptif, étendu inconscient sur le canapé du salon, entouré d'une foule de gens affairés à le soigner, à le tirer des griffes de la mort. Il fixait sur le mur, au-dessus du canapé, l'image du Sacré-Cœur transpercé, perdant son sang goutte à goutte, et il songeait à Guillaume, lui aussi atteint en plein cœur et à cause de lui, sans doute.
On entendit tout à coup un vrombissement du côté du lac. Tout le monde pensa à l'avion d'Alcide. De fait, on apprit bientôt qu'il avait profité du clair de lune pour s'envoler : on ne savait trop pour quelle destination. En tout cas, il avait décampé, et Dieu sait quand on le reverrait.
Sur ces entrefaites, le médecin était enfin arrivé. Un jeune homme manifestement débordé, qui, de prime abord, vit qu'il fallait transporter Guillaume au plus vite à l'hôpital le plus proche, à Notre-Dame-du-Lac.
Ainsi, Loïc s’était-il retrouvé sans père. L'un parti à l'hôpital, peut-être pour la mort. L'autre parti dans un vol de nuit qui n'aurait peut-être pas de fin. Un père effondré, l'autre envolé. Et lui, tout petit, sans père, ni repère. (pp. 122-128)
Autre portrait clinique saisissant, celui d’une cousine de Loïc atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle est la femme d’un honorable juge de Québec à la conscience meurtrie par le désir d’aider sa femme à mourir :
Georges se torturait l’esprit et le cœur avec ces dilemmes. Pendant des jours et des semaines, en cet automne 2010 où la condition de Lucille était devenue des plus pitoyables, il ruminait cette sortie accélérée du monde pour sa femme désespérément démente. Il en était devenu assombri, taciturne, retranché dans un mutisme inquiétant pour son entourage.
Entre-temps, la conscience de Lucille devenait un labyrinthe obscur, de plus en plus touffu, où ses pensées, ses perceptions, ses appréhensions s’emmêlaient dans un fouillis inquiétant, dont elle arrivait de moins en moins à faire la part du réel et de l’irréel, du vécu et du rêvé. Tout devenait errance problématique dans un temps incertain, à mesure qu’elle perdait pied dans le réel et qu’elle se dé-mémorisait, se désâmait, n’ayant plus que parole réflexe perdant son sens. Le dérapage de l’esprit s’accélérait vers un puits sans fond.
Et, dans ce tunnel rétrécissant – entre une angoisse folle, une peur animale qui l’étreignait à mourir, et des sursauts de révolte, de colère se retournant en pulsions d’autodestruction –, elle tentait de se raccrocher désespérément à quelque espoir, quelque lumière : un regard de douceur, de compassion, une lueur d’amour, pour échapper, ne serait-ce qu’un moment, à la noirceur d’enfer qui la dévorait à vif chaque jour.
Oui, elle aurait tant voulu se baigner l’âme dans une lumière d’amour sans failles, mais ce qu’elle voyait autour d’elle ne lui semblait plus que regards sourcilleux, désemparés, ennuyés, douloureux, condescendants ou fuyants ; que des faux sourires, des mines ébahies, dépitées ou apitoyées. Et, dans ses crises paranos, elle finissait par les haïr tous, par dire pis que pendre des uns et des autres : son mari et ses enfants qui n’avaient aucun égard pour elle, l’épouse, la mère ; qui la traitaient pire qu’une chienne. Elle les accablait tous de la vindicte toujours plus agressive, injuste, ignoble que sa démence lui inspirait et dont ses plus proches, Georges et Isabelle, faisaient davantage les frais.
Le pis est que les accusations et reproches de Lucille finissaient par créer de la discorde chez les D’Anjou, entre le père et les enfants, entre les enfants et les petits-enfants.
De saison en saison, de mois en mois, Lucille poursuivait ainsi sa descente au fond de l’abîme de soi ; au bout de la défiguration, d’un défigurement de soi jusqu’au méconnaissable, tragique métamorphose qui, à l’inverse du papillon, la faisait régresser au repli sur soi d’un cocon primitif, sorte d’état larvaire avant l’œuf pétrifié de la mort.
Ainsi, dans la nuit tombante du sens, elle n’allait plus nulle part qu’en elle-même, perdue en son for intérieur brouillé, farfouillant des lambeaux de souvenirs qui s’effilochaient, bafouillant des phrases sans raison, triste errante hors d’elle, évacuée de sa mémoire condamnée, le sens des choses lui échappant comme un ballon qui se dégonfle ; et les mots mêmes qu’elle n’arrivait plus à saisir, qui échappaient à son esprit comme des anguilles, et la réalité se démaillait à mesure autour d’elle.
Georges observait ce dépérissement, avec un sentiment de détresse, d’impuissance désespérée. Il surprenait encore, çà et là, dans le regard de son épouse, une lueur d’intelligence, étouffée aussitôt sous l’éteignoir d’une hébétude qui la laissait bouche bée comme à tombeau ouvert. (pp. 415-417)
Le politologue
Les méandres de la carrière de Loïc l’ont propulsé à des premières loges d’où il a pu observer de près deux premiers ministres ennemis à des moments cruciaux de leur vie : Pierre Elliot Trudeau à Ottawa au moment de la victoire du parti québécois en novembre 1976, René Lévesque à Québec en 1985, au moment de sa démission comme premier ministre et chef du parti qu’il avait fondé. Autre Fondateur trahi ? Mario Pelletier : polititologue ou mémorialiste à la manière du duc de Saint-Simon qu’il admirait et auquel le poète Gaston Miron l’avait déjà comparé? Pour en juger :
En 1976 à Ottawa…
Dans l’antre du chef du gouvernement, la tension avait monté de plusieurs crans. Tout le personnel était sur les dents à mesure que l'avance du parti indépendantiste se confirmait et que l'impensable se réalisait. On fixait des regards sidérés sur le téléviseur, on grommelait, on rageait, dédaignant le buffet et les bouteilles d’alcool et de vin débouchées sur une table d’appoint, dans le bureau du secrétaire de presse. (...) On circulait de façon erratique dans les escaliers, les couloirs ; on tenait des conciliabules ici et là, pendant que le premier ministre s’entretenait à huis clos avec sa garde rapprochée. On s'était déjà entendu sur la déclaration de circonstance : la froide reconnaissance de la légitimité du gouvernement sécessionniste. Quelques secrétaires dactylo avaient l’air épouvantées. Dans leurs regards, sur tout leur visage se lisait une détresse de fin du monde. On finissait par apprendre qu’elles appartenaient, les unes et les autres, à des familles déchirées par la grande querelle Québec-Ottawa ; et que même les conseillers les plus proches du premier ministre avaient des frères, des sœurs, des beaux-frères engagés du côté séparatiste.
Régis et Loïc ne faisaient pas exception à ces dissensions intestines. Mais, pour eux, le différend prenait une dimension personnelle d’autant plus déchirante qu’il était tu, tenu en sourdine, muselé. Régis, ce soir-là, n’avait pu tenir longtemps au Langevin. Après avoir tenté de noyer son anxiété et son indignation dans le scotch, et surtout après que Radio-Canada eût annoncé que le PQ serait élu avec une majorité de sièges, il était monté s’entretenir brièvement avec Trudeau puis avait filé à l’anglaise. (...)
Le désarroi était tel à Ottawa qu'on ne savait plus quelle contenance prendre, sur quel pied retomber. Pierre Elliott Trudeau lui-même en perdait la maîtrise de soi. À un moment donné, un lapsus lui échappa devant les journalistes. Il dit qu'il continuerait de prêcher le séparatisme au Québec... euh, comme une erreur !, s'empressa-t-il d'ajouter. On en fit des gorges chaudes dans le camp adverse. Peut-être était-il retombé momentanément dans les bottes de l’étudiant de Brébeuf qui projetait une république du Québec indépendante... et en 1976, justement ! Les fantômes des moi anciens grouillent toujours dans les coulisses. (pp. 133-135)
En 1985 à Québec…
Au conseil des ministres ou au caucus des députés, Lévesque se faisait de plus en plus rageur. Il commentait, avec un mélange d'incrédulité et d'indignation ponctuées de sacres, les sondages de plus en plus défavorables aux souverainistes. Il donnait l'impression d'un vieux lion renfrogné qui ne gouvernait plus que par la grogne et des rugissements intempestifs. Il est vrai que le père du pays non encore né paraissait de plus en plus tendu et fatigué. Au delà des cafouillages et des bilans de santé alarmants, on colportait toutes sortes de bruits sur son compte : certains disaient qu'il levait un peu trop le coude, d'autres qu'il se claquemurait dans ses quartiers. (...)
Exaspéré par tous ces bruits et fuites plus ou moins calculés, Lévesque, un soir de mai, sortit de ses gonds devant les députés et les ministres. Sans nommer personne, il se mit à engueuler comme du poisson pourri tous ceux et celles, fretin ou requin, qui s'abouchaient et frayaient avec les journalistes, pour répandre les rumeurs les plus démoralisantes. Qu'on cesse de jaspiner et de mémérer dans les coulisses, tonnait-il ! Les ministres et députés autour de la longue table de chêne avaient la mine basse. Et dans les moments de silence, entre deux mots rageurs, passaient des anges exterminateurs.
L'atmosphère était dramatique. On devinait les poignards rentrés, le remords filial mêlé de faux repentir et de calcul politique sur bien des fronts assombris. Tout le monde se sentait sur la sellette, et personne n'osait se regarder pendant ces longues minutes où le chef souverainiste fustigeait tous ces Judas qui, pour quelques picas de citation dans les journaux, livraient à tort et à travers ce qui se disait dans les caucus. Il partirait sûrement un jour, leur dit-il, mais il ne se laisserait pas pousser dehors. Il eut des mots amers sur ce parti qu'il avait fondé et qui se retournait maintenant contre lui, pour devenir l'instrument de sa condamnation et de sa mise à mort. Comme s'il avait lancé, dix-sept ans auparavant, un boomerang qui lui revenait en pleine face.
Ce jour-là, Lévesque avait l’air pitoyable d’un père mythique qui se débat pour empêcher son inéluctable meurtre rituel. Loïc était profondément attristé d’assister à l’agonie politique de ce brillant champion du Québec. Réfléchissant à tout ce qui avait monté en graine et dégringolé depuis neuf ans, il constatait à quel point une personnalité magnétique peut rallier et catalyser la volonté collective. Et quand cette personnalité sombre, tout sombre avec elle. (pp. 247-249)
Le naturaliste
Même si l’ombre longue et triste du Fondateur plane sur l’ensemble du livre, on y découvre maintes clairières, dont une dévoilant la vie dans l’intimité de la forêt de Squatec et une autre célébrant le printemps du dernier amour de Loïc, un printemps qui rappelle celui de Lucrèce. Deux témoignages d’une «foi de charbonnier métaphysique».
Cette brève excursion était restée gravée en lui comme un grand moment, une grande leçon de choses et d’être. Il avait vu comme jamais auparavant – sans doute parce qu’il avait atteint l’âge de le voir –, il avait pu constater toute la profondeur et l’étendue de la connaissance de la nature qu’avait son père adoptif, une connaissance issue d’une longue expérience et devenue instinctive. Oui, il avait l’instinct de la forêt comme un Amérindien. Il suivait d’un pas sûr chaque sentier, chaque piste, le moindre passage ou trouée entre les arbres. Une branche cassée, une écorce déchirée, des brindilles écartées, écrasées sur un talus : tout lui était indice, signe, tout lui parlait, tout lui était écriture dans un grand livre qu’il connaissait par cœur et où il s’avançait avec la précision d’un érudit et la délicatesse d’un esthète. Il flairait le passage d’un animal avant d’en avoir vu la trace ; il connaissait chaque arbre comme un frère, en savait l’âge et l’état, voire l’humeur, par l’inclinaison du tronc, la force des racines, l’envol des branches, le fourni et l’éclat de la feuillée ; il voyait comment chacun avait composé avec les saisons, affronté les vents et les intempéries, traversé les neiges et les glaces, et s’était gorgé de lumière et de soleil. Oui, on sentait bien à le voir cheminer ainsi, tout yeux, tout oreilles à travers les bois, qu’il les connaissait tous intimement, ces arbres, comme des enfants, des frères, les membres d’une vaste famille auquel il appartenait tout naturellement. Loïc s’était émerveillé de le voir tout à coup flairer une présence animale, avancer à pas de sioux, tout doucement pour ne rien perturber, comme s’il se fondait dans le décor, dans le corps immense et puissant, le vaste chœur et orchestre de la forêt dont il savait percevoir les moindres inflexions, bruissements, palpitations, sifflements, chuchotis de feuilles et de branches caressées, soulevées ou fouettées par le vent ; tout ce qui soufflait, palpitait, vivait sous les grandes ramées, sous les arbustes, dans les fourrés. Loïc avait constaté à quel point le terme forestier seyait bien à Guillaume, sans doute mieux qu’à quiconque, et à quel degré de noblesse il le rehaussait. Ce n’était pas pour rien, il le comprenait maintenant, que tous ces patrons et employés de la compagnie forestière étaient venus lui rendre hommage. Ils avaient reconnu depuis longtemps en lui le véritable homme des bois, l’authentique fils de la forêt, celui qu’ils savaient lié d’instinct à ce riche univers de lacs et de forêts qui entourait Touladi. En digne petit-fils du Fondateur. Ils savaient avec quelle science sûre Guillaume D’Anjou les avait guidés chaque fois qu’ils s’étaient enfoncés avec lui au fond des bois. Ils avaient vu avec quel sens aiguisé, quel flair il pouvait repérer le meilleur gibier, et avec quelle adresse il savait, du premier coup, abattre l’animal net et sec, sans le faire souffrir. (pp. 212-214)
Le printemps...
La tête encore bruissante de réflexions, il avançait distraitement, en somnambule, dans le sous-bois. Mais il fut vite arraché à ses pensées par l’explosion du printemps autour de lui. L'air charriait des odeurs enivrantes d'essences de bois, on sentait partout un immense bouillonnement de sèves en ébullition, de bourgeons qui gonflaient, de marécages qui fermentaient. Une Babel d'oiseaux répandue dans le soir piaillait et jacassait à tue-tête. Il était vingt heures, il faisait encore clair bien que l'obscurité commençât à s'insinuer entre les arbres. Des flaques dans le chemin reflétaient les sapins avec des morceaux de ciel. La lumière jouait à dédoubler les choses, à les transfigurer, comme la mémoire notre passé. Ah, merveille d'être ! Cette exclamation monta en lui, ovation spontanée de l’âme saisie d’enthousiasme. Oui, quelle merveille, quelle beauté suspendue dans l'air ! Un vent léger remuait imperceptiblement les branches d'un pin en face de lui. Au ciel, une masse de nuages sombres emportés vers l'occident venait recouvrir peu à peu la clarté du ciel, comme une paupière glissant sur un œil. L'heure était à la conspiration. Puitt ! Puitt ! Puitt ! Les oiseaux s’appelaient d'arbre en arbre. Tout près, un somptueux cardinal flûtait sa strophe avec une vigueur toute printanière ! Appel à côcher, appel au nid, sex appeal. Le printemps est un vaste concours de reproduction, songeait Loïc. Un afflux intense de sang, d’hormone, d'énergie passant d'un être à un autre : échange, mutation, prolifération ; tension, flux, jaillissement. La poussée prodigieuse de la vie. Ainsi se refait le monde, perpétuellement.
Les nuages assombris glissaient en rideau sur le fond du ciel, fermant le théâtre du jour, préparant les alcôves de la nuit. Tout conspirait, tout portait à s'abandonner à la pure effervescence de ce printemps qui travaillait les choses en profondeur : sous les restes de neige dans les talus, au fond des marais, des ruisseaux et des lacs, à l'intérieur des plantes et des arbres. Les millions de bourgeons poussant vers l'éclosion faisaient éclater peu à peu leurs gaines ; milliards d'infimes éclatements de fibres végétales, frémissements sanguins dans les troncs, sèves qui montent, branches tendues, gorgées, prêtes à déployer des triomphes de verdure. Toute cette nature desséchée, momifiée, recroquevillée pendant des mois en des cercueils de glace, voilà maintenant qu'elle se dépliait, qu'elle rompait ses sangles et ses enveloppes, en une infinitude de petites reviviscences aboutissant à la grande résurrection unanime du printemps.
Des peuples multiformes d'oiseaux et d'insectes s'échangeaient des messages sur d’innombrables réseaux invisibles, les wifi antiques et sûrs de l'instinct. On devinait une clameur universelle dans ce soir approfondi par des échos répétés, répercutés. Les chiens aboyaient sans raison, par pure folie, fantaisie, excitation du grand renouveau. Ils sautaient et tournaient, étourdis par tant d’odeurs affolantes, celles du grand rut de la nature et de tout ce qui ressortait du fond des neiges : bois, cuirs, plumes, écorces, peaux, sèves végétales et animales, essences résineuses, baumes suintant des sapins et des épinettes. Ivresse générale, fête de tous les sens, tout criait alléluia, car n’était-ce pas la remontée du royaume des morts, la victoire du Christ universel, dont l’Église fêtait la résurrection une semaine auparavant ? Et cette résurrection, se disait Loïc, ne cessait de se prolonger partout, d'irradier dans toutes les directions de la matière et de l'esprit. Comme ce qui nous est promis au bout du temps. (p. 292-294)
Le métaphysicien
Ami et héritier spirituel de Jean Le Moyne (représenté par le personnage Régis D’Anjou dans le roman), Mario Pelletier l’aura suivi jusque dans son puits de lumière auprès d’un Dieu transcendant devenu le prochain de toutes les créatures par son Incarnation. Dans certaines églises romanes, la clé de voûte est aussi un puits de lumière. La lumière tient ainsi l’édifice qu’elle éclaire : atmosphère éblouissante et nourricière de la Vérité, par-delà les mots qui ne peuvent la dire qu’en la trahissant. En fermant le livre de Mario Pelletier, j’ai le sentiment d’avoir participé à cette atmosphère.
Il [Loïc] gardait une foi de charbonnier métaphysique au fond de lui, une intuition indéfinissable qui, comme une intelligence nyctalope au-delà des lumières crues de la raison, poussait des antennes dans l’envers obscur des choses. Aussi croyait-il que tout ce qui a été reste quelque part, dans un entre-deux du réel et de l’idéel, dans des coulisses subtiles qui glissent infiniment sur elles-mêmes en d’insondables dimensions, en superpositions illimitées, espaces dédoublés, démultipliés à l’infini. Et le diable s’y glisse aussi comme un visiteur intempestif, un dévoyé métaphysique qui cherche à tout simuler pour mieux tromper. (p. 144) […]
Loïc était saisi d’une grande compassion pour son cousin. Il lui apparaissait, en son vieil âge, comme un malheureux avançant dans une nuit de plus en plus obscure, dans un tunnel qui se rétrécissait en s’assombrissant. Et, malgré tout, il demeurait un pèlerin obstiné dans la nuit de la foi, un fou de Dieu qui persistait à croire, qui persévérait envers et contre tout, s’accrochant désespérément à sa foi parce que c’était, pour lui, le seul salut possible. Le Christ est notre seul espoir, ne cessait-il de répéter. Il se voyait comme Job sur son tas de fumier, et il battait sa coulpe en s’accablant de tous les péchés du monde.
— Le Christ a été et demeure pour moi l’unique chance, le seul salut possible. Maxime le Confesseur disait que l’incarnation de Dieu est la Nouveauté absolue, et je m’y tiens de toutes mes forces.
Oui, constatait tristement Loïc à part soi, il s’accroche à sa Foi comme au grand mât d’un bateau démantelé, poussé furieusement sur les récifs de l’âge. Mais il lui dit :
— Grâce à Dieu, vous avez cette foi qui vous sauve du désespoir.
— Oh, voyez-vous, cette foi est une nuit opaque. Ce serait le grand silence aussi, s’il n’y avait ce tintamarre dans mes oreilles.
Il parlait de ses acouphènes, qu’il appelait, dans ses meilleurs jours, sa lyre cosmique. Il avait ponctué cette phrase d’un rictus, comme un grincement de dents. Puis il se mit à épiloguer sur la misère de notre condition et le silence du Très-Haut, la nuit de la foi, la nature inconnaissable de Dieu qui est au-delà de toute nature, au-delà du connaissable et de l'inconnaissable, bien au-delà des catégories d'être et de non-être, précédant et contenant tout infiniment.
— Oui, le Christ est notre seule chance, réaffirmait-il comme un leitmotiv pour ancrer la conviction.
Puis il évoqua la 10e Sephiroth huive, le se« retrait créateur » de Dieu, qui avait été à l'origine du monde. Selon cette ancienne conception cosmologique, pour faire place au monde matériel et humain, Dieu aurait créé un vide en Lui par une sorte de retrait. Ce qui fit penser à Loïc qu'en créant le monde Dieu avait aussi créé le vide. D’où la peur et l'attirance du vide, la peur essentielle du non-être, chez ses créatures humaines.
[…]
Derrière Régis, Loïc voyait dans l’aquarium les poissons tropicaux battre des flagelles, poursuivre, de courts virages en contre-virages vifs, nerveux, leur bref destin aquatique ; et dehors les oiseaux, moineaux, merles et mainates, voleter d’un perchoir à l’autre. Que pesaient toutes ces vies dans la pensée de Dieu, dans le retrait créateur divin ? (pp. 264-265)
Écrire
Quel écrivain aura résisté à la joie d’écrire sur son propre métier ?
Écrire était aussi un exercice souvent frustrant. Derrière la pensée consciente et son expression, Loïc sentait une rumeur sourde, persistante, un bruit de fond comme le double fantôme d’un sens qui arrivait mal à l’expression, qui parvenait peu ou prou à se projeter dans des mots, à s’habiller de phrases. Ainsi, l’idée ou l’impression exprimée lui semblait toujours en deuil, veuve de son double qui signifiait plus et mieux. Et la nostalgie en restait qu’il tentait de réverbérer en poésie. Ou bien il cherchait à la rattraper par une réflexion patiente, tenace. Comme le chasseur à l’affût. Ses mots, ses phrases couraient mentalement après cette ombre vexante qu’ils s’efforçaient de piéger, de saisir, de s’approprier enfin : l’expression idéale venue une fraction de seconde illuminer le cerveau, l’éclair de perfection sous lequel plus rien n’apparaissait inconnu ni indicible, comme si tout subitement s’était révélé, éclairci, transfiguré dans le vrai absolu qui est pure beauté, aux résonances illimitées. (p. 428)
Site de l’auteur
https://mariopelletier.site/






