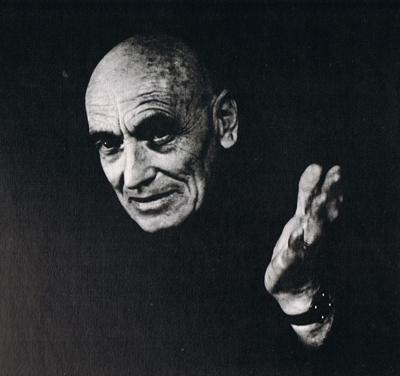Histoire de la médecine - chapitre 2 Vers la raison
Survol des grandes étapes de l'histoire de la médecine et de l'évolution des rapports et de l'homme avec la santé et la maladie. Ébauche d'une médecine scientifique, aux Ve et IVe siècle av. J.-C, en Grèce
«Ici l'esprit fit un bond» Hegel
Lorsque nous sommes malades, nous avons souvent le sentiment diffus d'expier une inconduite ou d'être l'objet d'un mauvais sort, d'une vengeance: de la société, de la nature ou de Dieu. Chez certaines personnes, ce sentiment de culpabilité ou de persécution prend une forme aiguë, nouvelle souffrance qui s'ajoute à celle dont on est déjà atteint.
Dans les sociétés archaïques, une telle affliction allait de soi. À Babylone par exemple, où la médecine et la religion ne faisaient qu'un, le mal physique était en effet indissociable du mal moral, la maladie apparaissait comme un châtiment pour les péchés commis ou comme une vengeance inexplicable des dieux.
C'est dans la Grèce classique que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la maladie a été dissociée du mal moral, la souffrance de la vengeance des dieux. On lui attribue enfin des causes naturelles.
En Grèce même, les malheureuses victimes de la maladie sacrée, l'épilepsie, étaient souvent réduites aux supplications du Juste souffrant. Or, voici la position d'Hippocrate sur l'épilepsie: «Certaines personnes croient qu'il s'agit d'une intervention divine. C'est faux. Il s'agit d'une maladie naturelle dont on ne comprend pas encore la cause».
Pour expliquer une fièvre désormais, plutôt que de prescrire un examen de conscience, on fera d'abord porter la recherche sur le climat, l'alimentation ou les autres facteurs soupçonnés d'altérer l'équilibre des humeurs dans l'organisme. Les Grecs auraient pu pousser cette façon de voir tellement loin que plus personne parmi eux n'aurait vu de liens entre la conduite et la maladie. Ce qui aurait eu pour conséquence de faire disparaître le sentiment de responsabilité face à la santé. La chose ne s'est pas produite. Les Grecs se défiaient des excès de ce genre. Hippocrate lui-même donne l'exemple de la mesure dans de nombreux textes où le malade apparaît comme l'agent principal de sa propre guérison.
De nos jours, en mettant l'accent sur l'alimentation et l'exercice, sur l'art de vivre en général, on incite les gens à assumer la responsabilité de leur santé. Cette forme de prévention est dans la plus pure tradition hippocratique. Qu'on en juge: «Aliments et exercices ont des vertus opposées, mais qui collaborent à la santé. Par nature, les exercices dépensent l'énergie disponible, les aliments et les boissons, eux compensent les pertes. Il importe, à ce qu'il semble, de discerner la vertu des exercices naturels ou violents; il importe à ce qu'il semble de discerner lesquels d'entre eux développent les chairs, lesquels les diminuent et non seulement cela, mais encore la proportion des exercices à l'égard de la quantité d'aliments, de la nature du patient, de son âge, des saisons de l'année, des changements de vents, de la situation des lieux où il vit, de la constitution de l'année. Il faut connaître le lever et le coucher des astres, pour savoir prendre garde aux changements et excès des aliments, des boissons, des vents de l'univers entier: c'est de tout cela que proviennent les maladies».
Le message d'Hippocrate est clair: à chacun de trouver pour son propre compte la juste proportion entre l'exercice et l'alimentation.
Ce sens de la mesure apparaît encore plus manifestement dans la façon dont les Grecs se comparent à leurs dieux pour ce qui est de leur santé. Nous serons comme des dieux! Ils auraient pu se donner une telle maxime, eux qui attribuaient à leurs dieux une santé insolente. Même le boîteux Héphaïstos pouvait exercer son métier de forgeron en dépit de son infirmité! Les Grecs ont préféré la fragilité des humains, craignant même l'état de santé parfaite. On ne peut qu'en déchoir, disaient-ils!
La santé est à leurs yeux un équilibre fragile, sans cesse à reconquérir, entre des humeurs changeantes: le sang, le flegme, la bile et l'eau; entre l'âme et le corps; entre l'exercice et l'alimentation. Cette idée d'équilibre a elle-même ses racines dans l'idée plus englobante d'harmonie, laquelle, selon la façon dont elle pénètre le réel, s'appelle tantôt santé, tantôt beauté, tantôt sagesse.
La responsabilité que les Grecs se reconnaissent à eux-mêmes face à la maladie et à la santé suppose chez eux une grande confiance en la vie et en la nature. Ils croyaient fermement en ce qu'ils appelaient le pouvoir guérisseur de la nature. Cette croyance alla jusqu'à les amener à considérer la maladie comme faisant partie du mouvement de la vie. D'où l'importance qu'ils attachaient à la catharsis, c'est-à-dire à la purification, (1) physique et morale, qui peut résulter de la maladie. Cette dernière apparaît alors comme une épreuve. Nous sommes ici de nouveau très près du châtiment, et nous en sommes très loin aussi: l'épreuve est à la fois un châtiment et le contraire d'un châtiment, parce qu'elle est une souffrance à laquelle on a conféré un sens par un acte libre. Suivant l'exemple de leur Dieu qui a lui-même souffert, les chrétiens placeront cette philosophie au centre de leur religion. Il est remarquable qu'ayant eux-mêmes des dieux exempts de la souffrance, les Grecs aient choisi d'imiter par un consentement libre celui de leurs héros qui a le plus souffert: Prométhée.(2)
C'est avec la même liberté, la même raison éclairée et mesurée qu'ils ont étudié la santé et la maladie, élevant ainsi la médecine au rang de la science (3)et modifiant par là la conception qu'on se faisait de la santé autour d'eux. A la fin du Ve siècle, en Grèce, deux types de médecine coexistent depuis longtemps. L'une est rattachée au dieu Hermès, l'autre au dieu Apollon. La première est essentiellement religieuse. C'est à celle là que nous nous arrêterons d'abord. Elle se pratique dans les temples dont le plus célèbre est celui d'Épidaure.(4)
L'accent y est mis sur la communication entre le patient et son thérapeute, le travail de ce dernier consistant à jouer de ruse avec un mal considéré non comme un fait observable, mais comme une façon pour le patient de se protéger contre certaines vérités sur lui-même.
Cette médecine a occupé presque toute la place en Grèce pendant de longs siècles, mais une tradition centrée sur l'observation des faits prit également forme très tôt. On en retrouve la trace dans l'Iliade d'Homère. Bientôt se formera à Cnide une école dont les membres se distingueront par une hostilité non déguisée à l'égard des disciples d'Hermès. Ces Cnidiens réclament des faits. Et en ce sens ils sont les précurseurs des positivistes qui en réclameront aussi vingt-quatre siècles plus tard. Des faits qu'ils observent, les Cnidiens donnent une description imagée. Dans le cas de la tuberculose par exemple, ils notent que le malade fait entendre des sons sifflants comme s'il parlait à travers un tuyau de roseau; dans une maladie des poumons, ils remarquent que le patient ouvre les narines comme un cheval qui court et tire la langue comme un chien desséché par la chaleur de l'été...
On ne connaît cependant aucun texte des Cnidiens prouvant que ces derniers ont tiré des idées générales ou des théories de l'observation des faits. Ils en sont au tout premier stade de la démarche scientifique.
Hippocrate franchira le second stade, celui de la raison, de la théorie. A force d'observer attentivement les malades, les hippocratiques avaient, comme nous pourrions le faire aujourd'hui, remarqué des liens entre certaines maladies et les saisons ou le climat. De ces faits, ils ont tiré une théorie qui est vite devenue une méthode rationnelle pour aborder la maladie. Avant toutes choses, ils considéraient l'habitat, tenaient compte de l'action du soleil, de la nature du terrain, des cours d'eau. Il s'agit là à la fois de l'ébauche de la géographie médicale et de la médecine de l'environnement. En second lieu, ils considéraient le climat et les saisons. Le passage d'une saison à l'autre est-il brutal ou doux? D'où venait le vent quand la personne est tombée malade? Toute corrélation significative entre une maladie et le climat était soigneusement notée.
Les hippocratiques ont également été de remarquables pionniers en ce qui a trait à la nosologie, c'est-à-dire à la définition et au classement des maladies. Telle maladie, la fièvre tierce par exemple, correspond à tel ensemble de symptômes, à tel syndrome. S'il manque un symptôme, on consigne le fait comme une anomalie et la nosologie progresse.
Le diagnostic, indissociable du pronostic, résulte toujours de l'application d'un protocole rigoureux et fixe. Les visites aux malades suivent le schéma suivant. «Le médecin s'approche lentement du malade et tente de se faire une idée plus exacte de son état. Ses mains sont-elles immobiles ou s'agitent-elles dans le vide comme pour attraper quelque chose? Est-il allongé, calme et détendu? Ou est-il agité, gesticulant et divaguant [...]? Au stade suivant, le corps du malade est dénudé, examiné avec soin, et les signes cliniques recherchés au moyen de la palpation. Enfin, le praticien scrute les selles, l'urine, les vomissures et les expectorations».
D'autres aspects de la doctrine hippocratique méritent considération. Dans le traitement, le médecin savait tenir compte des caractéristiques propres à l'individu, à son sexe ou à sa nationalité. «Souvent chez les femmes qui ne connaissent pas la source de leurs souffrances, les maladies deviennent incurables, avant que le médecin n'ait été instruit par la malade de l'origine du mal. En effet, par pudeur, elles ne parlent pas, même quand elles savent»; à cet intérêt du médecin hippocratique pour l'histoire détaillée de chaque cas, correspondent au XXe siècle les idées du médecin philosophe français Canguilhem sur la normalité. «La frontière entre le normal et le pathologique, écrit-il, est imprécise pour les individus multiples considérés simultanément, mais elle est parfaitement précise pour un seul et même individu considéré successivement». Canguilhem reprenait ici une thèse qu'Henri Sigerist, le plus grand historien de la médecine, avait défendue en ces termes: «Il ne faut pas se contenter d'établir la comparaison avec une norme résultant de la moyenne mais de plus, autant qu'il sera possible, avec les conditions de l'individu examiné».
Il faut aussi rappeler qu'Hippocrate demeurait lui-même imprégné des préjugés qu'il avait combattus. Par exemple, dans le corpus hippocratique, les poumons ne sont nommés que dans la mesure où l'on sait que des humeurs viciées s'y amassent souvent. On ne dit pas un mot du coeur. Selon les conceptions anciennes, cette source de vie était par essence invulnérable. Le foie est nommé seulement deux fois. On pourrait multiplier les exemples.
Tout ce qu'on peut conclure en tenant compte de ces erreurs, c'est que si Hippocrate a observé les faits, il n'a pas observé tous les faits. Qui voudrait le lui reprocher? En revanche, Hippocrate a embrassé du regard bien des aspects humains qui échappent à l'attention de trop de spécialistes d'aujourd'hui ayant pourtant une connaissance adéquate de l'anatomie et de la physiologie.