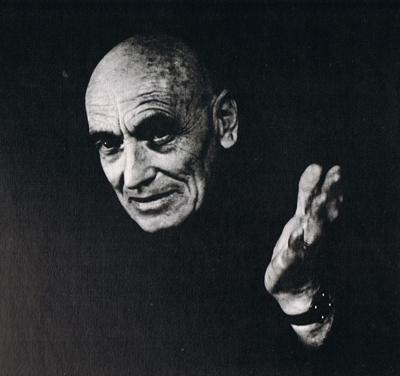L'eau: quand un gouvernement s'en lave les mains!
Dans le cas de Valence, on a compris, il y a plus de mille ans, que l'eau étant un bien commun à la fois rare et précieux, il fallait que chaque utilisateur de l'eau de la rivière Luria se sente responsable de l'ensemble de la ressource, exactement comme si elle lui appartenait. Pour assurer une distribution juste de l'eau entre les propriétaires, on a créé une coopérative comportant une instance juridique chargée de régler les conflits entre usagers sans qu'il soit nécessaire de recourir aux tribunaux réguliers. Ici, la justice entre les hommes et la justice à l'égard de la nature ne font qu'un. L'intérêt personnel s'impose à lui-même des limites qui le rendent compatible avec l'intérêt collectif et le développement durable. Et dans les orangers d'aujourd'hui il y a des oranges d'antan.
Dans le cas de la mer d'Aral, les citoyens, à l'échelle locale comme à l'échelle des nations touchées, au lieu de coopérer pour gérer sagement une ressource limitée, ont rivalisé pour en abuser. Et au lieu d'être incités à la sagesse par une autorité politique prévoyante, ils ont été incités à la démesure par un pouvoir central qui entendait tirer un profit immédiat de la monoculture du coton.
Il ne faut toutefois pas commettre l'erreur de penser que le pouvoir central a été aveugle parce qu'il était communiste. Le dust bowl, ou la désertification d'une grande partie du Mid West américain, fut une catastrophe pire peut-être que celle de la mer Aral. Là, des fermiers encouragés à pratiquer les monocultures du blé, du maïs ou du coton ont détruit la végétation sauvage qui conservait l'humidité du sol et le protégeait contre le vent. Au cours de la décennie 1930, plusieurs années consécutives de sécheresse, combinées avec des vents violents, ont transformé en désert une grande partie du Texas, du Kansas, de l'Oklahoma et du Nouveau-Mexique.
Par dizaines de milliers, les fermiers durent abandonner leurs propriétés et s'exiler pour trouver du travail en des lieux plus cléments. De grandes entreprises rachetèrent ensuite les terres à vil prix. Elles y pratiquent aujourd'hui une culture intensive du blé, notamment, mais au prix d'une irrigation dont le coût réel ne sera connu que dans l'avenir, lorsqu'il ne sera plus possible de nier le fait que l'eau est un bien rare. Or cet avenir, c'est aujourd'hui: en effet, l'Ogallala, le plus important aquifère des États-Unis, est en voie d'épuisement, menaçant ainsi l'agriculture des Hautes-Plaines, depuis le Texas jusqu'au Nebraska. Dans ces régions, le déficit de pompage est de 17 milliards de m3/an, déficit maintenu par l'absence d'une tarification adéquate.1,2
La catastrophe communiste et la catastrophe capitaliste ont la même cause fondamentale: l'idée illusoire que la ressource eau est illimitée et qu'il suffit pour satisfaire la demande, quelle qu'elle soit, de réunir le capital nécessaire et de mettre le progrès technique à profit.
La réussite espagnole, de son côté, n'aurait pas été possible si la population locale, de même que les autorités politiques, n'avaient pas eu une conscience très vive de la rareté de l'eau. C'est parce qu'elle était perçue comme nécessaire que la coopération s'est imposée.
À l'échelle mondiale tout au moins, il n'est plus permis de douter de la rareté de l'eau. Il en est résulté un changement radical d'attitude chez les experts. Ce changement est bien évoqué dans le dernier numéro du Courrier de l'Unesco:
«Les hydrologues et les ingénieurs apportaient jusqu'ici une réponse clés en mains aux pénuries d'eau: construire plus de barrages, dessaliniser l'eau, voire même en acheminer par pipelines des zones humides vers les régions sèches. Non seulement ces solutions techniques ne suffisent plus à répondre à la croissance des besoins mais en plus elles coûtent trop cher, aussi bien en termes économiques qu'en termes écologiques.
«Aujourd'hui notre paysage hydrologique est redessiné par les environnementalistes et les économistes, soudés par une alliance hors du commun. Au lieu de se demander comment accroître l'offre, ils martèlent que l'enjeu crucial est de trouver les moyens de réduire la demande.»
À quelles conditions cette conversion au réel, à l'idée que la ressource eau a des limites, pourrait-elle entraîner une coopération mondiale analogue à celle de la région de Valence? Il faut d'abord que la conversion s'approfondisse jusqu'à devenir radicale. L'eau qui, dans les grands projets de développement, n'a été au cours du présent siècle qu'un facteur parmi d'autres, devrait devenir le premier critère pris en considération. Cela veut dire qu'avant même de se demander si un projet industriel ou domiciliaire est rentable, il faudrait s'assurer qu'il ne provoquera ni injustice, ni déséquilibre dans l'usage de l'eau. Dans le cas des eaux souterraines, comme dans celui des eaux de surface, comment s'en assurer sans une consultation honnête et sérieuse des citoyens?
En ce moment, les riches retraités américains affluent dans des villes réputées tranquilles, comme Phoenix en Arizona, et dans d'autres petites villes privées et fermées, construites également en plein désert. Si l'eau était l'un des principaux critères pris en compte dans le développement de telles migrations, qui sont d'ailleurs des phénomènes sociaux aberrants, ces villes fortifiées ne seraient pas autorisées. Une telle interdiction serait toutefois perçue comme une atteinte à la liberté.
De même, si l'eau était un critère important, on s'efforcerait de convaincre l'Arabie saoudite ou la Lybie d'acheter de l'eau virtuelle à l'étranger sous forme de céréales ou de viande, plutôt que de dépenser des dizaines de milliards afin d'irriguer des déserts dans l'espoir d'en tirer ensuite les céréales et la viande produites ailleurs à bien meilleur compte. Mais compte tenu de l'importance de l'autonomie alimentaire pour tout pays, on ne pourrait demander à la Lybie ou à l'Arabie saoudite qu'elles renoncent à leurs grands travaux qu'à la condition de leur garantir un approvisionnement en céréales et en viande. Or ces pays ont, tout près d'eux, l'exemple de l'Irak qui est en ce moment l'objet d'un blocus.
Les eaux mondiales du Québec
Mario Soarès et Ricardo Petrella, entre autres, ont tenté de préciser les conditions d'un tel contrat dans Le Manifeste de l'eau.3
Où en sommes-nous au Québec et au Canada, par rapport au contrat mondial de l'eau et plus généralement, par rapport aux modèles de Valence et de la mer d'Aral?
En ce moment au Québec, tout propriétaire d'un terrain est aussi propriétaire de l'eau qu'il peut tirer d'un puits ou d'une source située sur le dit terrain. Il lui suffit pour commercialiser cette eau, et le cas échéant pour l'exporter, d'obtenir un permis de sa municipalité. C'est ainsi qu'à Mirabel, le puits Foucault est exploité, au grand dam des propriétaires du voisinage.
Par une telle politique ou plutôt une telle absence de politique, nous offrons au reste du monde l'image d'un peuple moins civilisé que ne l'étaient les habitants de Valence au Xe siècle de notre ère et les Athéniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous tenons pour négligeable la solidarité locale aussi bien que la solidarité internationale. En rattachant la propriété de l'eau à la terre sur laquelle on la trouve, nous refusons de la considérer comme un bien commun qu'il faut gérer de concert avec ses voisins; en en faisant une marchandise, nous nous engageons à la livrer au plus offrant, en l'occurrence les États-Unis, le pays au monde qui déjà consomme le plus d'eau, au mépris d'une règle de distribution basée sur le principe que l'eau correspond à une nécessité vitale.
En avril 1998, le gouvernement du Québec a imposé un moratoire sur l'octroi de nouveaux permis d'exploitation. On aurait pu croire qu'il reconnaissait par là l'urgence d'une nouvelle politique et la nécessité de retarder l'octroi de nouveaux permis, jusqu'à ce qu'une loi soit adoptée. En dépit des nombreuses demandes de prolonger le moratoire qui lui ont été adressées, le gouvernement y a mis fin, comme prévu, en janvier 1999. Depuis, au moins trois permis auraient été accordés.
Si seulement ce laisser-faire était pour nous la meilleure façon de défendre nos intérêts! Rien n'est moins sûr. La précipitation avec laquelle nous avons cédé nos ressources naturelles, la forêt d'abord, puis le fer, a toujours été de notre part un signe de servilité, littéralement de manque de souveraineté, dans des domaines où nous avions tous les pouvoirs requis pour mieux maîtriser la situation dans notre intérêt.
Notre ambition, depuis le début de la révolution tranquille surtout, a toujours été d'ajouter de la valeur à nos richesses naturelles en les transformant ici même. Selon la même logique, notre intérêt n'est pas de vendre notre eau à l'état brut, mais de l'exporter sous forme d'eau virtuelle présente dans divers produits agricoles ou industriels.
Certes, nous avons intérêt à vendre de l'eau en bouteille, ne serait-ce que pour être ainsi exemptés d'acheter celle qu'exportent ici la France ou l'Italie. Mais encore faudrait-il que la chose ne se fasse pas d'une manière précipitée, à la sauvette et en l'absence de toute loi qui protégerait et favoriserait la solidarité locale aussi bien que la solidarité internationale. Nous ne perdrions rien à attendre. Notre eau de qualité prend sans doute plus de valeur en restant cachée dans les entrailles de la terre, qu'en étant cédée à 1 cent le litre à de grandes entreprises étrangères qui nous la revendront un dollar! Et puisque cette eau est un bien commun, pourquoi ne serait-elle pas exploitée et vendue par des coopératives dont seraient membres tous les propriétaires dont les réserves d'eau risquent d'être réduites par l'exploitation à haut débit d'un puits commercial du voisinage?
Un expert en la matière, M. Banton, de l'INRS-Eau, semble favoriser des solutions de ce genre quand il soutient que la gestion de l'eau doit se faire au niveau des bassins versants, comme dans le cas de Valence. Renvoyant dos à dos la nationalisation de l'eau et la privatisation totale, il propose une solution intermédiaire qu'il appelle la gestion par comité: «La gestion par comité, qui est par ailleurs actuellement étudiée pour les eaux superficielles dans différents bassins versants du Québec, semble en fait la meilleure option de gestion, puisqu'elle allie à la fois l'implication de tous les usagers publics, institutionnels et industriels, l'existence d'un pouvoir autonome pour la gestion, et le renforcement de la décision régionale en matière de priorité de développement économique. [?] Dans ce mode de gestion, le gouvernement et son représentant, le ministère de l'Environnement joueraient des rôles d'observateurs et d'appuis à la requête des comités.»
Hélas! Ce modèle est trop élégant pour ne pas cacher les pièges qu'il faut à tout prix éviter. Monsieur Banton indique bien le camp auquel il appartient, quand il donne à entendre au début de sa conférence que de l'eau souterraine il y en a en surabondance au Québec. Comment expliquer qu'un chercheur aussi écouté omette d'évoquer la question de la qualité variable de cette eau?
Et qu'est-ce qu'un gouvernement qui se limite au rôle d'observateur? Si la chose était seulement possible, ce dont il est permis de douter, serait-elle souhaitable? La solution de monsieur Banton, une fois dissipée la vapeur démocratique sous laquelle elle se présente, consiste en réalité à donner le pouvoir aux experts, et par leur intermédiaire, aux grandes entreprises capables de retenir leurs services, en alternance avec les gouvernements et les centres de recherche eux-mêmes, en partie subventionnés par les entreprises privées, telles Danone pour les eaux en bouteille ou La Lyonnaise des eaux pour la gestion des eaux municipales.
Les expériences récentes de Franklin (voir l'article de Lise Dolbec) de Barnston-Ouest (voir l'article de Louise Doucet) et de Mirabel (voir l'article de Gilles Verrier) montrent clairement que des comités locaux ne sont absolument pas en mesure de négocier avec des groupes puissants.
Dans le cadre d'une politique de développement durable, rompant le lien entre la propriété du sol et la propriété de l'eau, et affirmant clairement que l'eau est un bien commun de l'humanité dont les nations ont la gestion déléguée, le gouvernement devrait offrir aux collectivités locales et régionales tout le soutien dont elles ont besoin pour défendre efficacement leurs intérêts et leurs principes.
En attendant qu'une telle politique soit établie, le gouvernement du Québec doit reconduire le moratoire, comme le Fédéral l'a d'ailleurs invité à le faire. La réponse de Québec à Ottawa, dans ce cas, telle que rapportée par La Presse canadienne, a été la suivante : «Le Québec ne reconnaît pas au gouvernement fédéral la légitimité d'intervenir sur la protection et la gestion des bassins hydrographiques du Québec», a fait savoir jeudi le 12 février le ministre québécois de l'Environnement, Paul Bégin. «C'est une autre stratégie qui fait fi des compétences que le Québec exerce déjà pleinement», ajoutait-il.
Pleinement! L'adverbe paraît un peu fort quand on note que tout au long de leur courageuse démarche de protestation, les citoyens de Franklin et de Mirabel ont eu le sentiment de n'être ni soutenus par les lois de leur pays, ni entendus par des fonctionnaires impartiaux et bienveillants. Et pendant que Québec se complaisait dans la plénitude de son inaction, Ottawa atteignait des objectifs audacieux sur le plan international, tandis que la Colombie Britannique se comportait comme un pays souverain en maintenant un moratoire destiné à empêcher les Américains d'ouvrir une brèche, grâce à laquelle ils pourraient progressivement s'approprier les eaux canadiennes. Mais attention, précisément parce qu'ils furent porteurs d'eau, les Québécois n'aiment pas qu'on les prenne pour des gourdes. Ils comprendraient mal qu'un gouvernement social-démocrate, conservant le monopole des casinos, des loteries et de l'alcool, s'en lave les mains quand l'eau des citoyens est en cause.
Notes
1. Symposium sur la gestion de l'eau au Québec, volume 1, édité par Jean-Pierre Villeneuve, Alain N. Rousseau, Sophie Duchesne, 1997.
2. Voir Marc Chevrier, «Déporteurs d'eau ou maîtres de notre patrimoine?», L'Agora, vol 6, no 2.
3. Symposium sur la gestion de l'eau au Québec,
volume 1, édité par Jean-Pierre Villeneuve, Alain N. Rousseau, Sophie Duchesne, 1997.